Christophe Alix et Le Collectif : la valeur du travail artistique
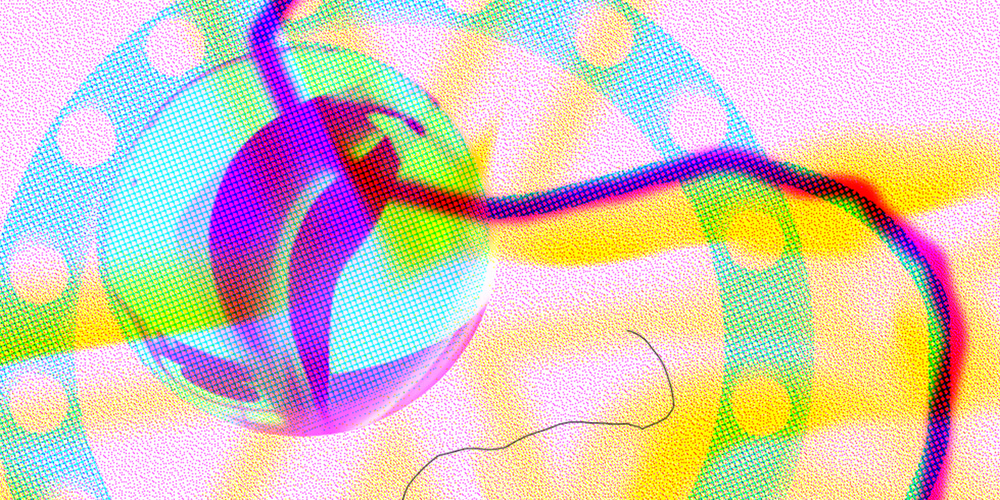
- PointCulture : Au fond, qu’est-ce que le travail de l’artiste ? Ça englobe quoi, ça commence quand, ça finit où, qu’est-ce qui le caractérise ?
- Christophe Alix * : De toute évidence, le travail de
l’artiste ne commence pas à partir du moment où il s’engage sur le montage de
son exposition, du tournage d’un film ou de la première répétition d’une pièce.
Depuis le moment où l’idée du projet émerge jusqu’à ce qu’elle trouve une
articulation valable pour son auteur, il y a un long travail qui n’est jamais
comptabilisé dans les heures investies et qui consiste à constituer des
dossiers de partenariats et de subsides, tout en continuant à développer le
projet artistique. C’est la phase exploratrice, qui est capitale pour qu’un
projet artistique puisse permettre aux participant·e·s de se rémunérer un
minimum. Déjà à ce stade l’artiste considère, souvent à juste titre, que cette
étape fait partie du processus de travail lié au projet lui-même. À ce propos,
une amie me rappelait le générique de Tout va bien (1972) de Jean-Pierre Gorin et Jean-Luc
Godard, où tous les chèques de la production défilent les uns après les autres
sur l’écran.
Il est par ailleurs intéressant de remarquer que certain·e·s artistes refusent de dire qu’il·elle·s travaillent, parce que la vie comme l’art ne se résument pas au boulot. Cela ne veut pas dire que le travail n’existerait pas en tant qu’entité ou qu’il serait dénigré pour faire exister une œuvre. Cela veut dire que l’art est l’une des réponses à donner à la vie et que, par conséquent, le travail n’est pas une notion primordiale à la vie. Quand il est face à son processus créatif, l’artiste navigue constamment entre un effort à fournir et une expérience de vie. C’est ainsi qu’une expérience dure plus ou moins longtemps si on la replace dans le cadre d’un projet particulier, alors qu’elle prend une tout autre dimension si le même projet est replacé dans l’ensemble de la vie d’un·e artiste…
- En surface, c’est donc la dernière phase du travail que l’on retient, celle de l’édition, de la monstration, du spectacle… Est-ce uniquement à ce moment-là que l’art « produit quelque chose » en termes de réception par le public ?
- Le Collectif ** : Les institutions d'art tendent à
mettre particulièrement la dernière phase du travail en évidence (ce qu’on
appelle « le résultat », qui est une vision très partielle du
travail artistique, qui comprend plusieurs versions et une recherche qui
s'étend en rhizomes). La valeur de l'art ne correspond qu’à une prise en compte
fragmentaire, c'est ce à quoi les artistes sont confronté·e·s au moment de rentrer un dossier de candidature (pour
un appel à projets, obtenir un financement). La confrontation d'une idée
artistique avec le champ institutionnel est toujours jalonnée de moments
d'adaptation et de consensus.
Le travail des artistes doit être transformateur, à la fois pour l'artiste et pour ses publics. Les institutions, les médias et les politiques fonctionnent et mesurent le succès d’événements artistiques surtout quantitativement. Comprendre la fréquentation des événements d'art est cependant beaucoup plus complexe. Le fait d'être ému·e par un ouvrage n'est pas forcément la conséquence de notre transformation. La réponse directe et affective donne la possibilité aux publics de mettre en marche des émotions qu'il serait moins facile de vivre et de montrer au quotidien. Ce travail de transformation peut aussi se produire plus tard, il est tout autant émotif que rationnel, que sujet aux conséquences.
On a également tendance à considérer la création artistique de manière très individualiste, alors que les processus de création sont très souvent collectifs. Ce mode de fonctionnement collectif, qui met en commun des savoir-faire, est chronophage en temps non valorisé par les critères institutionnels.
- Que signifierait prendre en considération le travail de recherche, de préparation, d’essais et erreurs ? Comment inscrire cela dans le statut de l’artiste, sa reconnaissance, sa rémunération ? Quels sont les enjeux ?
- Christophe Alix : Il n’existe pas de statut d’artiste en Belgique. C’est un leurre de parler du statut d’artiste alors qu’il s’agit en fait de se déclarer et d’éventuellement bénéficier, à la condition de prouver avoir atteint un certain seuil horaire et financier dans plusieurs activités artistiques pendant un an, d’une allocation chômage qui ne dépassera jamais 1 200 euros par mois. L’artiste est donc reconnu·e comme un·e chômeur·euse. Il serait temps de faire évoluer les mentalités autour de cette question
Je m’étais un temps penché pour ma thèse de doctorat sur le statut ouvrier-artiste au théâtre dans la France de la fin du XIXe siècle. Il s’agissait à l’époque de se poser la question de la reconnaissance de l’artiste alors que les autorités publiques réfléchissaient aux méthodes de distribution des premiers subsides pour soutenir directement des artistes (et pas seulement des structures). Il est intéressant de voir quels étaient les débats de l’époque, surtout de notre petite fenêtre où nous avons trop souvent l’impression d’être figé·e·s dans un système, comme si nous ne pouvions plus rien changer.
Maurice Pottecher, avec son Théâtre du Peuple à Bussang (1895), revendiquait un théâtre, subventionné par l’État où ses membres ne seraient pas payé·e·s au cachet, mais à la fin du mois comme n’importe quel·le·s autres salarié·e·s ou fonctionnaires. À l’inverse, d’autres artistes du théâtre, comme Jacques Copeau et Romain Rolland, ont refusé d’être aidé·e·s par l’État de peur de perdre leur liberté de création. Copeau n’avait pas accepté de recevoir une aide financière des autorités civiles pour le Théâtre du Vieux-Colombier qu’il avait ouvert en 1913. Alors que son théâtre était devenu trop petit pour permettre de réaliser suffisamment de recettes, des amis ont tenté de le convaincre d’accepter de voir plus grand. Il avait fait cette réponse dans cette lettre envoyée à Jean Schlumberger en 1919 :Non, faisons plus petit, pour faire plus pur, plus solide ; faisons à notre taille et selon nos forces d’aujourd’hui. Mais, faisant plus petit, tâchons de faire plus libre, essayons de nous soustraire à toute servitude, subvention ou exploitation. Ne nous mettons pas dans la tête qu’une exploitation plus commerciale nous fera vivre. À ceux·elles qui diraient : 'Allons au grand public qui nous ferons vivre', je répondrai : 'Retirons-nous plus loin encore'. — Jacques Copeau, lettre à Jean Schlumberger (1919)
Quelque temps après avoir écrit ces mots, Copeau et sa compagnie quitteront Paris pour travailler avec des moyens financiers extrêmement limités à Merceuil, un petit village de Bourgogne. Il vivra difficilement sur ses conférences et écrits pour continuer à monter ses projets théâtraux.
Sans défendre cette situation particulière, qui n’est pourtant pas exceptionnelle un siècle plus tard, l’artiste doit être libre de concevoir et réaliser son projet comme il·elle le souhaite tout en étant soutenu·e par un véritable cadre légal et financier.
- Tout ce qu’il faut chercher-produire-assimiler-transformer-métaboliser pour se rendre apte à créer se traduit dans une expérience de vie complète, entière. Symétriquement, l’amateur·rice d’art ne produit-il·elle pas un travail similaire pour se rendre compétent·e face à l’art, compétent·e pour apprécier, ressentir, comprendre tel courant esthétique, s’émouvoir, partager, voire acquérir des pièces ? L’amateur·rice d’art doit aussi produire un travail : se cultiver, s’informer, exercer sa sensibilité, son intuition… Sans ce travail, pas de réception de l’art ?
- Christophe Alix : Tout à fait. Il y a une tendance
générale chez les artistes, amateur·rice·s ou pas, à bien plus largement
intégrer la notion d’art à celle de la vie. C’est un fait et c’est tant mieux.
Ce que je veux dire, c’est qu’en général l’artiste sait que son regard
s’aiguise tous les jours sur les choses de la vie et que rien n’est jamais
acquis. On comprendra plus facilement le fait qu’un·e athlète s’entraîne tous
les jours pour se préparer à une compétition alors que l’on a plus de mal à
l’envisager pour les artistes. Pourtant un·e artiste travaille de manière
régulière, même quand il·elle se promène, pour faire aboutir son projet.
L’évolution de la performance d’un·e athlète est perceptible, voire mesurable,
alors que l’on n’aura jamais de paramètres disponibles pour mesurer l’évolution
qualitative du travail de l’artiste. C’est justement cette impossibilité à
saisir totalement ce que l’art englobe qui fait tout l’intérêt de cette
matière, si seulement nous pouvions éviter d’être constamment dépendant·e·s de
modèles économiques ou scientifiques pour évaluer la qualité et la quantité de
ce que la vie nous conduit à produire.
Pour le·la spectateur·rice, c’est en faisant l’expérience des œuvres qu’il·elle affûtera son regard. Nous ramenons trop souvent l’art contemporain à une chose incompréhensible, c’est un argument de plus dans la longue liste de tous ces discours populistes. L’incompréhension est souvent le résultat d’un refus de lecture ou de vivre l’expérience quand on est face à une chose que l’on ne comprend pas, dérangeante ou surprenante. Il existe différents types de refus liés à une multitude de causes, au fait par exemple que l’œuvre nous renvoie à un trauma personnel, mais ce qui revient le plus souvent, c’est de constater que nous sommes contaminé·e·s, monde consumériste oblige, par la croyance que les objets doivent exister avec un but utilitaire : un sèche-cheveux sèche les cheveux, une voiture permet de se déplacer, les croisières sont faites pour s’amuser, etc.

Et puis un jour, on est face à l’urinoir, sous le joli titre de Fontaine, de Marcel Duchamp, ou face à la boîte de conserve sur laquelle on peut lire « merde d’artiste » de Piero Manzoni, ou encore devant la photographie Piss Christ d’Andres Serrano, des œuvres qui aujourd’hui, provoquent toujours des réactions violentes de certaines personnes. Il est donc essentiel de continuer à aiguiser les regards. C’est dans la nature de l’homme de créer de belles choses et des choses horribles, mais jamais l’art ne sera en mesure de se situer dans la seconde catégorie. Ce qui est horrible, c’est par exemple la misère, la violence et la guerre. La boîte de conserve de Manzoni, même si elle n’est pas un bel objet au sens le plus basique de l’esthétisme en art, ne fait rien de mal. Au pire, elle pourra exploser sur la cheminée d’un·e collectionneur·euse avec les conséquences que l’on peut imaginer…
- Quelle est l’interaction entre les savoir-faire artistiques et les autres savoir-faire parallèles, comment d’autres métiers permettent au travail artistique de se développer, et vice-versa ?
- Le Collectif : Même si on prend en compte l'étymologie du terme « économie », « gestion de la maison », on sent bien que cette gestion n'est pas représentative de l'ensemble des soins dont la maison a besoin. Comment, à titre d’exemple, qualifier en termes de gestion le travail essentiel du chamane dans une société donnée? À une tout autre échelle et une tout autre époque, il faudra un jour sans doute écrire à propos du travail de pédagogie que les graphistes puis les développeur·euse·s web ont prodigué à leurs partenaires artistes, institutions, contacts, familles, pendant toutes les années 1990 (et jusqu'à maintenant) en tant que premier·ère·s spécialistes non-spécialistes du numérique. Beau cas actuel de travail non-dit, non-compté. C'est un micro-soin, rampant, très dense. Je pense à celui-là parce que je le connais, il doit y en avoir énormément d'autres, de toutes natures. Le fait que ce travail a si peu été décrit, promu, a aidé l'industrie informatique à développer les pratiques qu'elle savait profitables et à mettre l'étouffoir sur celles qui auraient été par trop dommageables pour elle économiquement, ces pratiques trop émancipatrices pour l'utilisateur·rice. Olia Lialina pointe ainsi la bascule de "User" à "People" et le résultat qui est de retirer à cet·te utilisateur·rice ses droits légitimes. Voir aussi ce que dit Don Norman :
Parmi les horribles mots que nous employons, il y a le mot “utilisateurs”. Je pars en croisade pour nous débarrasser de ce terme. Je préfère parler de “personnes” — Don Norman- Ne faut-il pas – et comment ? – inventer un modèle qui prenne en considération autrement, socialement et économiquement, le travail de création culturelle au sens large (qui n’inclut pas que l’art, mais tout ce qui va avec et qui fait que l’art a une fonction importante, dynamique, dans l’évolution d’une société) ? Une meilleure prise en compte de tout ce que l’on appelle « l’autre travail », en fait ?
- Le Collectif : En 2004, l'ASBL Constant - art et média, lors de son festival Verbindingen /Jonctions, avait rassemblé pour une table ronde différents "profils professionnels", des personnes qui travaillent et aiment leur travail : mères ou pères de famille, développeur·euse·s de logiciels libres, artistes. Aucune d'entre elles n'était payée pour ce qu’elles faisaient et pourtant elles le faisaient. Ce rapprochement osé avait pour but d’initier une solidarité entre ces différents groupes dont l’activité repose sur la générosité et contribue au bon fonctionnement de la société. En tant qu'opérateur·trice culturel·le, il est important de ne pas se désolidariser des autres travailleur·euse·s. Effectivement, comment créer des conditions de vie et de travail communes qui ne soient pas basées sur l'auto-exploitation quand le privé et le professionnel se mêlent jour et nuit ? De plus, il est attendu que nous ne nous plaignions pas car nous faisons ce que nous aimons. Sur ces questions, il est intéressant de lire Terre Thaemlitz, qui demande que tout ce travail non-dit soit payé sans attendre et qui invite, surtout, à résister par la friction, la tension, à affirmer que nous sommes des travailleur·euse·s comme les autres. Un modèle pourrait déjà être de transformer le statut de chômeur·euse artiste en statut d'artiste et de permettre aux artistes d'avoir des revenus plus importants que ceux déterminés par ce statut et de pouvoir combiner plusieurs formes de travail culturel. Chaque vie, chaque pratique est différente.
Difficile, néanmoins, de dire
comment « l'autre travail » peut trouver à être rémunéré. Mais, en
tout cas, quand on introduit, par exemple, le principe de logiciel libre avec
des notions de licences moins privatives dans une relation de service, c’est
l'ensemble de la chaîne d'exploitation qui se met à bafouiller. Les schémas de
résistance nécessaires deviennent plus clairs. Le système se décapitalise, en
fait. Bien entendu, c’est à une petite échelle, avec peu de retombées sur le système
économique dominant. Mais on peut spéculer (c'est le mot) que si l'échelle
s'élargit, les mouvements de résistance auront un impact potentiel positif sur
les volumes financiers à l’œuvre. Des évolutions positives sont donc possibles,
sauf si la barbarie gagne la course
Interview : Pierre Hemptinne
avec l'aide d'Alicia Hernandez-Dispaux
image du bandeau : Le Collectif
* Christophe Alix est un artiste, chercheur, enseignant en art performance et directeur
de l’École supérieure des Arts de l’image Le 75. Il s’intéresse entre autre à
la place de la (re)présentation du corps à travers sa textualité scénique, son
rapport à la technologie, des espaces queer et plus récemment à partir d’une
exploration socio-artistique de ce qu’il appelle la « performance invisible ». Il défend aussi depuis de nombreuses années la place de la pratique artistique comme recherche fondamentale dans les
études supérieures, sujet sur lequel il a aussi publié.
** Le Collectif regroupe les réponses
collectives de plusieurs groupes de recherches au sein d'écoles d'art de
Bruxelles sur les économie/écologies des pratiques du design, dans le cadre du
Master communication visuelle et graphique à l'Erg (coordonnée par Loraine
Furter et Harrisson).
- Le module de recherche Let Love Rule sur les contrats et les relations dans l'écosystème artistique, à l'ArBA (coordonnée par Florence Cheval, Loraine Furter, Bruno Goosse, Xavier Gorgol, Aurélie Gravelat et Lola Martins-Coignus).
- Le module pluridisciplinaire L'argent ne ment pas, dans le cadre du Master typographie à La Cambre (coordonnée par Laure Giletti et Pierre Huyghebaert).
- Avec des interventions de Bruno Goosse, initiateur du projet A/R, et Laurence Rassel, directrice de l'Erg, qui a participé à l'élaboration de cette proposition commune.