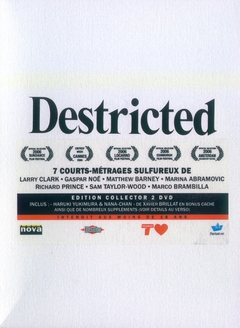DESTRICTED
« Destricted », 7 courts-métrages de Larry Clark, Gaspar Noé, Matthew Barney, Marina Abramovic, Richard Prince, Marco Brambilla.
Un ensemble de films sur le sexe ou sur la pornographie !? Car, même si la distinction tend à s’oublier, il s’agit bien de choses à distinguer. Le dernier numéro spécial « sexe 2008 » des Inrockuptibles a lui, une furieuse tendance à jouer sur la confusion et à légitimer/banaliser l’industrie pornographique, voire à lui tisser l’aura d’une industrie de la transgression et de la libération sexuelle ! Quelles ont été les consignes données aux réalisateurs enrôlés dans l’aventure « Destricted » : réaliser un commentaire sur les relations entre cinéma et pornographie, rechercher des formes alternatives de pornographie ? Soumettre à la question nos relations au sexe et à la pornographie en enrayant un peu leur banalisation ? Le cahier des charges semble avoir été défini de façon assez libre. Les 7 films rassemblés présentent de fait des approches disparates, contrastées. Premier message : face au sexe, chacun a un traitement personnalisé !? Et ce, tant au niveau du sujet choisi, des objets montrés que des esthétiques et narration, avec leurs rituels et préliminaires propres. Mathew Barney, sans se forcer, en restant au plus près de ses obsessions, réalise un poème cinématographique intrigant, attachant. Avec de premières images qui prennent à rebrousse poils l’artificialité paradoxale de la pornographie où, pas besoin de faire un dessin, une bite est une bite, une chatte une chatte, avec une telle insistance qu’elle en élimine toute ambiguïté, toute liberté et qu’elle confine à un langage d’autorité bestiale. Les premiers gros plans de l’œuvre de Barney baignent dans l’indistinction. Une sorte de nid, de peau florale, de mucus botanique, du tissu sexuel non déterminé, ni mâle ni femelle, l’un et l’autre, l’un ou l’autre. Ou surface palpitante d’une autre planète. Contre l’hyper évidence pornographique dont il est impossible de s’évader, voici un organe des possibles, qui peut devenir, à la limite, ce que l’on veut. Ensuite, tout prend une autre dimension, inattendue mise en scène technologique et semi barbare d’une superbe érection. Représentation onirique, baroque, d’un mécanisme mystérieux du désir.
Marina Abramovic s’amuse à placer le sexe au centre de la vie paysanne : la recherche de la fécondité des champs et du bétail, passent par des rituels sexuels que les femmes et les hommes accomplissent comme pour séduire les forces naturelles. Et de façon très fonctionnelle, archaïque. Sam Taylor-Wood, comme elle l’explique dans son interview en bonus, aborde l’exercice demandé aussi dans une dimension fonctionnelle : réaliser un fantasme personnel de femme et de cinéaste : balader un beau cow-boy dans les prairies de l’Ouest et le faire se branler à genoux, seul dans l’immensité. Le regarder faire et le filmer. Comme elle le dit : « celui qui attend du vrai porno sera déçu ». Voici déjà une indication de décalage. Les attentes du public ordinaire de pornographies sont ailleurs. Et elle ajoute : « j’ai quand même le sentiment que la pornographie est surtout un truc de mec. »
Richard Prince recycle des séquences porno anciennes, d’une sorte d’âge d’or, et l’on peut, au passage, mesurer la distance existante par rapport à l’hyper pornographie actuelle. Ça fait réfléchir sur ce que le marché du sexe fait subir comme évolution aux représentations industrielles, quel rythme, dans quel sens. Ces images crues qui datent, et ont même la teinte passée de vieilles bandes VHS visionnées en secret, ont presque, aujourd’hui, quelque chose de romantique, de désuet. Une intervention qui comporte ainsi une dimension archéologique. Marco Brambilla puise aussi dans les archives pléthoriques et réalise un montage au beat matraqué, pilonnage d’images de cul accéléré, compulsif, impossible à suivre, une sorte de saturation visuelle palpitante organisant les échantillons d’un nombre indéfini de corps et copulations en une sorte d’unique acte sexuel.
Gaspard Noé filme en alternance un homme et une femme enfermés séparément dans leur cocon fantasmatique et qui font l’amour seuls dans une lumière scandée stromboscopiquement, jet alternés jour/nuit, spasmes. Masturbations parallèles syncopées, comparaisons des appareils, des gestes, des techniques, des objets transitionnels! En bonus, ils sont enfin réunis et baisent ensemble, c’est bien plus banal!
Larry Clark va à la rencontre de la génération porno. Sous forme de casting (c’est déjà un genre de film porno) dont l’objet est de tourner une scène de sexe avec une actrice professionnelle, il interroge les jeunes pour mesurer l’impact de la pornographie banalisée sur leurs désirs, leurs fantasmes, leurs relations au sexe réel, leurs représentations de la femme. Décapant. Chez ces jeunes gros consommateurs de pornographie, et qui en parlent le plus naturellement du monde, il semble que le fait de faire l’amour simplement n’existe pas, plus, c’est ringard, faut oublier. La référence est le mode des poses exacerbées, de la performance gymnastique et du corps professionnalise l’exhibition des relations sexuelles. Certaines postures sont forcées, exagérées, pour offrir une vision plus explicite à la caméra, mais dans la vie de tous les jours, ça peut correspondre à une réelle torture ! La confrontation permanente depuis le plus jeune âge (7 ans pour certains) aux images crades et aux prouesses des professionnels engendre objectivement des complexes, des inaptitudes : sur son corps, sur sa capacité à en faire autant que les stars matées durant des heures et des heures en se branlant, l’association du regard, du faire impliquant une identification qui construit des normes de plaisir inaccessibles. La plupart de ces jeunes ont finalement très peu de rapport sexuels réels et suivis. Au terme du casting, Larry Clark choisit un garçon probablement pour sa fragilité. À son tour, il doit choisir sa partenaire, ce qui donne lieu à un nouveau casting de sexe. La scène de baise, tout aussi crue que n’importe quel autre film porno, est aussi autre chose de par le contexte: une confrontation au sexe réel à travers l’imposition des codes pornographiques non plus observés sur écran mais à pratiquer, à transformer en actes. Avec toujours un étrange décalage qui se révèle au détour de certaines questions ou réactions du « jeune acteur/hardeur », quand, de façon maladroite et approximative, il s’imagine que la transaction repose sur le désir de l’autre conduit par l’affectif ou quand il avoue, après, avoir eu à certains moments une certaine nausée. Bien entendu, on voit les filles rires, l’affectif n’existe pas vraiment dans un type d’échange, ou sous forme d’ersatz de défense, ce sont des travailleuses qui n’ont pas à jouer les sentimentales, payées pour effectuer un certain nombre de mouvements durant un certain temps (il y a des normes par « scène »). Le dispositif est vraiment intéressant et bien joué, instructif. À passer dans toutes les écoles, à utiliser par les éducateurs pour aborder les problématiques liées à la pornographie. Larry Clark réalise un document qui pose les vraies questions, interroge réellement la place de la pornographie dans nos vies affectives et sexuelles.
L’autre toute-bonne surprise est en « bonus caché » : « Haruki Yukimura & Nana-Chan » de Xavier Brillat. C’est le voilé levé sur une remarquable séance de shibari. Il n’y a pas de dialogue, dès la première image du jardin clos, « ça a commencé » dès les premiers pas et le déchaussement à l’entrée de la maison japonaise, le suspens est ouvert. La bande son est essentielle: la respiration du maître, le glissement des cordes dans les nœuds et sur la peau (effleurement reptilien et pression chanvre contre chair) , quelques gémissements de la femme quand elle n’est plus que bouton de fleur dans son filet de liens comme une armure érogène, quelques paroles échangées complices, deux trois rires. L’atmosphère est charnelle, tendue et en même temps naturelle, limpide, sans aucune connotation malsaine. Le rituel enchaîne des étapes successives dans un ordre bien établi, les postures et les figures à réaliser avec les cordes sont de plus en plus élaborées (il y a une progression selon l’échauffement des protagonistes et le moment de la journée), de plus en plus possessives. C’est surprenant, la sorte de complicité entre l’homme et la femme. Le regard du maître qui analyse le corps et la manière de le lier, de le nouer, «où la corde doit passer et comment elle doit contraindre les formes». La concentration pour «poser» les liens de façon efficace, harmonieuse, esthétique, cette sorte de calligraphie de cordes cherchant à relier tous les points sensibles. L’origine du shibari est bien située du côté des arts martiaux, des pratiques judiciaires de contraintes et punition, d’une tradition des samouraïs d’exhiber ainsi des ennemis pour les libérer en les humiliant publiquement, et il y a bien, dans l’art des liens exercé ainsi, ce côté de domination. Mais en même temps, le film capte une sorte de dévotion, une sorte de culte rendu à la femme, par le tracé de la corde qui en contraint le corps. Dialectique de l’objet et sujet est portée subtilement à son comble. Il y a dans l’exécution de cet art à deux (le maître et ses cordes, la femme et le don de son corps) une beauté qui coupe le souffle et ravivent toutes les contradictions du sexe: domination, transgression, équilibre, harmonie partagée… Contradictions que la pornographie tranchent pour le toujours plus explicite, économie d’une masturbation contre l’angoisse du sexe. « Destricted » renouvelle un peu le mystère.
Pierre Hemptinne