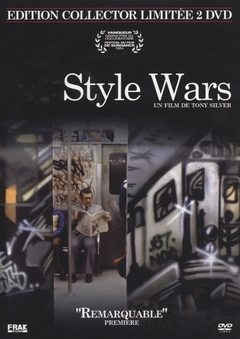U R B N N Y : Wild Style Wars

Peu de formes artistiques ont attiré autant de controverses que le graffiti. Aujourd’hui requalifié street art, il est entré dans les musées et les galeries, suscitant une nouvelle polémique quant à la légitimité de cette nouvelle acceptation, vue par certains, notamment par les artistes eux-mêmes comme une capitalisation sauvage, une récupération abusive. Pour beaucoup de gens par contre, la question ne se pose pas, estimant qu’il s’agit purement et simplement de vandalisme.
C’est ce même débat qui est posé, à 35 ans de distance, par le film Style Wars, de Tony Silver et Henry Chalfant. Documentaire diffusé dès 1983, et tourné un an avant, le film présente, dans une mise en scène à peine dramatisée, les débuts (et la fin pour certains) de la scène graffiti de New-York ainsi que ses liens avec le breakdance et le hip hop. C’est un document exceptionnel à plusieurs titres. Il montre un New-York oublié, une ville chaotique, à moitié en ruine, à mille lieues de l’image clinquante (et sécuritaire) actuelle. La bande son y ajoute une touche nostalgique, mais ne parvient pas à masquer les chancres, les immeubles délabrés. Le film montre la génération des pionniers, rassemblant une série de portraits (Kase 2, Skeme, Dondi, Seen ou encore Shy 147) qui font maintenant rêver les connaisseurs du genre. Il parvient même à s’introduire dans une réunion au sommet, où la plupart des adolescents rassemblés sont à présent des artistes reconnus.
Jamais un adulte ne mettrait autant d’énergie dans un truc qui ne rapporte pas d’argent. — -
Mais à l’époque, il s’agissait de très jeunes gens, presque des enfants parfois, officiant dans un genre pas encore codifié, inventant les règles au fur et à mesure. Leur statut était encore très vague, très incertain, et leurs activités étaient avant tout vues comme une forme de vandalisme. Pour une bonne partie de la population, le graffiti était une attaque contre l’espace public, une dégradation de l’habitat, une forme de violence contribuant à un climat d’insécurité. La police, plus sévère encore, avait à déplorer une perte de contrôle, assimilant les graffeurs à des casseurs de vitres ou à des voleurs à la tire.
On assiste très clairement à un conflit de génération, bien visible durant les scènes montrant le jeune Skeme, filmé dans un dialogue de sourds avec sa mère. Interrogé, le maire de New York de l’époque, Ed Koch, promet une répression sans pitié de ce « fléau ». La violence de la réaction des autorités, avec leurs sous-entendus racistes et leur prétention à défendre l’ordre établi contre la barbarie, fait par moment froid dans le dos. Pour eux, comme le dit la voix-off, il n’est pas question de savoir si le graffiti est un art ou une « peste sans fin », la question principale est d’y mettre un terme. Ce qui frappe avant tout dans le film, c’est la divergence entre le mépris des « adultes » et la clarté et l’éloquence des jeunes, dont les motivations apparaissent avec une précision et une conviction désarmantes.
On reconnaît un graffeur aux taches de peinture sur ses chaussures et à la manière dont il regarde les trains. — -
Une des institutions les plus véhémentes dans cet affrontement est la New York City Transit Authority, qui gère les rames de métro, cible de prédilection des graffeurs. Outre la simple fascination pour les trains, pour le gigantisme et la puissance des convois, l’idée de s’attaquer aux voitures répond à un but premier du tag et du graffiti. Il faut être vu et reconnu par tous, surtout par ses pairs: c’est une des justifications fondamentales du genre, de l’aveu même des acteurs. Ainsi les rames du métro fonctionnent comme des murs mobiles. Elles font circuler dessins et surtout signatures à travers toute la ville, là où une façade ne touche que ses voisins. Les dépôts sont l’objectif favori des artistes. Ils s’y introduisent illégalement, souvent de nuit, afin de disposer du temps nécessaire à des œuvres de grande envergure. Repérer ensuite le premier passage d’une nouvelle fresque mouvante est pour son auteur une immense source de joie et de fierté. C’est une vision que ne partage évidemment pas les gestionnaires du réseau, ni même ses employés, qui prennent la chose pour un affront personnel. Ils passent donc un temps non négligeable, et extrêmement coûteux, à nettoyer les dégâts. La fin du film montre les solutions les plus radicales : réseau entier couvert de peinture blanche, dépôts enfermés derrière deux murs de barbelés, protégés par des chiens.
Je ne savais pas que ça comptait autant pour eux, je croyais qu’ils écrivaient n’importe quoi. — -
La plupart des intervenants sont très conscients de l’ambiguïté de leur geste. Elle se retrouve dans le vocabulaire qu’ils utilisent, tour à tour guerrier (bombing, gangs, squads) ou artistique (ils se qualifient de writer, d’écrivain, et parle de « leur art »). Au départ simple affirmation d’une existence et d'une identité, le genre a évolué pour incorporer des ambitions esthétiques. Il n’est plus seulement question d’être le graffeur le plus présent ou celui qui prend le plus de risques, mais aussi d’être celui qui produit les œuvres les plus belles. Une vision presque unanime, à la seule exception, dans le documentaire, du dénommé CAP, sociopathe sans remords qui déclare la guerre à tous les autres, et recouvre leurs peintures. Pour lui le graffiti n’est pas un art mais une bataille individuelle. Il semble incarner une mentalité belliqueuse, typiquement américaine jusqu’à la caricature.
 Le film Style Wars est sorti
sur les écrans la même année que Wild Style de Charlie Ahearn, l’autre grand document (sous
une forme semi-fictionnelle) traitant de cette scène à cette époque, tourné,
lui, un an auparavant. Les deux films partagent un certain nombre de
protagonistes, bien que Wild Style se
veuille avant tout un film sur le hip hop. On retrouve le collectif de
breakdance The
Rock Steady Crew, The Cold Crush Brothers, Queen Lisa Lee de la Zulu Nation, et
Grandmaster Flash. Lee Quiñones et Fab Five Freddy y tiennent les rôles
principaux. L’histoire du tournage de ce film tient une place importante dans
la bande-dessinée Hip Hop Family Tree
de Ed Piskor qui montre déjà le mélange d’appréhension et d’orgueil des
artistes concernés, face à l’intérêt que leur porte la scène Downtown. Un
mélange de besoin de reconnaissance et d’appât du gain les pousse à accepter
les invitations à sortir de l’ombre. Mais à côté de l’enthousiasme sincère de
Debbie Harry et Chris Stein de Blondie, ou de Jean-Michel Basquiat, la
curiosité des maisons de disques pour le hip hop et l’attention apportée au
graffiti par les galeries et les collectionneurs d’art sont plus douteuses.
Le film Style Wars est sorti
sur les écrans la même année que Wild Style de Charlie Ahearn, l’autre grand document (sous
une forme semi-fictionnelle) traitant de cette scène à cette époque, tourné,
lui, un an auparavant. Les deux films partagent un certain nombre de
protagonistes, bien que Wild Style se
veuille avant tout un film sur le hip hop. On retrouve le collectif de
breakdance The
Rock Steady Crew, The Cold Crush Brothers, Queen Lisa Lee de la Zulu Nation, et
Grandmaster Flash. Lee Quiñones et Fab Five Freddy y tiennent les rôles
principaux. L’histoire du tournage de ce film tient une place importante dans
la bande-dessinée Hip Hop Family Tree
de Ed Piskor qui montre déjà le mélange d’appréhension et d’orgueil des
artistes concernés, face à l’intérêt que leur porte la scène Downtown. Un
mélange de besoin de reconnaissance et d’appât du gain les pousse à accepter
les invitations à sortir de l’ombre. Mais à côté de l’enthousiasme sincère de
Debbie Harry et Chris Stein de Blondie, ou de Jean-Michel Basquiat, la
curiosité des maisons de disques pour le hip hop et l’attention apportée au
graffiti par les galeries et les collectionneurs d’art sont plus douteuses.
Avec
à peine un an d’écart entre les deux films, le paysage qu’ils offrent a changé
énormément. C’est une preuve de plus de la vitesse accélérée avec laquelle les
mouvements artistiques évoluent de leur naissance à leur heure de gloire, et de
celle-ci au déclin. Style Wars montre
le graffiti à New-York dans ses dernières heures pionnières, et pointe du doigt
les causes de sa future chute : l’opposition de plus en plus répressive
des autorités et la cupidité des spéculateurs. Il y a une grande différence entre
les premiers tagueurs sauvages comme Taki183 ou Julio204 dans les années 1970,
et les graffeurs de la génération suivante. Mais il n’a pas fallu longtemps pour
voir apparaître dans les galeries les premières toiles inspirées du graffiti,
parfois réalisées par d’authentiques artistes de rue, parfois par des peintres
totalement extérieurs à la pratique. Bien sûr le graffiti ne s’est pas arrêté en 1983, et
son rayonnement a explosé bien au-delà de la scène new-yorkaise. Mais les
puristes, qui défendent l’idée du genre en tant qu’activité à la fois
dangereuse et héroïque, ont un regard plus pessimiste sur son évolution. Aujourd’hui
répandue à travers le monde, cette forme d’art s’est vue accorder une légitimité
avec le terme street art, qui
souligne lourdement son bon droit et son sérieux. Il n’est plus question pour
les musées d’imiter l’art de la rue mais bien ouvertement de s’en emparer, au
sens le plus brutal du terme, en s’offrant, sous couvert de conservation
patrimoniale, des morceaux de murs célèbres.
Benoit Deuxant
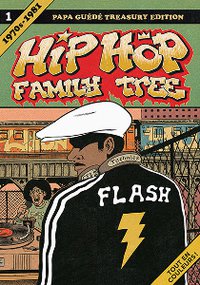 Ed Piskor: Hip Hop Family Tree - Volume 1, 1970s-1981
Ed Piskor: Hip Hop Family Tree - Volume 1, 1970s-1981traduction d'Hugo Ehrhard
ed. Papa Guédé, 2016
112 pages
Cet article fait partie du dossier New York.
Dans le même dossier :