Crise environnementale: le regard des écrivains
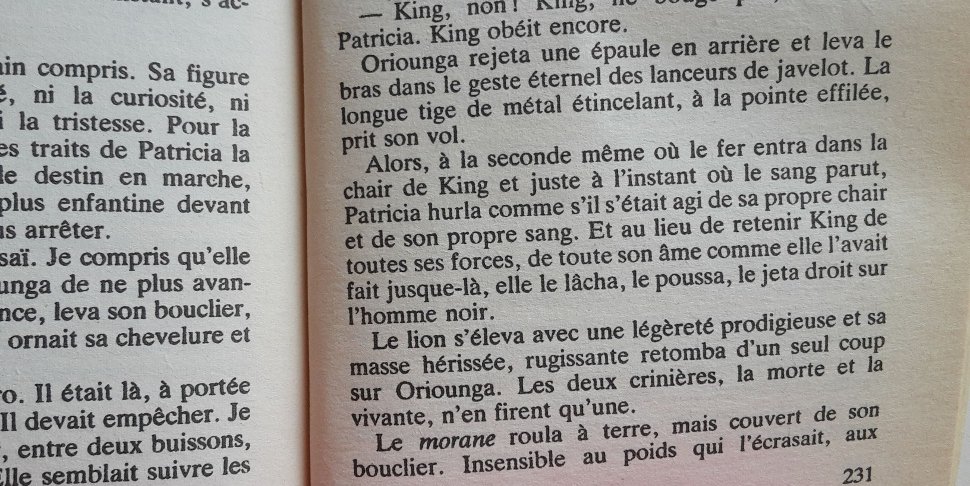
Sommaire
Ne manquez pas l'épisode précédent : La nature, ce qu'en font les écrivains
Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villes tentaculaires (1895), Emile Verhaeren
 Peu de choses, dans le paysage, trouvent grâce aux yeux d’Emile
Verhaeren, qui, lorsqu’il regarde la ville et ce qui, au-delà de ses murs,
reste des campagnes, voit se dresser partout les spectres de la technique
mortifère. Moderne quant au choix de ses sujets, le poète symboliste belge
l’est moins lorsqu’il considère le progrès comme destructeur de la puissance
individuelle et du lien social. « C’est la ville tentaculaire / La pieuvre
ardente et l’ossuaire. Debout / Au bout des plaines / Et des domaines. »
Peu de choses, dans le paysage, trouvent grâce aux yeux d’Emile
Verhaeren, qui, lorsqu’il regarde la ville et ce qui, au-delà de ses murs,
reste des campagnes, voit se dresser partout les spectres de la technique
mortifère. Moderne quant au choix de ses sujets, le poète symboliste belge
l’est moins lorsqu’il considère le progrès comme destructeur de la puissance
individuelle et du lien social. « C’est la ville tentaculaire / La pieuvre
ardente et l’ossuaire. Debout / Au bout des plaines / Et des domaines. »
La Terre, Emile Zola, 1887
 En inscrivant le monde paysan de son siècle au milieu de sa grande
fresque consacrée à ses contemporains, Zola fait de nous, par la puissance de
sa langue et la droiture de son propos, les témoins de la naissance du monde
industriel. Une telle représentation a beau venir chargée de signes
d’inquiétude, les motifs de celle-ci – violence, injustice, misère, maltraitance
des bêtes – sont aujourd’hui portés à un
tel degré d’horreur que leur forme originelle en ressort, par comparaison, presque
supportable. Déjà à la fin du XIXème siècle, le travail de la terre offre aux
hommes bien des occasions de se haïr et de s’entredéchirer, mais pas au point
de la détruire, elle, leur unique ressource. Mais c’est dans leur acharnement, cette
violence qui les consume, à vouloir tirer de la terre, non pas des nourritures,
mais de l’argent, que l’on voit poindre le modèle productiviste actuel.
En inscrivant le monde paysan de son siècle au milieu de sa grande
fresque consacrée à ses contemporains, Zola fait de nous, par la puissance de
sa langue et la droiture de son propos, les témoins de la naissance du monde
industriel. Une telle représentation a beau venir chargée de signes
d’inquiétude, les motifs de celle-ci – violence, injustice, misère, maltraitance
des bêtes – sont aujourd’hui portés à un
tel degré d’horreur que leur forme originelle en ressort, par comparaison, presque
supportable. Déjà à la fin du XIXème siècle, le travail de la terre offre aux
hommes bien des occasions de se haïr et de s’entredéchirer, mais pas au point
de la détruire, elle, leur unique ressource. Mais c’est dans leur acharnement, cette
violence qui les consume, à vouloir tirer de la terre, non pas des nourritures,
mais de l’argent, que l’on voit poindre le modèle productiviste actuel.
Robinson Crusoe, Daniel Defoe, 1719
Vendredi ou les limbes du Pacifique, Michel Tournier, 1967
Sa Majesté des mouches, de William Golding, 1954
 Ayant réussi, après un naufrage en pleine mer, à survivre dans un milieu
originellement hostile à sa présence, Robinson Crusoé est l’exemple même du
héros dont, trois siècles après son apparition sous la plume de Daniel Defoe, il
faut remettre en doute le culte. Ses qualités bien qu’incontestables de ruse et
d’intelligence demeurent celles du pionnier qui, en terre inconnue, étrangère, inhabitée
ou sauvage, prend triomphalement possession de ce qui l’entoure malgré de
moindres aptitudes physiques grâce à une discipline et des facultés d’organisation
qui lui donnent l’avantage sur la faune et la flore locale. Sur son exemple se
voit donc mis en avant un type de rapport avec la nature qui passe nécessairement
par la domination et l’appropriation. Ses aventures sur l’île déserte, une
succession de problèmes à résoudre, d’affrontements, de conquêtes, ont ceci de
sublime qu’elles dépassent de loin ce que requiert la survie. Elles engagent un
excès, une ivresse de l’efficacité, une apologie de la technique, et sous cet
excès, cette ivresse, cette célébration, les valeurs de l’homme blanc
occidental. Le terme « robinsonnade » rallie sous la bannière du
genre tous ceux qui, dans la littérature puis au cinéma, sur le modèle du héros
de Daniel Defoe, se sont retrouvés dans une situation semblable, celle de
l’homme civilisé qui, dans la détresse, parvient à se sauver lui-même et avec
cela, l’idée même de civilisation. Il semble qu’à cet égard, la version que
donne Michel Tournier de ce personnage soit suffisamment profonde et
suffisamment clivée pour laisser le doute s’insinuer quant au bien-fondé de ses
actions. Ainsi en va-t-il également d’un autre roman relatant des faits
similaires sur fond de naufrage et de lutte pour la survie, mettant, lui, en
jeu, un groupe d’enfants : Sa
Majesté des mouches, de William Golding (1954).
Ayant réussi, après un naufrage en pleine mer, à survivre dans un milieu
originellement hostile à sa présence, Robinson Crusoé est l’exemple même du
héros dont, trois siècles après son apparition sous la plume de Daniel Defoe, il
faut remettre en doute le culte. Ses qualités bien qu’incontestables de ruse et
d’intelligence demeurent celles du pionnier qui, en terre inconnue, étrangère, inhabitée
ou sauvage, prend triomphalement possession de ce qui l’entoure malgré de
moindres aptitudes physiques grâce à une discipline et des facultés d’organisation
qui lui donnent l’avantage sur la faune et la flore locale. Sur son exemple se
voit donc mis en avant un type de rapport avec la nature qui passe nécessairement
par la domination et l’appropriation. Ses aventures sur l’île déserte, une
succession de problèmes à résoudre, d’affrontements, de conquêtes, ont ceci de
sublime qu’elles dépassent de loin ce que requiert la survie. Elles engagent un
excès, une ivresse de l’efficacité, une apologie de la technique, et sous cet
excès, cette ivresse, cette célébration, les valeurs de l’homme blanc
occidental. Le terme « robinsonnade » rallie sous la bannière du
genre tous ceux qui, dans la littérature puis au cinéma, sur le modèle du héros
de Daniel Defoe, se sont retrouvés dans une situation semblable, celle de
l’homme civilisé qui, dans la détresse, parvient à se sauver lui-même et avec
cela, l’idée même de civilisation. Il semble qu’à cet égard, la version que
donne Michel Tournier de ce personnage soit suffisamment profonde et
suffisamment clivée pour laisser le doute s’insinuer quant au bien-fondé de ses
actions. Ainsi en va-t-il également d’un autre roman relatant des faits
similaires sur fond de naufrage et de lutte pour la survie, mettant, lui, en
jeu, un groupe d’enfants : Sa
Majesté des mouches, de William Golding (1954).
Les Raisins de la colère, John Steinbeck, 1939
 Épousant le point de vue d’une famille de fermiers chassés de leur terre
pendant la Grande Dépression, ce récit d’un exode vers la Californie lève un
voile sévère sur la situation du monde agricole en Amérique au début de l’ère
industrielle. Aux périodes de sécheresse qui accablent une terre déjà très appauvrie
par le manque de rotation des cultures s’ajoutent la mécanisation progressive
du travail réclamant des investissements coûteux qui auront bientôt raison des
petits propriétaires endettés. Le faible rendement de leurs terres ne leur autorisant
pas d'investir dans les nouvelles technologies, ceux-ci s’en vont chercher
fortune ailleurs sans se douter qu’ils sont ainsi des milliers à tenter de
survivre, à offrir leur services sur des propriétés en voie de se passer tout à
fait d’une main d’œuvre aussi vulnérable que dispensable. Centré sur le devenir
moral de l’homme dans une économie qui le nie, ce document qui figure parmi les
toutes grandes œuvres de la littérature américaine expose la violence d’un
système qui, sur l’argument de nourrir le plus grand nombre, finit par affamer
ceux qui s’emploient à le faire fonctionner. Après avoir été fixée au cinéma
par John Ford l’image d’une jeune femme offrant le sein à un homme tout aussi
démuni qu’elle reste gravée dans les esprits.
Épousant le point de vue d’une famille de fermiers chassés de leur terre
pendant la Grande Dépression, ce récit d’un exode vers la Californie lève un
voile sévère sur la situation du monde agricole en Amérique au début de l’ère
industrielle. Aux périodes de sécheresse qui accablent une terre déjà très appauvrie
par le manque de rotation des cultures s’ajoutent la mécanisation progressive
du travail réclamant des investissements coûteux qui auront bientôt raison des
petits propriétaires endettés. Le faible rendement de leurs terres ne leur autorisant
pas d'investir dans les nouvelles technologies, ceux-ci s’en vont chercher
fortune ailleurs sans se douter qu’ils sont ainsi des milliers à tenter de
survivre, à offrir leur services sur des propriétés en voie de se passer tout à
fait d’une main d’œuvre aussi vulnérable que dispensable. Centré sur le devenir
moral de l’homme dans une économie qui le nie, ce document qui figure parmi les
toutes grandes œuvres de la littérature américaine expose la violence d’un
système qui, sur l’argument de nourrir le plus grand nombre, finit par affamer
ceux qui s’emploient à le faire fonctionner. Après avoir été fixée au cinéma
par John Ford l’image d’une jeune femme offrant le sein à un homme tout aussi
démuni qu’elle reste gravée dans les esprits.
Le Lion, Joseph Kessel, 1958
 L’amitié extraordinaire qui lie le lion King à Patricia, dix ans, et
l’admirable leçon de vie que l’on a voulu en dégager font de ce roman un
ouvrage que l’on destine habituellement à la jeunesse, une lecture dite
scolaire qu’il faudrait oublier ensuite, n’étant pas censée survivre à un
regard adulte. Il y a néanmoins, dans cette histoire dont l’issue, on le sait
bien, ne peut être que malheureuse, une réelle lucidité quant à l’avenir des
rapports de l’homme avec les animaux sauvages. Il y a une communication
possible, nous dit Kessel, entre des êtres très différents : parents et
enfants, hommes noirs et hommes blancs, humains et non-humains. Mais lorsque
les lois naturelles viennent mettre en péril celles des hommes, ce sont ces
dernières qui prévalent. Comme toute grande tragédie, celle-ci se trame d’une
succession d’erreurs et de fautes, de mauvaises décisions prises dans
l’étranglement d’un milieu qui prive les hommes, sinon de recourir à leur libre
arbitre, au moins d’avoir accès à la meilleure part d’eux-mêmes. De quelque
manière que l’on défasse le nœud du drame, tout le monde est coupable et tout
le monde est innocent. La réserve naturelle kenyane où se déroule l’action a
beau accueillir une version adoucie de ce qui ailleurs prendra des formes plus
terribles, c’est un terrain propice au drame, une aberration tout comme l’est
l’Afrique colonisée, continent ployant sous la menace de lois, de principes,
d’agencements qui ne sont pas les siens et ne lui conviennent pas, qui
trahissent sa propre intelligence et celle des populations humaines et
non-humaines qui la peuplent.
L’amitié extraordinaire qui lie le lion King à Patricia, dix ans, et
l’admirable leçon de vie que l’on a voulu en dégager font de ce roman un
ouvrage que l’on destine habituellement à la jeunesse, une lecture dite
scolaire qu’il faudrait oublier ensuite, n’étant pas censée survivre à un
regard adulte. Il y a néanmoins, dans cette histoire dont l’issue, on le sait
bien, ne peut être que malheureuse, une réelle lucidité quant à l’avenir des
rapports de l’homme avec les animaux sauvages. Il y a une communication
possible, nous dit Kessel, entre des êtres très différents : parents et
enfants, hommes noirs et hommes blancs, humains et non-humains. Mais lorsque
les lois naturelles viennent mettre en péril celles des hommes, ce sont ces
dernières qui prévalent. Comme toute grande tragédie, celle-ci se trame d’une
succession d’erreurs et de fautes, de mauvaises décisions prises dans
l’étranglement d’un milieu qui prive les hommes, sinon de recourir à leur libre
arbitre, au moins d’avoir accès à la meilleure part d’eux-mêmes. De quelque
manière que l’on défasse le nœud du drame, tout le monde est coupable et tout
le monde est innocent. La réserve naturelle kenyane où se déroule l’action a
beau accueillir une version adoucie de ce qui ailleurs prendra des formes plus
terribles, c’est un terrain propice au drame, une aberration tout comme l’est
l’Afrique colonisée, continent ployant sous la menace de lois, de principes,
d’agencements qui ne sont pas les siens et ne lui conviennent pas, qui
trahissent sa propre intelligence et celle des populations humaines et
non-humaines qui la peuplent.
Le Mur invisible, Marlen Haushofer, 1963
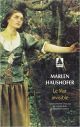 Bien sûr rien n’est dit clairement : à la présence inouïe d’un mur invisible
dont on ne peut savoir ni où il commence ni où il s’arrête et qui, surgi aussi
soudainement qu’irréfutablement, au milieu de cette paisible région des pré-Alpes
autrichiennes, constitue désormais une limite infranchissable, il n’y a pas
d’explications, pas d’explications certaines du moins, mais des hypothèses oui,
comme celle d’une catastrophe naturelle inédite, d’un accident industriel ou l’explosion
d’une bombe d’un genre nouveau, hypothèses que la narratrice, se découvrant
dans la panique d’un jeune matin prisonnière de cet enclos terrifiant, a tôt
fait de chasser de son esprit au profit du constat que, toute vie ayant été
éradiquée de la planète hormis là où elle se trouve, personne ne viendra la
sauver et que par conséquent, elle se doit, à elle-même comme à l’espèce
humaine, d’organiser sa survie. Pour l’y aider, elle peut tout de même compter
sur la compagnie, fragile mais fidèle, d’une vache, fort heureusement pleine,
d’un chien et d’une chatte. Avec le travail de la terre, ces animaux
représenteront pour la narratrice tant une source de travail que d’inquiétude,
autant de joie que d’amour, toutes choses qui la retiendront de sombrer dans la
folie. Sur une intrigue qui progresse lentement, et qui toute austère et
frustre qu’elle puisse sembler, sait simplement se montrer fidèle au rythme des
saisons, se cachant presque, comme la vie ordinaire, de s’acheminer vers une
fin furieuse, se dessine une relation avec la nature et les bêtes qui, pour
n’avoir rien d’original à inscrire au tableau des rapports entre l’humain, le
sol qu’il colonise et les êtres qu’il soumet, repose néanmoins les fondamentaux
d’une entente harmonieuse et, pourvu qu’aucun élément hostile ne vienne la
troubler, durable.
Bien sûr rien n’est dit clairement : à la présence inouïe d’un mur invisible
dont on ne peut savoir ni où il commence ni où il s’arrête et qui, surgi aussi
soudainement qu’irréfutablement, au milieu de cette paisible région des pré-Alpes
autrichiennes, constitue désormais une limite infranchissable, il n’y a pas
d’explications, pas d’explications certaines du moins, mais des hypothèses oui,
comme celle d’une catastrophe naturelle inédite, d’un accident industriel ou l’explosion
d’une bombe d’un genre nouveau, hypothèses que la narratrice, se découvrant
dans la panique d’un jeune matin prisonnière de cet enclos terrifiant, a tôt
fait de chasser de son esprit au profit du constat que, toute vie ayant été
éradiquée de la planète hormis là où elle se trouve, personne ne viendra la
sauver et que par conséquent, elle se doit, à elle-même comme à l’espèce
humaine, d’organiser sa survie. Pour l’y aider, elle peut tout de même compter
sur la compagnie, fragile mais fidèle, d’une vache, fort heureusement pleine,
d’un chien et d’une chatte. Avec le travail de la terre, ces animaux
représenteront pour la narratrice tant une source de travail que d’inquiétude,
autant de joie que d’amour, toutes choses qui la retiendront de sombrer dans la
folie. Sur une intrigue qui progresse lentement, et qui toute austère et
frustre qu’elle puisse sembler, sait simplement se montrer fidèle au rythme des
saisons, se cachant presque, comme la vie ordinaire, de s’acheminer vers une
fin furieuse, se dessine une relation avec la nature et les bêtes qui, pour
n’avoir rien d’original à inscrire au tableau des rapports entre l’humain, le
sol qu’il colonise et les êtres qu’il soumet, repose néanmoins les fondamentaux
d’une entente harmonieuse et, pourvu qu’aucun élément hostile ne vienne la
troubler, durable.
La Supplication, Svetlana Alexievitch, 1997
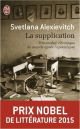 Née en Biélorussie, non loin de Tchernobyl, Svetlana Alexievitch a mené
une enquête de dix ans auprès des populations touchées par la catastrophe qui,
la nuit du 26 avril 1986, a transformé un immense territoire en zone sinistrée,
répandant sur elle un voile mortel de pollution qui ne se lèvera pas avant
plusieurs siècles. Partie recueillir des témoignages auprès des liquidateurs,
de leur famille, des citoyens ordinaires expulsés de chez eux, des médecins,
mais aussi les politiciens et les scientifiques, l’auteur, qui fut journaliste avant
d’assumer son statut d’écrivain, récemment couronnée du prix Nobel de
littérature, dresse le tableau éperdu d’une humanité sacrifiée et impuissante
quant à son propre potentiel de destruction.
Née en Biélorussie, non loin de Tchernobyl, Svetlana Alexievitch a mené
une enquête de dix ans auprès des populations touchées par la catastrophe qui,
la nuit du 26 avril 1986, a transformé un immense territoire en zone sinistrée,
répandant sur elle un voile mortel de pollution qui ne se lèvera pas avant
plusieurs siècles. Partie recueillir des témoignages auprès des liquidateurs,
de leur famille, des citoyens ordinaires expulsés de chez eux, des médecins,
mais aussi les politiciens et les scientifiques, l’auteur, qui fut journaliste avant
d’assumer son statut d’écrivain, récemment couronnée du prix Nobel de
littérature, dresse le tableau éperdu d’une humanité sacrifiée et impuissante
quant à son propre potentiel de destruction.
La Possibilité d’une île, Michel Houellebecq, 2005
 En faisant de Daniel, né au XXIème siècle, le narrateur de sa propre
vie, récit que reprennent ensuite les vingt-cinq clones successifs de ce
premier personnage, Houellebecq conduit une saga qui s’étend sur près de deux
mille ans. S’il s’agit encore pour l’auteur de s’enfermer dans ses obsessions réactionnaires
(romantisme déçu, adoration canine, solitude existentielle, faillite des
grandes religions), son pessimisme se projette cette fois sur un fond plus
vaste et peut-être plus profond, si l’on veut bien rendre à ce mot son sens
spatial. D’une histoire qui embrasse l’avenir avec autant de détails que de
pusillanimité se dégage l’inverse d’un catastrophisme environnemental. L’auteur
prête en effet sa voix à celle d’un scientisme confiant et instruit qui, face
aux menaces que l’épuisement des ressources et la pollution font porter sur
l’avenir de la planète, ne doute pas que le progrès des techniques permettra de
sauver ce qui doit l’être. Une nouvelle source d’énergie remplacera
opportunément celles qui se seront taries, le clonage apportera un remède à
l’épuisement de l’amour. Les motifs de désespoir sont donc à chercher ailleurs,
moins dans l’avenir de la planète qu’au plus près de l’homme, dans quelques
derniers soubresauts existentiels de sa chair clonée, dans son corps
incroyablement performant maintenant que le voilà débarrassé de ses désirs et
peut-être du même coup de ses excès. Sur ce constat, dans la veine des
contre-utopistes du siècle passé, Wells, Huxley, Orwell, Zamiatine, Witkiewicz,
pour ne citer que les plus célèbres, Houellebecq ne prédit rien moins que la
fin de l’humanité – du moins telle qu’on l’entend encore aujourd’hui.
En faisant de Daniel, né au XXIème siècle, le narrateur de sa propre
vie, récit que reprennent ensuite les vingt-cinq clones successifs de ce
premier personnage, Houellebecq conduit une saga qui s’étend sur près de deux
mille ans. S’il s’agit encore pour l’auteur de s’enfermer dans ses obsessions réactionnaires
(romantisme déçu, adoration canine, solitude existentielle, faillite des
grandes religions), son pessimisme se projette cette fois sur un fond plus
vaste et peut-être plus profond, si l’on veut bien rendre à ce mot son sens
spatial. D’une histoire qui embrasse l’avenir avec autant de détails que de
pusillanimité se dégage l’inverse d’un catastrophisme environnemental. L’auteur
prête en effet sa voix à celle d’un scientisme confiant et instruit qui, face
aux menaces que l’épuisement des ressources et la pollution font porter sur
l’avenir de la planète, ne doute pas que le progrès des techniques permettra de
sauver ce qui doit l’être. Une nouvelle source d’énergie remplacera
opportunément celles qui se seront taries, le clonage apportera un remède à
l’épuisement de l’amour. Les motifs de désespoir sont donc à chercher ailleurs,
moins dans l’avenir de la planète qu’au plus près de l’homme, dans quelques
derniers soubresauts existentiels de sa chair clonée, dans son corps
incroyablement performant maintenant que le voilà débarrassé de ses désirs et
peut-être du même coup de ses excès. Sur ce constat, dans la veine des
contre-utopistes du siècle passé, Wells, Huxley, Orwell, Zamiatine, Witkiewicz,
pour ne citer que les plus célèbres, Houellebecq ne prédit rien moins que la
fin de l’humanité – du moins telle qu’on l’entend encore aujourd’hui.
La Route, Cormac McCarthy, 2006
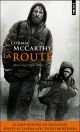 L’épisode le plus emblématique de ce roman d’anticipation devenu en
moins de temps qu’il ne faut pour le dire un best-seller et un film avec la
star du moment, pourrait, à mes yeux, remettre en cause sa charge dénonciatrice
contre la société de consommation. L’action se situe dans un monde
post-apocalyptique. Un père et son fils tentent de survivre en échappant aux
hordes d’hommes redevenus sauvages voire cannibales, tâchant de trouver
eux-mêmes à se nourrir de façon pacifique. Et voilà que leur errance les
conduit jusqu’à une cannette de Coca-Cola, la marque étant citée de façon
claire et délibérée. Le père offre le breuvage à l’enfant qui, né après la
catastrophe, n’en a jamais bu de sa vie. Celui-ci le trouve délicieux. S’ensuit
d’après mes souvenirs un éloge des plus inspirés dont on se demande s’il ne
s’agirait pas plutôt de célébrer les vertus d’un grand vin, fruit d’un savoir-faire
précieux devenu obsolète sur une terre où plus rien ne pousse. Mais non,
l’élixir porte le nom de Coca-Cola, emblème de la trash-food, ce que l’industrie américaine a pu produire de pire au
XXème siècle. Alors, je me demande si l’horreur dont La Route nous dresse un tableau ému ne tient pas moins à décrire en
toute connaissance de cause un état de catastrophe dont l’humanité se sentirait
responsable qu’à regretter, au fond, tout ce qui a été perdu, et qui
relèverait autant des richesses de la nature que de ce que l’homme, en dépit de
son caractère déraisonnable, a inventé en terme de confort et de plaisirs, la
suavité du Coca-Cola par exemple?
L’épisode le plus emblématique de ce roman d’anticipation devenu en
moins de temps qu’il ne faut pour le dire un best-seller et un film avec la
star du moment, pourrait, à mes yeux, remettre en cause sa charge dénonciatrice
contre la société de consommation. L’action se situe dans un monde
post-apocalyptique. Un père et son fils tentent de survivre en échappant aux
hordes d’hommes redevenus sauvages voire cannibales, tâchant de trouver
eux-mêmes à se nourrir de façon pacifique. Et voilà que leur errance les
conduit jusqu’à une cannette de Coca-Cola, la marque étant citée de façon
claire et délibérée. Le père offre le breuvage à l’enfant qui, né après la
catastrophe, n’en a jamais bu de sa vie. Celui-ci le trouve délicieux. S’ensuit
d’après mes souvenirs un éloge des plus inspirés dont on se demande s’il ne
s’agirait pas plutôt de célébrer les vertus d’un grand vin, fruit d’un savoir-faire
précieux devenu obsolète sur une terre où plus rien ne pousse. Mais non,
l’élixir porte le nom de Coca-Cola, emblème de la trash-food, ce que l’industrie américaine a pu produire de pire au
XXème siècle. Alors, je me demande si l’horreur dont La Route nous dresse un tableau ému ne tient pas moins à décrire en
toute connaissance de cause un état de catastrophe dont l’humanité se sentirait
responsable qu’à regretter, au fond, tout ce qui a été perdu, et qui
relèverait autant des richesses de la nature que de ce que l’homme, en dépit de
son caractère déraisonnable, a inventé en terme de confort et de plaisirs, la
suavité du Coca-Cola par exemple?
Défaite des maîtres et possesseurs, Vincent Message, 2015
 Avec ce livre écrit par un auteur engagé pour la cause animale, il faut
bien parler de pitch, car en vérité
l’intrigue part d’un postulat qui ne laisse pas le hasard s’emparer de son
déroulement, de fait, très programmatique : dans un futur proche, une
population extraterrestre a pris le pouvoir sur un monde abîmé et
considérablement appauvri. Pour assurer sa subsistance, il semble que les
envahisseurs n’aient guère eu d’autre choix que de se mettre à manger les
hommes, à consommer leur chair sous diverses manières et dans diverses qualités
et, à cette fin, de pratiquer un nouveau type d’élevage, lequel paraîtra des
plus sordides à un lecteur pourtant prêt à considérer cette pratique comme
normale, saine et légitime dès lors qu’elle concerne toute autre espèce que la
sienne. Ainsi, par ce simple renversement annoncé sans fards dans le titre et inscrit
dans une intrigue aussi glaçante que mouvementée, l’auteur se fait fort d’interroger
notre regard sur l’alimentation carnée, ce qu’elle implique comme injustices
sociales, comme forme de société, mais aussi en mauvais traitements sur des
êtres sensibles, humains et non-humains, et pour finir, en dégâts sur l’environnement.
Telle est la réponse que l’auteur adresse à Descartes dont l’injonction
« Rendons-nous maîtres et possesseurs de la nature. », prononcée il y
a quatre siècles, prospère encore aujourd’hui.
Avec ce livre écrit par un auteur engagé pour la cause animale, il faut
bien parler de pitch, car en vérité
l’intrigue part d’un postulat qui ne laisse pas le hasard s’emparer de son
déroulement, de fait, très programmatique : dans un futur proche, une
population extraterrestre a pris le pouvoir sur un monde abîmé et
considérablement appauvri. Pour assurer sa subsistance, il semble que les
envahisseurs n’aient guère eu d’autre choix que de se mettre à manger les
hommes, à consommer leur chair sous diverses manières et dans diverses qualités
et, à cette fin, de pratiquer un nouveau type d’élevage, lequel paraîtra des
plus sordides à un lecteur pourtant prêt à considérer cette pratique comme
normale, saine et légitime dès lors qu’elle concerne toute autre espèce que la
sienne. Ainsi, par ce simple renversement annoncé sans fards dans le titre et inscrit
dans une intrigue aussi glaçante que mouvementée, l’auteur se fait fort d’interroger
notre regard sur l’alimentation carnée, ce qu’elle implique comme injustices
sociales, comme forme de société, mais aussi en mauvais traitements sur des
êtres sensibles, humains et non-humains, et pour finir, en dégâts sur l’environnement.
Telle est la réponse que l’auteur adresse à Descartes dont l’injonction
« Rendons-nous maîtres et possesseurs de la nature. », prononcée il y
a quatre siècles, prospère encore aujourd’hui.
Crue, Philippe Forest, 2016
 À qui s’étonnerait de voir figurer sur cette liste le nom d’un auteur
davantage connu pour ses récits intimes que pour sa verve romanesque, je dirais
que Philippe Forest se trouve être celui qui, pour cette raison-là, remplit le
plus légitimement sa place dans une telle sélection. Pourquoi ? D’abord
parce que, s’agissant de témoignage, quoique loin d’être exempt de références à
la propre histoire de l’auteur, Crue a
la substance d’un roman, c’est-à-dire une intrigue, du suspense et des
personnages, arsenal sommaire d’une œuvre d’invention, et ici, d’anticipation.
Ensuite parce que la juxtaposition d’éléments autobiographiques et fictionnels
confèrent à ces derniers une force d’inquiétude supplémentaire, il en va d’eux comme
de soucis réels, graves, profonds que seul le rêve et, en l’occurrence la
fiction, ont le pouvoir de porter au grand jour, ceci bien entendu sans leur
offrir une issue. Aussi Philippe Forest n’hésite-t-il pas à se jouer de la
polysémie du mot « crue » en chargeant ce terme de porter une interrogation
sur la croyance ainsi que tout le champ lexical qu’on peut lui associer :
intuition, clairvoyance, déni, comme, plus prosaïquement, d’annoncer le contenu
effectif du livre, contenu qui nous intéresse au premier chef puisqu’il s’agit
d’une sorte d’apocalypse voire donc, de la fin du monde. Ce déluge, nous
apprend très tôt le narrateur, ne vient
pas autrement que pour porter le coup de grâce à un monde déjà défait,
désuni et déliquescent, un monde pollué, socialement meurtri, biologiquement
malade. Sans doute faut-il voir dans une telle conclusion (punitive ?) la
résurgence de l’épisode biblique de Noé, mais, d’une décourageante évidence, cette
filiation n’est dans mon souvenir pas énoncée. Le texte met plutôt en avant son
ancrage dans un monde très contemporain, une ville sans nom mais qui, décrite
dans le détail, semblerait tristement familière, avec ce soupçon d’universalité
qui la rendrait conforme à n’importe quelle mégapole actuelle courant le risque
de se voir un jour envahir par une puissance, peut-on encore dire,
naturelle ?, qui, à l’exemple de la pluie, n’aurait rien de purificateur.
À qui s’étonnerait de voir figurer sur cette liste le nom d’un auteur
davantage connu pour ses récits intimes que pour sa verve romanesque, je dirais
que Philippe Forest se trouve être celui qui, pour cette raison-là, remplit le
plus légitimement sa place dans une telle sélection. Pourquoi ? D’abord
parce que, s’agissant de témoignage, quoique loin d’être exempt de références à
la propre histoire de l’auteur, Crue a
la substance d’un roman, c’est-à-dire une intrigue, du suspense et des
personnages, arsenal sommaire d’une œuvre d’invention, et ici, d’anticipation.
Ensuite parce que la juxtaposition d’éléments autobiographiques et fictionnels
confèrent à ces derniers une force d’inquiétude supplémentaire, il en va d’eux comme
de soucis réels, graves, profonds que seul le rêve et, en l’occurrence la
fiction, ont le pouvoir de porter au grand jour, ceci bien entendu sans leur
offrir une issue. Aussi Philippe Forest n’hésite-t-il pas à se jouer de la
polysémie du mot « crue » en chargeant ce terme de porter une interrogation
sur la croyance ainsi que tout le champ lexical qu’on peut lui associer :
intuition, clairvoyance, déni, comme, plus prosaïquement, d’annoncer le contenu
effectif du livre, contenu qui nous intéresse au premier chef puisqu’il s’agit
d’une sorte d’apocalypse voire donc, de la fin du monde. Ce déluge, nous
apprend très tôt le narrateur, ne vient
pas autrement que pour porter le coup de grâce à un monde déjà défait,
désuni et déliquescent, un monde pollué, socialement meurtri, biologiquement
malade. Sans doute faut-il voir dans une telle conclusion (punitive ?) la
résurgence de l’épisode biblique de Noé, mais, d’une décourageante évidence, cette
filiation n’est dans mon souvenir pas énoncée. Le texte met plutôt en avant son
ancrage dans un monde très contemporain, une ville sans nom mais qui, décrite
dans le détail, semblerait tristement familière, avec ce soupçon d’universalité
qui la rendrait conforme à n’importe quelle mégapole actuelle courant le risque
de se voir un jour envahir par une puissance, peut-on encore dire,
naturelle ?, qui, à l’exemple de la pluie, n’aurait rien de purificateur.
Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo, 2016
 Si tout, dans cette histoire, plaide pour la métaphore, le tableau que
Jean-Baptiste Del Amo dresse d’un élevage porcin français se veut exact et précis,
au fond moins une métaphore du système productiviste actuel qu’une métonymie de
la société tout entière. Sur une intrigue familiale s’étalant sur plusieurs
générations et qui embrasse la totalité du XXème siècle, l’idée se fait qu’un
même sort unit les exploitants et les exploités, les bêtes et les hommes.
Ceux-ci, en dépit de leur statut, n’en sont pas moins également, des victimes.
Selon une logique déjà exposée par Kafka dans La Colonie pénitentiaire, un système conçu pour détruire risque
avant tout de détruire celui qui en use. Des maux innombrables tels que le cancer,
l’alcoolisme, la dépression, toutes les formes de violence morale et physique, la
brutale dégradation de l’environnement et celle, plus insidieuse, de la santé
publique, la pollution, la solitude viennent comme la conséquence de pratiques
absurdes au regard de l’écologie du vivant. Sur ce constat, s’inscrivant à la
suite de Zola par le style et par la représentation sans concession du monde
paysan, le pessimisme de Jean-Baptiste Del Amo ne se raccroche pas à la
croyance qu’il y aurait eu, avant l’ère industrielle, une vie paysanne
heureuse, une forme d’exploitation heureuse. Avec une radicalité assumée, c’est
l’essence même de l’élevage qu’il interroge, étant déjà persuadé qu’un principe
qui a pour fin la mort contient en germe toute la déchéance du monde.
Si tout, dans cette histoire, plaide pour la métaphore, le tableau que
Jean-Baptiste Del Amo dresse d’un élevage porcin français se veut exact et précis,
au fond moins une métaphore du système productiviste actuel qu’une métonymie de
la société tout entière. Sur une intrigue familiale s’étalant sur plusieurs
générations et qui embrasse la totalité du XXème siècle, l’idée se fait qu’un
même sort unit les exploitants et les exploités, les bêtes et les hommes.
Ceux-ci, en dépit de leur statut, n’en sont pas moins également, des victimes.
Selon une logique déjà exposée par Kafka dans La Colonie pénitentiaire, un système conçu pour détruire risque
avant tout de détruire celui qui en use. Des maux innombrables tels que le cancer,
l’alcoolisme, la dépression, toutes les formes de violence morale et physique, la
brutale dégradation de l’environnement et celle, plus insidieuse, de la santé
publique, la pollution, la solitude viennent comme la conséquence de pratiques
absurdes au regard de l’écologie du vivant. Sur ce constat, s’inscrivant à la
suite de Zola par le style et par la représentation sans concession du monde
paysan, le pessimisme de Jean-Baptiste Del Amo ne se raccroche pas à la
croyance qu’il y aurait eu, avant l’ère industrielle, une vie paysanne
heureuse, une forme d’exploitation heureuse. Avec une radicalité assumée, c’est
l’essence même de l’élevage qu’il interroge, étant déjà persuadé qu’un principe
qui a pour fin la mort contient en germe toute la déchéance du monde.
Catherine De Poortere