« Ils existent à trois kilomètres des Champs Élysées. »

Sommaire
Comme la photographie, l’enregistrement sonore, la coupure de presse ou d’autres artefacts de l’ère de la reproductibilité mécanique, l’image de cinéma (ou de télévision) est fréquemment utilisée pour lutter contre l’oubli, remonter le cours du temps. Des cinéastes ont eu la prémonition de la disparition prochaine de pans entiers de l’histoire humaine (rites, gestes artisanaux, accès aux témoins d’événements historiques importants, etc.) et ont voulu en garder une trace avant qu’il ne soit trop tard.
Mais si les images en mouvement peuvent être le socle de la mémoire, elles en sont aussi une sorte de négation qui plane en permanence au-dessus de nos souvenirs. Par une sorte de soupçon quant à notre capacité à nous remémorer les choses ou à les raconter sans béquilles mémorielles, les images se parent régulièrement du rôle de preuves. Il faut voir pour croire, regarder pour se remémorer. Souvent, le simple fait d’exister confère aux images – à l’enregistrement d’une parole, d’un lieu ou d’un geste – le statut de document historique.
Et dans ce lien entre le cinéma, le réel et le temps qui passe, un sous-genre du cinéma documentaire consiste pour certains cinéastes à remonter la trace d’un film antérieur – à revenir sur ses lieux de tournage, à en retrouver les protagonistes – comme pour voir comment le temps a fait son œuvre.
Le passé du retour sur images de Robert Bozzi
Un kilomètre à vol d’oiseau derrière la basilique des rois de France et la Maison d’éducation des jeunes filles de la Légion d’honneur, à des années-lumière de la Tour Eiffel [se trouvait] le bidonville de Franc-Moisin. — Robert Bozzi, Les Immigrés – Le Logement, 1970

Devant quelques tracts contre la guerre du Vietnam punaisés au mur, une jeune femme, les yeux et les cheveux très sombres – au maximum de saturation des noirs de la pellicule noir et blanc du film – s’insurge : « C’est dégoûtant ! Dégoûtant ce qu’on fait d’eux ! [les immigrés vivant dans les bidonvilles]. Ce ne sont plus des humains, on les traite comme des bêtes ! Il faut essayer que le monde les voie, même si ça intéresse pas mal de gens que ça ne se voie pas trop. Il faut que les bourgeois qui n’acceptent pas de voir la misère des autres, la voient. » La séquence se retrouve au début de deux films de Robert Bozzi : Les Immigrés – Le Logement (1970) et Les Gens des baraques, relecture de son propre film en 1996.
En 1970 Robert Bozzi tourne dans le giron du Parti communiste français – avec les excellents Bruno Muel à l’image et Antoine Bonfanti au son – son premier documentaire sur le sujet. Les Immigrés – Le Logement débute par une énumération qui fait fort penser à celles que Georges Perec et Robert Bober utiliseront dix ans plus tard pour leur film Récits d’Ellis Island (1980 – Cf. Lectures.Cultures n°14) : « Ils sont venus à 600 000 d’Italie, à 700 000 d’Espagne, à 400 000 du Portugal, ils ont franchi la mer à 600 000 d’Algérie, à 60 000 de Tunisie, à 100 000 du Maroc. ». Ponctué par la question récurrente « Pourquoi es-tu venu en France ? », le film aborde les conditions de vie, de travail (la semaine de 50 heures), la promiscuité, l’insalubrité, la maladie (tuberculose, rachitisme des enfants, etc.) ou encore la scolarité compliquée que vivent des familles d’immigrés mauritaniens, congolais, guadeloupéens, marocains, portugais, entassés en bidonvilles ou dans des taudis.
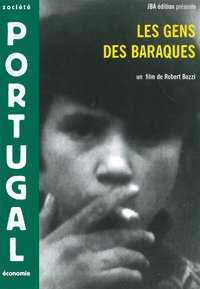
En 1996, Robert Bozzi, considérant que, en 1970, il a regardé les immigrés qu’il a filmés « comme un groupe social victime du capitalisme », mais qu’il n’est « pas sûr de qui ils étaient vraiment », « qu’il a pris leur image mais ne sait rien d’eux, même pas leur nom », décide de pister les intervenants de son film d’alors, d’essayer de les retrouver, tout en resserrant son sujet sur la communauté portugaise des bidonvilles de Saint-Denis et La Courneuve. Les « gens des baraques » que Bozzi retrouve et filme en vidéo, en banlieue ou de retour au Portugal, lui racontent la boue, les rats mais aussi l’entraide et la solidarité. Une très belle longue séquence, très calme et irréfutable, ressort en intensité par rapport au reste du film : Ricco, gamin en 1970, presque trentenaire en 1996, pose son constat en montrant le photogramme d’un groupe de gamins de son âge se réchauffant autour d’un feu sur un terrain vague : « Les enfants comme eux, on ne leur a jamais appris à vivre. Ils ont dû se débrouiller tout seuls. On ne leur a jamais dit de faire comme ci ou comme ça. »
Le futur de la prémonition : Maurice Pialat
Ils existent à trois kilomètres des Champs-Élysées. Constructions légères de planches et de cartons goudronnés qui s’enflamment très facilement. Des ustensiles à pétrole servent à la cuisine et à l’éclairage. — "L’amour existe", Maurice Pialat, 1960
En 1960, dans L’amour existe, un de ses premiers courts métrages, Maurice Pialat aborde la banlieue parisienne en pleine mutation, à la fois de manière très frontale et personnelle et sous de multiples approches complémentaires : poétique et statistique, mélancolique et révoltée. Son essai cinématographique – à mes yeux un des plus beaux films de l’histoire du cinéma – est à la fois un poème, un cri et une prophétie. Le cinéaste saisit presque en direct, avec un sens rare de la prémonition, sur les chantiers des grands ensembles en construction, une partie des problèmes futurs de la banlieue : « Voici venu le temps des casernes civiles, univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres dégradés avant la fin des travaux. » Si le cinéaste prend des accents de voyant, c’est peut-être parce qu’il parle « de l’intérieur », d’un territoire qu’il connaît, où il a vécu.



La séquence du bidonville dans L’amour existe est courte – deux minutes quinze secondes à peine – mais elle est particulièrement forte. Dans un film plutôt bavard, très écrit, dont la colonne vertébrale est d’abord constituée du texte de la voix off, elle marque encore plus les esprits parce que le lecteur, Jean-Loup Reynold, s’y tait. Comme si ce silence soulignait une dureté, une détresse, une précarité encore plus intenses que celles du reste du film. La séquence se clôt sur l’incendie spectaculaire d’une baraque, filmé à hauteur d’homme puis en plongée depuis une HLM voisine, mais est précédée d’une série de portraits – quasi photographiques – d’hommes dans leur abri, assis au bord du lit, cuisinant sur un réchaud portatif, et d’un premier plan très marquant où, par l’embrasure d’une porte, la caméra s’approche d’un enfant pleurant seul sur un lit – les enfants, présences marquantes dans tous les films évoqués ici.
Le présent inscrit dans la durée chez Jérémy Gravayat

Les bidonvilles sont réapparus en force autour de Paris ces dernières années. Le cinéaste Jérémy Gravayat en a rendu compte par un projet à La Courneuve, qui se situe à des années-lumière du sensationnalisme et du voyeurisme des actualités télévisuelles : un projet au long cours (2011-2018), dépassant de loin le cinéma et la réalisation d’un film, et faisant le lien entre la gestion de masse des questions de logement et le versant intime de la politique de la ville via la recherche d’archives, la publication d’un livre-journal gratuit (Atlas) et l’action militante aux côtés des habitants (manifestations, occupations, ouverture de squats, soutien dans les démarches).

Par leurs recherches de témoignages sur le terrain, Jérémy Gravayat et son complice Yann Chevalier ont tissé des liens pas toujours évidents sur le terrain entre les habitants des bidonvilles des années 1960 et ceux d’aujourd’hui – d’autres populations, pour la plupart venues d’Europe de l’Est qui vivaient par exemple au Platz du Samaritain (de l’allemand Platz, nom que les Roms et Roumains donnent aux bidonvilles). Suite à l’expulsion de ce lieu de vie, les habitants décident de ne pas se laisser faire et de camper devant la mairie de la commune, puis se pose très vite la question aiguë du relogement des familles. Au cours de cette période de mobilisation, Gravayat et Chevalier décident de ne pas filmer, à la fois pour des raisons morales et d’efficacité (de temps et d’énergie à laisser à l’action sur le terrain). Contrepartie de cette période de « non-cinéma », de ces mois passés aux côtés des expulsés, la construction d’une complicité et d’une amitié intenses et l’envie de faire, plus tard, un film ensemble.
Un premier court métrage, Planches clous marteaux (2015) fait déjà interagir de splendides documents d’archives (les photos de Miroslav Marik à La Campa en 1968, des rushes d’un film collectif inachevé au Franc-Moisin en 1969, une scène splendide de danse autour du feu de Władysław Ślesicki en 1964, etc.) et des plans paysagers contemporains développés à la main dans les labos associatifs de L’Abominable : des campements de fortune abandonnés suite à des expulsions, l’omniprésence des autoroutes et de la circulation des camions autour de ces anciennes zones d’habitat enclavées.

On retrouve cette hétérogénéité assumée et très riche entre différentes époques, différents supports et grains de l’image et différents registres de la réalité (documentaire, scènes rejouées) dans le long métrage A lua platz [Prendre place] (2018). Plus qu’un film militant, il s’agit d’un film d’amitié, de conversations précieuses autour d’un café soluble, d’un repas qu’on prépare ou d’un feu qui crépite dans la nuit. Les corps et les paysages (tant ceux de la banlieue, des maisons murées de parpaings après les expulsions, que ceux d’échappées poétiques dans les paysages ruraux de l’enfance en Roumanie) sont au cœur de l’œuvre.
Au détour d’une conversation, un des protagonistes parle lui aussi des rapports ambigus entre cinéma et mémoire que j’évoquais plus haut : « Quand la caméra s’arrête, ma tête se remplit de souvenirs. Mais dès qu’elle s’allume, on dirait qu’ils s’envolent. Je ne sais plus de quoi me souvenir. »

Philippe Delvosalle
article paru à l'origine dans le dossier « La mémoire et l'oubli » de Lectures - Cultures n°16, janvier-février 2020
photo de bannière : Jérémy Gravayat : "A lua platz" - expulsion du bidonville du Samaritain à La Courneuve en 2015