Critique de l’ingénierie sociale scientifique

Sommaire
Introduction
Quels types de savoirs l’État a-t-il développé, sur la nature, les gens et les techniques, afin de mener à bien sa modernisation et sa mission « civilisatrice » ? Comment, à partir de ces savoirs, a-t-il entrepris d’enraciner cette vision centrale du devenir de la société humaine à l’échelle de la planète ? Selon quelle logique de supervision et de contrôle ? Telle est l’histoire tentaculaire que James C. Scott permet d’appréhender dans cette brique fouillée et passionnante, sans jamais céder au simplisme, en se consacrant à quelques grands chantiers symptomatiques de ce que l’on appelle « haut modernisme ». Le haut modernisme renvoie à un mode de gestion privilégiant la science et la technologie caractéristique des années 1950, 1960.
La forêt alignée, la forêt morte
Il pose d’abord un cas emblématique qui inspirera de nombreuses autres chimères par la suite : celui de la sylviculture scientifique, née au XVIII et XIXème siècles en Prusse pour s’épanouir ensuite en Allemagne. Son objectif est clair : faire mieux que la nature pour rationaliser l’exploitation des forêts. C’est-à-dire augmenter une rentabilité plus stable, plus prédictible, en fonction des besoins industriels en termes d’espèces et de qualité. Cela signifie aligner les arbres comme à la parade pour en faciliter l’inspection, éliminer tout ce qui semble impropre à la production recherchée, sol propre et net, ratissé. Au-delà d’une première génération d’arbres plantés dans cet esprit, ayant bénéficié des richesses d’un sol fourni par la forêt originelle, ce modèle n’a jamais répondu aux attentes. La vision mise en œuvre était porteuse d’une simplification destructive de ce qui fait vivre une forêt : nettoyer les sous-bois implique d’éliminer le bois mort et, ainsi, de diminuer « considérablement les populations d’insectes, de mammifères et d’oiseaux pourtant essentielles aux processus de formation des sols » et d’appauvrir la formation de « litière et de biomasse ligneuse sur le nouveau tapis forestier ». La volonté scientifique et mercantile de regrouper des arbres d’une même essence conduit à fragiliser la forêt face aux tempêtes et face aux nuisibles « se spécialisant dans cette essence ». La fragilisation de la biodiversité de la forêt conduit d’autre part à l’expansion de « solutions » telles qu’engrais artificiels, insecticides et fongicides… Cette vision, dans son application, s’est révélée un échec, parce qu’elle « en était arrivée à percevoir la forêt comme une marchandise » et qu’elle entreprit « de la remodeler comme une machine produisant cette marchandise ». (p.43) Au cœur de cette démarche, il y a le mythe de la simplification au service d’une exploitation plus efficace : « La simplification utilisatrice de la forêt constitua certes une manière efficace de maximiser la production de bois à court et moyen terme. Toutefois, au bout du compte, son insistance sur les quantités et les profits comptables, son horizon temporel relativement court et le vaste ensemble de conséquences qu’elle avait résolument décidé d’ignorer revinrent la hanter. »
De telles tentatives d’organiser la vie – l’humain et le non-humain – pour encourager une modernisation productrice de bien-être et de richesse se sont multipliées, en même temps que l’État perfectionnait tous ses dispositifs de cadastre, de recensement, de cartographie et d’outils de gestion bureaucratique de la réalité.
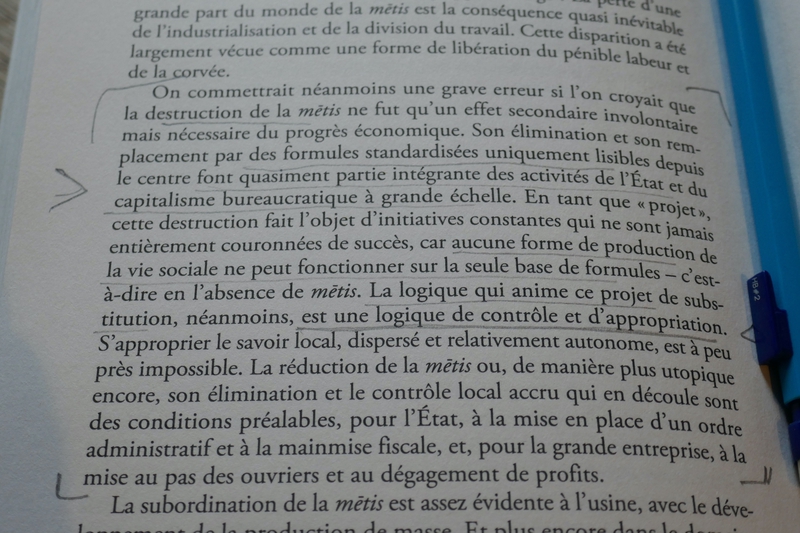
Tissu urbain et tissu agricole pensés scientifiquement
L’auteur prend comme autre exemple le mirage « un projet d’urbanisme » où « les besoins humains étaient scientifiquement définis par le planificateur ». Le Corbusier n’imagina jamais d’ailleurs à aucun moment que les sujets à l’intention desquels il produisait ses plans auraient pu avoir quelque chose d’utile à dire à leur sujet ou que leurs besoins auraient pu être pluriels plutôt que singuliers. » (p.182) Si ces théories ont été peu appliquées de façon totale voire intégriste, à part une ville en Inde et Brasilia au Brésil, c’est un imaginaire qui a largement influencé les politiques d’urbanisme.
Ensuite, il plonge dans l’histoire de l’industrialisation de la production agricole, ivre de gigantisme et d’automatisme, poursuivant l’idéal de nourrir le monde au moindre coût. Des USA à l’Union soviétique, des chantiers délirants voient le jour, s’influencent réciproquement et transmettent aux financeurs la conviction hypnotique de créer l’économie du futur. En 1928, deux Américains sont « invités à concevoir une immense ferme à blé sur quelque 200 000 hectares de terre vierge. » Ce qui se présentait comme la plus grande ferme mécanisée au monde fut conçu et mis en route en deux semaines depuis « une chambre d’hôtel à Chicago ». Sans lien avec le contexte, « ces plans étaient conçus comme pour un lieu abstrait, théorique ».(p.302) Tout ça, toujours au nom du bonheur du peuple, est mis en perspective avec l’histoire du parti révolutionnaire russe et la sinistre collectivisation.
Villages bien ordonnés en Tanzanie
Un autre exemple décortiqué est la « villagisation forcée en Tanzanie », dans les années 1970. Son présupposé d’origine coloniale est que le cultivateur africain est dépourvu de savoirs et qu’il est indispensable d’importer les préceptes de l’agriculture industrielle occidentale. Il s’agissait de remplacer « les rythmes de travail décousus et autonomes des cultivateurs traditionnels » par « la discipline stricte et interdépendante des usines ». Tout doit être organisé, par exemple, pour adapter le paysage et l’organisation paysanne à l’usage du tracteur, symbole de l’exploitation agricole modèle. L’objectif étant toujours de mettre en place une production intensive comme préalable à une vie plus agréable pour le plus grand nombre. La villagisation se voudra d’abord paisible, comptant sur l’engouement naturel des populations. Devant la résistance rencontrée sur le terrain, elle s’appliquera de façon militaire, violente, déplaçant des millions de personnes, décidant de la création de villages selon des critères « esthétiques » (bien alignés, comme des casernes, le côté quadrillé et rectiligne étant compris comme la base de tout bon fonctionnement rationnel). « Les planificateurs pensaient que le choc engendré par des réimplantations menées à vive allure aurait lui-même un effet bénéfique. Il arracherait la paysannerie à son environnement traditionnel et à ses réseaux et la projetterait dans un cadre nouveau où, était-il espéré, ses membres pourraient plus facilement être remodelés en producteurs modernes aptes à suivre les instructions des experts. » (p.352)
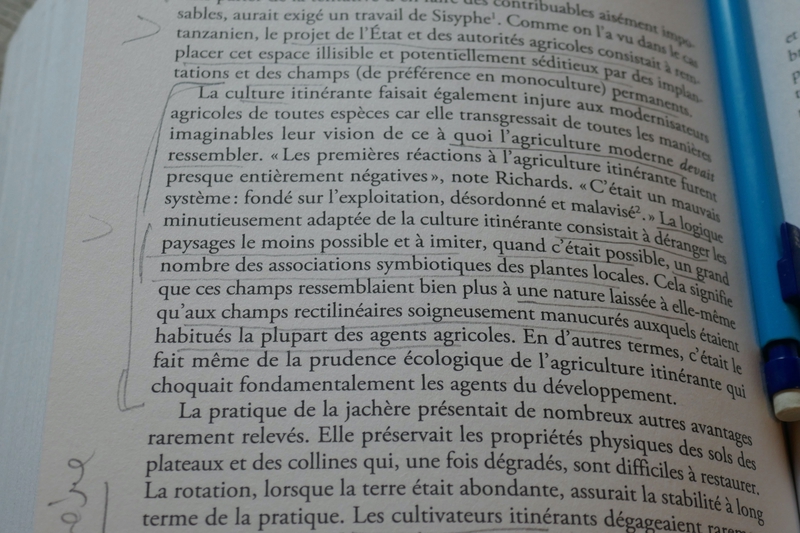
Simplification bureaucratique et destruction massive
Qu’il s’agisse d’urbanisme avec Le Corbusier, de révolution selon les théories de Lénine, de la collectivisation soviétique ou de la villagisation tanzanienne, ce sont toujours des « projets monochromatiques de rationalité centralisée ». Ils accompagnent la volonté étatique de contrôle à travers les outils dont la vocation est « de rendre la situation du terrain lisible de l’extérieur » : cadastre, recensement, cartographie et aujourd’hui big data. Les résultats furent à chaque fois dramatiques, socialement, économiquement, écologiquement. La raison principale en est que le réel a été systématiquement évacué au profit d’une simplification de tous les contextes. À commencer par les « sujets », considérés comme « unités standardisées » destinées à accroître la « capacité d’action de l’exercice de planification ». Par cette simplification bureaucratique, l’ordre formel parasite les processus informels. Or, les « règles simplifiées ne peuvent en effet jamais générer de communauté, de ville ou d’économie florissantes » et l’informel est indispensable à « faire tenir » le formel. En évacuant toute dynamique informelle, ce sont tous les savoirs et savoir-faire des personnes qui ont été réprimés, ainsi que les pratiques et mutualisations qui les accompagnaient.
Les échecs de ce « haut modernisme » conduisent à considérer que « des environnements complexes, divers et animés, contribuent à produire une population compétente, flexible et résiliente jouissant d’une plus grande expérience pour faire face aux défis et prendre des initiatives. Les environnements étriqués et planifiés, quant à eux, engendrent des populations moins compétentes, moins innovantes et moins ingénieuses. » Pourtant, cette « ingénierie sociale autoritaire » continue d’exercer son influence dans les manières de gouverner le monde, notamment avec les plateformes numériques et leur extractivisme appliqué aux données de l’intime. Sans manichéisme, James C. Scott pose les bases d’une analyse salutaire de ces désastres historiques. De quoi renouer avec la fertile complexité des choses de la vie, sans s’y perdre, en rendant tous leurs droits aux savoirs et savoir-faire du terrain.
Pierre Hemptinne
Référence : James C. Scott, « L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire » La Découverte 2021
Autre article sur James C. Scott
Document sur Le Corbusier (en collection)
Aperçu du livre