Le capitalisme contre l’environnement
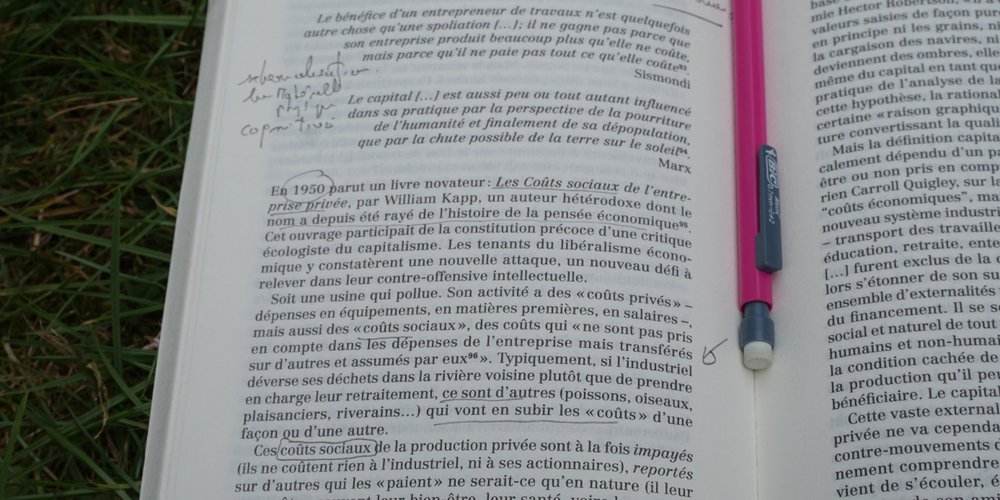
Sommaire
Un article récent de Martine Valo pour le journal Le Monde révèle d’étonnantes manipulations qui visent à contourner l’interdiction de nombreux pesticides :

> lien vers l'article sur lemonde.fr
C’est l’intervention de réseaux activistes qui a fini par découvrir cette manœuvre qui, à ce niveau, ne peut se résoudre à une simple erreur administrative ou à la distraction inopinée de quelques géographes. Si les citoyen·ne·s qui s’impliquent dans les combats politiques de protection de l’environnement savent à quoi s’en tenir, sans doute que le grand public ignore encore à quel point les acteurs du système économique dominant détériorent délibérément, systématiquement, structurellement, notre biosphère. C’est avec préméditation qu’ils entravent, sabotent, retardent, neutralisent toute initiative pour sauver la planète et, en premier lieu, solutionner la crise climatique.

Plusieurs chapitres du livre récent de Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire (La Fabrique, 2018), retracent l’histoire de cette lutte des milieux économiques et industriels contre l’écologie politique. Une lutte qui mobilise de gros moyens et ne s’embarrasse d’aucun scrupule. C’est dès les années 1960-1970 que des activistes ont attiré l’attention sur les dégâts environnementaux qu’entraîne le productivisme des grandes firmes basées sur le profit à tout prix. Le livre de Chamayou, se basant sur les déclarations des PDG et gourous du management, retrace l’émergence d’une stratégie néolibérale contre tout ce qui s’oppose à sa maîtrise du monde via son économie de marché.
Pour donner le ton général du discours dans le camp conservateur et réactionnaire :
Thomas Shepard, coauteur de l’un des premiers manifestes anti-écologistes, prend pour cible, en 1971, ce qu’il appelle le 'lobby du désastre', un ramassis d’écolos alarmistes qu’il considère comme étant « les femmes et les hommes les plus dangereux d’Amérique. Immatures, intransigeants et jusqu’au-boutistes, ces militants sont aussi des menteurs éhontés, qui voudraient faire croire que la pollution de l’air augmente alors que c’est le contraire, ou encore qu’une "prétendue rébellion noire" gronde en Amérique alors que cela ne concerne qu’une "poignée de militants paranoïaques" qui, dans un autre pays, auraient déjà été mis sous les barreaux – la liberté dont ils jouissent encore prouvant bien que nous vivons dans le pays le plus libéré et le moins raciste du monde ». — Thomas Shepard, cité par Grégoire Chamayou (p. 168)
La liberté de consommer fait-elle partie intégrante des droits de l’homme ?
Quant à la stratégie, l’argument principal est de défendre la « libre entreprise » qui garantit la « liberté du consommateur », sous-entendu, la liberté de vivre comme on le souhaite, puisque bien entendu, hors la consommation, il n’y a pas de vie réelle. Toutes les régulations qui sont demandées pour limiter les impacts environnementaux des industries « entravent la liberté inaliénable de consommer » et conduisent à des attaques contre les droits de l’homme dès qu’est mise en question « la liberté des individus en tant que chefs d’entreprise ». Ce qui est dénoncé, de façon perverse, est le développement d’un « pouvoir étouffant exercé au nom du soin, une tyrannie bienveillante, l’expression liberticide d’une volonté de surprotection sociale ». (p.167)
La croissance économique demeure la raison suprême à préserver de toute entrave. Elle repose sur une logique comptable et un capitalisme des valeurs qui a exclu de prendre en compte les coûts sociaux et environnementaux, qui sont « simplement » des coûts externalisés. Tous les aspects négatifs qu’engendre une activité industrielle lourde, « ces négativités ne comptent pas » pour les capitalistes, elles ne rentrent pas dans les bilans comptables. Ce que souhaitent au contraire les militants d’une écologie politique, favorables à une sortie du capitalisme. Le chemin est encore long. « Le capital profite d’un ensemble d’externalités positives dont il n’assume qu’une fraction du financement. Il se soulage en outre sur son environnement naturel et social de tout un ensemble de négativités dont d’autres, humains et non-humains, supportent le fardeau. Ce n’est qu’à la condition cachée de cette double dispense des coûts réels de la production qu’il peut se présenter comme économiquement bénéficiaire. Le capitalisme est une économie de la décharge. » (p.179) Et qui repose sur une fiction, cette notion du bénéfice, qui nous fait courir à notre perte.
La logique économique prédomine. Ne doit prévaloir que ce qui représente de l’argent, des espèces sonnantes et trébuchantes qui profitent aux propriétaires des outils de production des biens de toutes sortes.
C’est sur cette base que le milieu des affaires va s’opposer et contrecarrer toutes les tentatives de protéger l’environnement. En replaçant tous les arguments dans la logique comptable binaire des valeurs capitalistes selon une analyse « coûts/bénéfice », la philosophie générale intouchable persistant à considérer que seule la croissance peut sauver le monde. Dans les productions théoriques, dans les campagnes de propagande, surtout dans les multiples procès intentés par des organisations ou des citoyens contre des firmes polluantes, c’est ce principe de « symétrisation du remède et du mal », qui « allait devenir le trope central de la critique néolibérale de la régulation sociale et environnementale. » (p. 180)
Cette posture va engendrer d’innombrables plaidoiries sophistiquées et sans vergogne. Mais qui, in fine, continuent à déterminer la mentalité néolibérale qui ne craint aucun sommet de cynisme. « Concrètement, s’il coûte plus cher à l’entreprise de réduire ses émissions de fumées qu’aux victimes de soigner leurs maladies respiratoires, alors l’industriel pourra continuer à polluer. On met en balance le montant des dépenses de santé pour les riverains avec le coût qu’il y aurait pour l’industriel d’éviter de les leur infliger. Inversion d’un vieil adage : mieux vaut guérir que prévenir. » (p. 171)
De façon plus absolue, ce qui prévaut est bien la raison économique, l’équivalent en argent ou en actions des réalités environnementales. En dehors de ces paramètres du calculable, il n’y a pas de salut. « Dans cette conception du monde, la destruction d’une réalité environnementale compte pour rien tant que celle-ci n’a pas été « économicisée ». La pollution d’un lac ne devient une réalité économique – une réalité tout court – que s’il existe par exemple une base nautique qui verra ses revenus baisser en conséquence. Un lac non capitaliste, en revanche, n’existe pas. La thèse fondamentale est que l’appropriation marchande de la nature est la condition de sa préservation. Les « biens communs », a contrario, sont réputés être une tragédie. » (p. 188)
Le capitalisme des valeurs met l’accent sur des logiques linéaires et des temporalités courtes. Le devenir des générations futures pèse peu.
Au passage, ces approches néolibérales confirment leur vision étroite des impacts, ne concédant, à la rigueur, de considérer que les dommages les plus directs, immédiats, sans voir leur dimension de réaction en chaîne. Pourtant, dès les années 1950, un certain William Kapp avait publié un livre qui, notamment, attirait l’attention sur l’effet combiné et exponentiel des agents polluants. Et le camp néolibéral ne peut aujourd’hui avoir ignoré ces avertissements parce qu’il s’est beaucoup employé à torpiller cet ouvrage. « De multiples sources de pollution engendrent des effets combinés qui ne « varient pas nécessairement en proportion de leur quantité et de leur fréquence. Lorsque la capacité d’assimilation de l’environnement atteint des seuils critiques, que différents polluants se combinent, se concentrent, entraînent des réactions chimiques en chaîne, une seule portion d’émission supplémentaire peut avoir des effets non-linéaires, non pas proportionnels, mais disproportionnés, entraînant des catastrophiques pour la santé humaine ». » (p.182) Aux défauts coupables d’une conception strictement linéaire, réductrice, s’ajoute le refus de prendre en considération les répercussions dans le temps et les retombées sur les générations futures. « La tendance structurelle consiste dès lors à choisir un gain immédiat au prix d’une perte reportée sur d’autres, dans un futur qui ne nous concernera plus. » Le court-termisme est la règle.
Quand le marché des déchets, inventé par quelques grandes firmes, déresponsabilise le capitalisme.
Dans un autre chapitre, l’auteur dresse l’historique édifiant de l’actuelle gestion des déchets. Plutôt que de céder aux tentatives de réguler industries et capitalismes, les grandes marques ont lancé la mode de la responsabilisation, ont transformé la problématique de l’environnement en questions de responsabilités individuelles, « déconnectée du processus de production ». Une astucieuse et formidable manière de botter en touche et qui fonctionne pas mal, tous les politiques embrayant et en faisant presque leur seul axe d’action contre la pollution. Une manière aussi, en lieu et place de mise en cause du marché et de ses modes de fonctionnement, de créer un autre marché profitable. « Le marché a failli ? Vive le marché. Car quelle meilleure solution, face aux tares du marché existant, que d’en faire naître un nouveau, emplâtre illusoire plaqué sur le premier ? » Ceci à propos, aussi, du marché des « droits de polluer ».
L’essentiel des termes de la confrontation entre capitalisme et activistes écologiques (sous leur différentes formes politiques) se fixe dans les années 1970. Aujourd’hui, face à la colère des lycéennes et lycéens, certains ont l’air de découvrir l’urgence ou, enfin, de trouver l’impulsion pour « décider ». Mais en lisant Grégoire Chamayou, qui compile et analyse des déclarations, des prises de positions, des écrits et des scripts de formation au management, on gagne au moins la conviction que personne, aucun décideur, du monde des affaires ou du champ politique, depuis les années 1970, ne peut prétendre qu’il ne savait pas, qu’il n’a pas été prévenu. Et l’on peut encore s’étonner d’entendre des optimistes déclarer qu’il n’est pas trop tard, que c’est l’affaire de tous. Pour réellement avancer, ne serait-il pas plus sain d’éviter de noyer le poisson et objectiver les culpabilités, les complicités, collusions et préméditations, s’agissant non pas d’ajuster un système économique mais de réellement changer de culture ?
Pierre Hemptinne
– émission sur France Culture –

Grégoire Chamayou : La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire
336 pages
Éditions La Fabrique, 2018