Le Travail | Isabelle Ferreras : Ils ne voient pas que tout s’effondre ?

Sommaire
L’entreprise comme entité politique
- PointCulture : On évoque toujours, à propos du travail, le dilemme entre travail épanouissement et travail aliénation. Que se cache-t-il, selon vous, derrière cette tension ?
- Isabelle Ferreras : Si on essaie de reconstituer l’histoire du capitalisme, il importe de voir que les travailleurs ont essayé d’arracher le gouvernement du travail des coordonnées de la sphère privée, c’est-à-dire du monde domestique dans lequel c’est le domus, le maître de la maison qui dirige. Selon Aristote c’est bien le despotes, le maître, qui légitimement assigne à « son » esclave les tâches auxquelles se consacrer. C’est le paradigme au fondement de l’organisation de l’économie capitaliste. Et sur les deux derniers siècles de développement, j’essaie d’être attentive aux constructions que les acteurs sociaux ont arrachées, au travers d’autant de luttes sociales, en vue d’obtenir la reconnaissance de la dignité du travailleur, la reconnaissance de la légitimité de peser eux-aussi sur leur devenir au travail. Donc négociations collectives, droits collectifs des travailleurs, le syndicalisme évidemment, comme possibilité de la représentation collective des travailleurs, doivent se lire comme, progressivement, la volonté de faire basculer le travail de la sphère privée à la sphère publique.
On utilise d’ailleurs toujours le terme entreprise privée, mais je défends l’idée
qu’il est plus adéquat de voir l’entreprise comme une entité politique, parce
que, si elle a bien sûr des dimensions économiques, elle est le siège d’un
pouvoir, qui prend des décisions incessantes qui impactent ses parties
constituantes (les investisseurs en capital et en travail) et ses parties
prenantes qui mobilisent tous des conceptions – différentes – sur la justice.
Du point de vue des travailleurs, c’est une évidence dès que vous les entendez
commenter l’annonce d’une volonté de licenciement collectif, des problèmes
d’absentéisme, des salaires trop bas ou l’accès à un programme de formation, mais
ce n’est pas reconnu comme tel.
Et c’est une belle stratégie que de rabattre la complexité de ce qui se joue là sur du « pur » économique, comme s’il s’agissait uniquement de « régler » la maison, selon l’étymologie d’oikonomos. — Isabelle Ferreras
Or, aujourd’hui, dans une économie de services – c’est là qu’il y a une
opportunité historique pour accroître la puissance d’une critique du despotisme
capitaliste –, les travailleurs ne sont plus, même physiquement, dans l’espace
privé de l’entreprise, où le client n’allait pas puisque c’était le produit qui
sortait sur le marché, les travailleurs restant entre eux sous la direction de
ce maître ou contremaître qui représentait le propriétaire des parts de la société anonyme. Le fait que le
travailleur travaille en présence du client est en train de changer la donne
car les personnes au travail, en fait, mobilisent une compréhension des enjeux
du travail qui est typique de l’espace public des sociétés démocratiques. Ils
s’attendent à ce que la norme fondamentale en démocratie : le respect de
l’égalité de chacun se trouve aussi au fondement de leur vie au travail. Or,
là, on leur dit, « Ah mais non, vous n’êtes pas un égal : vous êtes
un subordonné ! Vous signez un contrat de travail, vous souscrivez à un
système de subordination, vous êtes de rang inférieur et par statut, ça ne se
discute pas. » Dans le contexte de l’économie de services, donc, ce
décalage va poser de plus en plus problème.
Le bonheur au travail ?
- Le pourcentage de personnes malades de leur travail est actuellement très élevé. Que penser du film Le Bonheur au travail qui présente des formes d’organisation du travail censées modifier la relation à l’entreprise, au salariat ?
- La valeur bonheur, c’est une valeur privée. Bien sûr, à titre personnel, comme chacun, je peux espérer que mes activités, dans le cadre de mon travail, vont nourrir mon bonheur personnel. Mais faire une théorie du travail qui devrait conduire au bonheur, c’est tout à fait autre chose. Ça nous éloigne potentiellement de la trajectoire qui vise à faire entrer le travail dans les coordonnées de la sphère publique démocratique, pour qu’il soit enfin gouverné selon le mode d’organisation démocratique. Or, quand on parle de bonheur au travail, on risque de rabattre le travail, une fois de plus, dans une lecture de type sphère privée, entreprise privée, et ça serait un contre-sens lourd de conséquence. Qu’un documentaire comme Le Bonheur au travail ait eu autant d’échos, autant d’intérêt pour ces pratiques innovantes de management, cela démontre bien l’importance du sujet : les travailleurs ont des attentes qu’aujourd’hui certains managers éclairés ou leaders libérateurs (sic) prennent au sérieux, par intérêt pour le bonheur de leurs travailleurs mais surtout parce que ça rend le travail plus efficace. C’est très rentable !
Ma thèse de doctorat portait sur le rapport au travail des caissières d’un supermarché. — Isabelle Ferreras
 J’en ai tiré un livre, Critique
politique du travail qui permet de comprendre pourquoi nous en sommes là. Ce
livre montre que les travailleurs vivent leur travail comme une expérience
fondamentalement politique, qui ne se réduit absolument pas aux dimensions
économiques ou instrumentales du genre « J’ai un salaire contre un
travail ». Évidemment, « J’ai besoin d’un salaire pour vivre »,
c’est important. Mais cela ne suffit pas à expliquer les dimensions de la
motivation au travail, de ce qui se joue dans le travail et les attentes des
travailleurs. Ce que j’appelle l’intuition critique de la justice démocratique
au travail, c’est le fondement même de l’expérience au travail aujourd’hui. Et dans
ces pratiques de management dites « horizontalisées »,
participatives, qui réinventent les organisations, qui libèrent l’entreprise ou
pratiquent la sociocratie – tout ce que montre ce film documentaire –, il y a
plein de bonnes choses car cette intuition critique qui se traduit en volonté
de vouloir peser sur les décisions qui vous concernent et concernent votre
domaine d’opération ou d’expertise, est ici prise au sérieux. Le problème est
de savoir si on se contente de remettre en question les modalités de la gestion
ou si, au contraire, l’on veut instaurer un véritable gouvernement légitime de
l’entreprise. La gestion, c’est comment on va disposer au mieux les moyens qui
sont les nôtres pour atteindre des finalités qui sont, elles, décidées par
d’autres. Le gouvernement consiste à participer à la décision sur les
finalités, organiser le partage du retour sur investissements, ce que l’on va
faire du profit. Si on obtient des ajustements au niveau de la gestion, et non
au niveau du gouvernement, si ça va toujours pour l’actionnaire, on n’a rien
changé au capitalisme, on aura juste déployé une énergie phénoménale au service
de l’enrichissement des actionnaires.
J’en ai tiré un livre, Critique
politique du travail qui permet de comprendre pourquoi nous en sommes là. Ce
livre montre que les travailleurs vivent leur travail comme une expérience
fondamentalement politique, qui ne se réduit absolument pas aux dimensions
économiques ou instrumentales du genre « J’ai un salaire contre un
travail ». Évidemment, « J’ai besoin d’un salaire pour vivre »,
c’est important. Mais cela ne suffit pas à expliquer les dimensions de la
motivation au travail, de ce qui se joue dans le travail et les attentes des
travailleurs. Ce que j’appelle l’intuition critique de la justice démocratique
au travail, c’est le fondement même de l’expérience au travail aujourd’hui. Et dans
ces pratiques de management dites « horizontalisées »,
participatives, qui réinventent les organisations, qui libèrent l’entreprise ou
pratiquent la sociocratie – tout ce que montre ce film documentaire –, il y a
plein de bonnes choses car cette intuition critique qui se traduit en volonté
de vouloir peser sur les décisions qui vous concernent et concernent votre
domaine d’opération ou d’expertise, est ici prise au sérieux. Le problème est
de savoir si on se contente de remettre en question les modalités de la gestion
ou si, au contraire, l’on veut instaurer un véritable gouvernement légitime de
l’entreprise. La gestion, c’est comment on va disposer au mieux les moyens qui
sont les nôtres pour atteindre des finalités qui sont, elles, décidées par
d’autres. Le gouvernement consiste à participer à la décision sur les
finalités, organiser le partage du retour sur investissements, ce que l’on va
faire du profit. Si on obtient des ajustements au niveau de la gestion, et non
au niveau du gouvernement, si ça va toujours pour l’actionnaire, on n’a rien
changé au capitalisme, on aura juste déployé une énergie phénoménale au service
de l’enrichissement des actionnaires.
De l'ubérisation de l'économie au bicamérisme économique
- Pour concrétiser l’ambition de démocratiser le gouvernement de l’entreprise, vous élaborez la proposition du « bicamérisme économique ». Qu’est-ce que c’est ?
- L’enjeu est de considérer sérieusement les entreprises comme entités politiques sous contrainte de démocratisation. Il s’agit de savoir comment sortir du despotisme, c’est une très vieille problématique sociétale. Je ne suis remontée qu’à Tite-Live et le Vème siècle av. J.-C. à Rome, mais on pourrait certainement remonter plus en amont encore. C’est la problématique fondamentale du vivre ensemble : celle du partage du pouvoir. Il s’agit en fait de traiter du travail et de l’entreprise dans des termes qu’on a déjà connus au niveau des pratiques sociales en général et politiques en particulier. Cela m’a amenée à regarder les configurations institutionnelles qui ont été la résultante des révolutions politiques de démocratisation. Et l’on voit revenir tout au long de l’histoire des entités politiques butant contre le despotisme d’une minorité dominante : ce que j’appelle un moment bicaméral, avec l’idée qu’il y a, dans une société, deux corps constituants qui se reconnaissent comme nécessaires à l’existence et au développement de l’entité en question. Cela veut dire concrètement : faire advenir l’actuel Conseil d’entreprise au statut de Chambre des représentants des investisseurs en travail, pesant pleinement sur le gouvernement de l’entreprise. Comme une Chambre des Communes au côté de la Chambre des Lords, elle prend place à côté du Conseil d’administration (qui n’est autre que la Chambre des représentants des investisseurs en capital), dans le parlement de l’entreprise ainsi composé de ces deux Chambres et au sein desquelles une majorité (50%+1 voix) doit être trouvée pour valider toutes les décisions importantes de l’entreprise. Le CEO devient ainsi responsable devant les deux Chambres et doit veiller à ce que la stratégie de l’entreprise (ses projets de développement, sa politique de partage des bénéfices, etc.) fasse l’objet d’un accord au sein de chacune des Chambres.
- Les deux parties constituantes dont vous parlez sont donc d’une part, les travailleurs et travailleuses et, d’autre part, les investisseurs en capital ? Quelles relations, quels enjeux entre ces deux chambres ?
- Le bicamérisme est en effet fondé sur la reconnaissance de ces deux parties constituantes, capital et travail, plus exactement investisseurs en capital et investisseurs en travail. J’insiste là-dessus : je parle d’un investissement en travail parce que les travailleurs font un investissement majeur qui est souvent bien plus risqué et qui a un impact bien plus important sur leur vie que le capitaliste qui va, certes, risquer une épargne, qui est de fait un surplus, qui comporte parfois un risque sur son propre toit, mais jamais sur sa propre santé, ce que, en revanche, fait le travailleur et c’est une dimension négligée dans la manière de rendre compte de ce qui se joue dans l’économie aujourd’hui.
On parle toujours des investisseurs, comme ceux qui tiennent le haut du pavé, ceux qui font vraiment vivre l’économie. Au minimum, il y a autant d’enjeux et de risque du côté de l’investissement en travail et j’en parle aussi dans ces termes-là parce que c’est une manière d’inclure dans nos préoccupations toute l’ubérisation de l’économie, la sous-traitance, toutes les formes de déresponsabilisation des entreprises vis-à-vis du travailleur. Nous vivons avec une grande tolérance par rapport à tout ça et effectivement, Uber, Deliveroo, expérimentent à qui mieux mieux de manière à réduire la société anonyme strictement aux enjeux du capital. Il faut aller contre cette réduction. Il faut au contraire institutionnaliser une responsabilisation accrue des investisseurs en capital, c’est-à-dire à minima les mettre en position de devoir rendre des comptes aux investisseurs en travail sur lesquels ils ont un impact absolu, et trouver des accords avec eux. Uber ou Deliveroo vous disent qu’ils n’ont aucune responsabilité particulière vis-à-vis des travailleurs qu’ils présentent comme des fournisseurs d’un service vis-à-vis desquels un contrat commercial seul suffit à régler la relation. C’est une supercherie. Sans investisseurs en travail, l’investissement en capital dans Uber ou Deliveroo n’aurait aucun sens. Croyez bien que les investisseurs en capital comptent là-dessus. Il faut poursuivre le raisonnement et voir que sans investisseurs en travail, ces plateformes ne valent rien. Ces entreprises doivent arrêter de se cacher derrière la façade de la société anonyme : il faut les prendre plus au sérieux et exiger une véritable structuration du pouvoir qu’ils exercent en donnant aux investisseurs en travail le moyen de gouverner l’entreprise commune et négocier collectivement leurs conditions.
Une entreprise, ça n’a jamais été que du capital, même si on a cru possible de penser l’entreprise comme limitée aux coordonnées de la société qui, juridiquement, assure la structuration des rapports des capitalistes entre eux. On a un droit des sociétés, un droit du travail, un droit commercial, tout cela avec très peu de relation de l’un à l’autre. Et pas de droit de l’entreprise. C’est intenable. L’enjeu en termes de délibération publique sur les fins servies par l’entreprise est énorme et ça passe encore trop souvent sous le radar. Actuellement, le ministre Geens y travaille mais si les organisations syndicales ne se saisissent pas de cet enjeu, en affirmant qu’a minima « L’entreprise, c’est autant nous que vous, autant les travailleurs que les investisseurs en capital », le droit de l’entreprise risque bien de ne pas donner aux travailleurs du pouvoir pour orienter le futur de ces entités-là.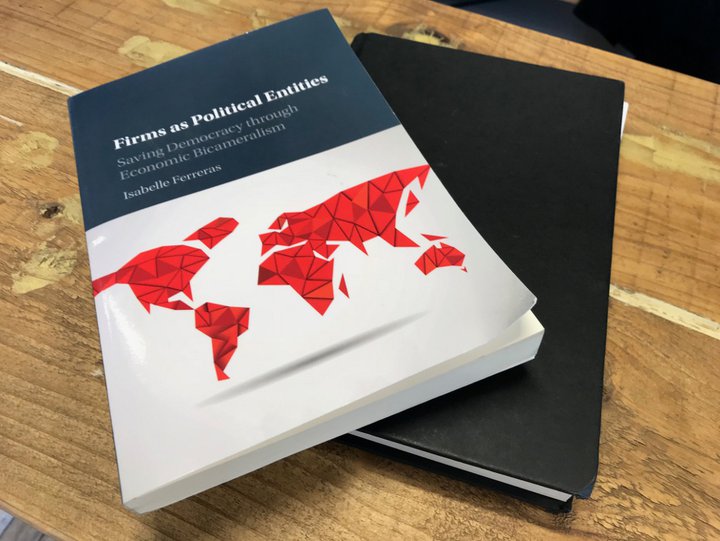
Démocratiser le travail et l’entreprise / démocratiser la finance
- On parle depuis longtemps des coopératives comme d’une piste pour transformer l’économie du travail. Pourquoi cela ne prend-il pas vraiment ?
- En effet, beaucoup ont pensé qu’une véritable démocratisation du travail viendrait par les coopératives ouvrières. Mais, on est en 2018 et on ne peut pas dire qu’elles sont hyper abondantes. Il y a néanmoins des grands succès qui sont trop méconnus. Par exemple, Mondragon en Espagne, qui est un groupe de plus de 60.000 associés coopérateurs composés d’une centaine d’entreprises. Ce groupe mondial a une structure de gouvernement complètement démocratique, ils s’élisent entre eux comme managers, ils ont un système de solidarité entre la centaine d’entreprises, ils ont leur propre banque d’épargne et c’est d’ailleurs comme ça qu’ils parviennent à financer leur développement. C’est précieux, parce que ça existe, ça apporte la preuve qu’un mode totalement alternatif d’organisation économique peut fonctionner, et Mondragon est en compétition avec des entreprises capitalistes classiques sur les marchés internationaux (par ex : les électroménagers ou les composants électroniques pour l’industrie automobile allemande, ou les supermarchés). Souvent on ignore cela, ou on a en tête des exemples plus micros et on garde finalement la conviction que le capitalisme est la seule voie de la performance économique. Mais non. L’enjeu, c’est l’accès au financement. Des coopératives qui connaissent des succès, qui veulent se développer, il y en a, mais elles ont besoin d’obtenir des crédits pour passer à une autre échelle et là, tout d’un coup, personne ne veut prendre le risque d’y investir. C’est pourquoi, démocratiser la finance, la banque, c’est également fondamental. Ce sont deux projets qui marchent main dans la main : démocratiser le travail avec l’entreprise et démocratiser la finance.
- Et au quotidien ? Pour revenir à l’exemple du supermarché : s’il intégrait un fonctionnement bicaméral, l’idée est que cela va induire d’autres relations avec les consommateurs, qu’il en viendra à proposer d’autres types de produits, privilégiera d’autres finalités, se souciera plus de l’environnement par exemple, en intégrant une forte dose de délibération…
- Effectivement. L’enjeu de la robotisation est un bon exemple. On nous dit, dans vingt ans, 40% des jobs auront disparus. Ça, c’est la version la plus idiote. Ce qu’on peut lire sur le sujet de plus intéressant, c’est que finalement, le travail va changer de nature, on va travailler de plus en plus avec un équipement de type robot. Quand je travaille avec mon ordinateur, j’utilise déjà un robot. Mais la part de l’intelligence artificielle va augmenter. Aujourd’hui on parle de cobot [NDÉ : robots, non autonomes, dédiés à la manipulation d’objets en collaboration avec un opérateur humain]. Et bien toutes ces décisions technologiques qui concernent des orientations fondamentales pour le devenir de la société et pour chacun d’entre nous en tant qu’individu sont laissées à des acteurs privés, il n’y a aucune délibération là-dessus ! Ce sont M. Elon Musk, PDG de SpaceX, et ses quelques actionnaires de référence qui décident de ce qui va être produit. L’idée d’avoir, au minimum, une contrainte de délibération dans les entités concernées par la production de ces potentiels technologiques, que les travailleurs puissent avoir en fait un droit de veto sur toutes ces innovations, ce serait déjà un progrès énorme. Je ne dis pas que ça suffit, et l'État est en position de faiblesse sur ce genre de décision. Il est crucial de renforcer une puissance publique aujourd’hui. L’intention n’est pas de déforcer l’État, au contraire. Mais avec l’instauration du bicamérisme dans l’entreprise, les réflexions que ces enjeux génèrent en entreprise pourront déjà immédiatement changer la nature des innovations. Les personnes qui analysent le mieux ce qu’elles sont en train de produire, ce ne sont pas les actionnaires, ce sont les travailleurs. Et parmi ces travailleurs, ceux qui se rendent compte que l’on pourrait faire un mauvais usage de ces innovations, certains réagiront.
Chez Google en mai 2018, il y a eu une pétition signée par des milliers d’ingénieurs pour demander à leur propre direction d’arrêter de collaborer avec le Pentagone. Aujourd’hui, c’est chez IBM qu’il y a une révolte interne contre la collaboration avec le service fédéral de l’immigration des USA (qui pratique cette politique indigne voulue par le président Trump de séparation des parents sans-papiers d’avec leurs enfants). — Isabelle Ferreras
Avec une structuration institutionnelle des droits collectifs à participer au gouvernement de l’entreprise, on ne peut qu’imaginer que ces enjeux portés par les investisseurs en travail trouveraient d’autant plus et mieux voie à s’exprimer. Et dans une économie de services, où les entreprises ont besoin de l’intelligence de leurs salariés, elles ne peuvent pas trop longtemps ne pas faire attention à ces exigences qui montent. Car à l’arrivée, c’est la motivation, donc la qualité du travail, donc la rentabilité de l’entreprise, qui en sont directement impactées.
Parcours personnel : (savoir pourquoi) changer le monde
- Comment en vient-on à se spécialiser dans la recherche du travail ?
- Je voulais faire la réalisation à l’IAD, quand j’étais adolescente. J’ai toujours voulu apporter ma contribution à un monde plus juste. Et je pensais que c’était comme cela qu’on changeait le monde : dans un monde d’images, par la puissance de l’image. À l’IAD, quand je me suis présentée à 17 ans, un professeur m’a dit « Pourquoi la réalisation ? ». Il a trouvé que « changer le monde », ça n’était pas très sérieux. « Allez un peu réfléchir, sachez pourquoi vous voulez changer le monde, avant de venir apprendre à utiliser un outil… ». J’avais suffisamment conscience à l’époque que l’économie était le système qui imposait le plus de domination structurelle à notre situation. Je me suis alors inscrite en sciences économiques, sociales et politiques à l’UCL. À l’époque, c’était complètement interdisciplinaire. La première année, on avait un cours d’introduction à chaque matière et j’ai découvert la sociologie, et ça m’a passionné. C’était ça que je voulais faire !
J’ai fait mon mémoire sur la manière dont les économistes, orthodoxes, dominants, comprennent le social. Ça m’a effrayée autant que passionnée. J’ai eu l’opportunité de faire une thèse, j’ai continué à creuser, pour essayer de mieux comprendre. Je suis partie aux États-Unis parce que pour comprendre l’économie et le capitalisme, il n’y a rien de tel que d’aller voir le cœur du capitalisme. Mais dans un système aussi dur que celui-là, il y a des poches de résistance très fortes, comme toujours, avec des gens qui sont très critiques, beaucoup plus enclins à remettre en question les structures sociales que nous en Europe (en tout cas il y a dix ans, quand je suis revenue de mes études). Quand j’ai mené mon mémoire de maîtrise sur l’idée du bicamérisme au MIT à Boston, mes promoteurs considéraient que c’était très intéressant, délirant peut-être par rapport à la réalité du monde mais novateur. Et l’enjeu de la science n’est pas de faire réaliste, c’est d’aider la société à mieux se comprendre et de lui offrir des outils pour penser ses futurs possibles. « Continuez à creuser, à justifier » me disaient-ils. Ici, quand je revenais, on me disait, souvent avec bienveillance « Tais-toi, on va se moquer de toi », parce que le mouvement syndical et les gens de gauche se disaient « On a obtenu le mieux qu’on a pu, il faut essayer de le préserver ». Oui, mais ils ne voient pas que c’est en train de s’effondrer ? Les choses sont en train de bouger.
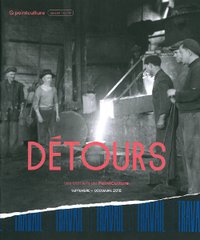
Entretien et retranscription : Pierre Hemptinne (mai 2018)
Relecture : Isabelle Ferreras
Photos: Emmanuelle Dejaiffe
article paru à l'origine dans Détours,
magazine gratuit de PointCulture
Le Travail #1 - septembre à décembre 2018
Jeudi 4 octobre 2018 à 18h
Le Travail - Gouverner le capitalisme
débat avec Isabelle Ferreras et des invité·e·s
PointCulture Bruxelles
145 Rue Royale
1000 Bruxelles
entrée par le boulevard Bischoffsheim