Morts ou vifs ?

Sommaire
Introduction
Les rapports alarmants sur l’état de la planète se suivent et se ressemblent. Pour certain·es, la date limite approche. Pour d’autres, elle est déjà passée. Aucune décision à la mesure du danger n’est prise par quelque État que ce soit. Face au changement climatique, l’impuissance politique est à son comble. Par où, la sortie ? Outre les diverses formes de pression sur les pouvoirs en place, une action culturelle d’envergure semble indispensable. La problématique, en effet, relève de la « bataille culturelle », comme l’explique Yves Citton. « Bataille » car toute culture ne nous aidera pas à imaginer un autre avenir, une large production culturelle entretenant l’attachement à un mode de vie consumériste qui mine notre écosystème.
Le constat : des idées, des affects
Le livre de Julie Sermon, Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants est une contribution bienvenue qui éclaire la voie à prendre. Simple et direct, il cerne merveilleusement bien la nature et les formes de l’enjeu culturel. Elle commence par un constat sur la situation : ce ne sont pas les documents et les informations sur la situation qui manquent. Au contraire, et ils circulent bien. Ce ne sont pas les idées qui font défaut. Elles fourmillent. Mais c’est ce que doivent déclencher les idées et leur partage qui ne se produit pas. Comme un défaut d’allumage. Sans mise à feu et propagation, les idées n’affectent pas suffisamment le corps social. Les idées restent débattues au sein de certains cercles, scientifiques ou militants, mais pas au-delà. Et citant Frédéric Lordon : « Nos imaginations sont-elles suffisamment vivaces, nous livrent-elles des figurations de choses absentes, ici de choses futures, suffisamment intenses pour nous déterminer à l’action ? On connaît pour sûr les affections de nos corps qui nous feront éprouver avec l’intensité requise le problème du changement climatique : les pieds mouillés. » (Les Affects de la politique). Et c’est à partir de cette lucidité que Julie Sermon explique la part possible que peut jouer une certaine action culturelle : générer « des formes et des actions dites symboliques, permettant de métaboliser les contenus idéels du savoir en perceptions et en impressions vécues qui nous portent, du même coup, "à désirer et faire mouvement" ». (p.33)
L’art pour renouveler le champ des perceptions
À partir de ce constat, elle clarifie de façon limpide le levier de l’art et de la culture (en se concentrant surtout sur les arts dits vivants, le théâtre au sens large) pour susciter la « "révolution" des esprits et des sensibilités (…) qui engage non seulement notre rapport à l’esthétique – pour mémoire, ce terme est dérivé du grec aesthêtikos : « qui a la faculté de sentir, perceptible, sensible » –, mais aussi à la politique, pensée du point de vue des partages à tracer, mais aussi des assemblages et des attachements à inventer. » Selon elle, « les arts vivants – leurs praticien·nes comme leurs théoricien·nes – peuvent eux aussi contribuer à ce que le débat ne soit pas capté par les « experts » officiels, et, à travers l’extraordinaire diversité des moyens qui leur sont propres, œuvrer à informer les récits, les représentations et les pratiques. » (p.62) Il faut bien se représenter concrètement quels sont les moyens dont disposent les artistes et producteur·trices de culture pour agir sur les affects et les imaginaires (dont dépend le désir de se mettre en mouvement) : « Par les récits qu’ils donnent à entendre ; les êtres, les corps et les relations qu’ils mettent en jeu ; les espaces-temps sensibles auxquels ils donnent forme ; les pratiques qu’ils mettent en œuvre ; les expériences à la fois intimes et collectives qu’ils autorisent, les arts vivants peuvent contribuer, de manière intentionnelle ou plus diffuse, à inquiéter et/ou renouveler le champ de nos perceptions, de nos représentations et de nos imaginations. » (p.66). C’est à partir de ce travail, dont les processus et résultats touchent des publics/des gens, qu’une contagion des idées utiles face au changement climatique peut s’effectuer et une créativité individuelle et collective percoler.
Les fictions que les artistes élaborent, les modes narratifs et figuratifs qu’ils·elles explorent, les lieux qu’ils·elles investissent, les moments auxquels ils·elles donnent forme, en un mot, le travail esthétique de l’imagination et des situations, permettent de « métaboliser » ce que nous savons sans pour autant y croire réellement ni en prendre la mesure concrète tant que nous n’en avons pas fait l’expérience d’une manière ou d’une autre. — Julie Sermon

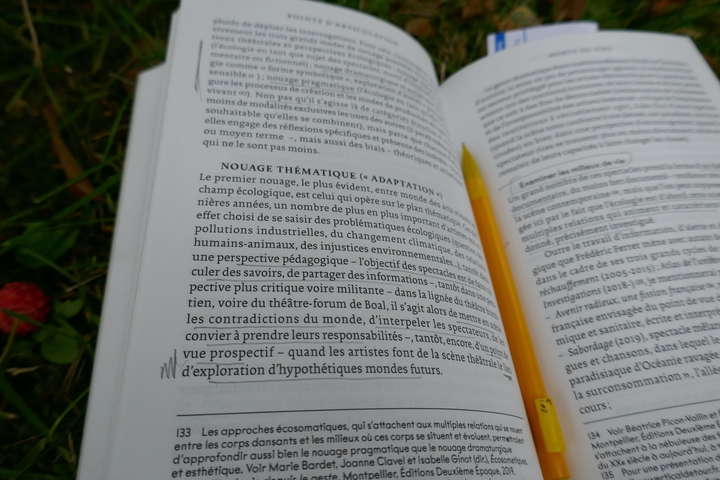
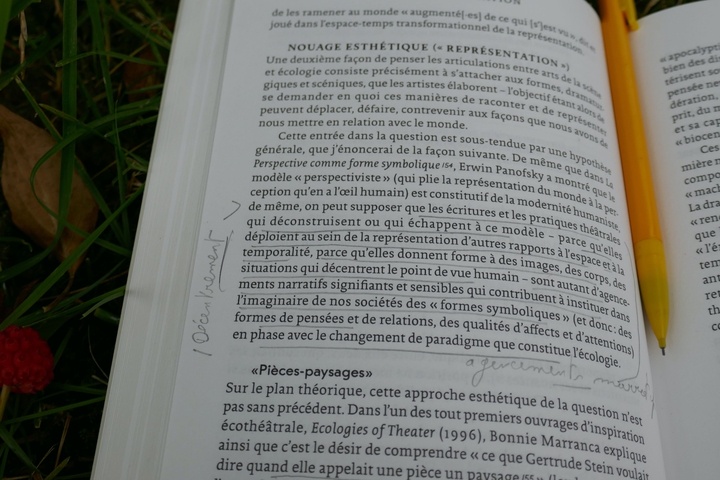
Les atouts des arts vivants
Julie Sermon présente l’appareil critique qui l’a aidée dans ses investigations, retraçant notamment l’historique du mouvement « écocritique », produisant analyse, critique et mises en perspective. Dans ce mouvement, elle égrène une riche et judicieuse bibliographie pour nous documenter par nous-mêmes, aller plus loin. Elle pose la question de savoir si le théâtre, « prioritairement centré sur les actions et les histoires humaines », est en phase avec le fait de « s’inscrire dans la grande mutation de valeurs inhérente à la pensée écologique, à savoir : remettre en cause l’anthropocentrisme, attirer l’attention sur (et inviter à développer de nouvelles relations avec) le "monde-plus-qu’humain" ». (p.46)
Cela étant pointé, elle souligne d’autre part ce qui peut rapprocher théâtre et écologie :
- « C’est un art « vivant », soit un espace-temps circonscrit, limité, au sein duquel tout un ensemble d’énergies et d’informations vont se trouver mises en circulation et se transformer (d’où le parallèle souvent établi entre représentation et écosystème) ;
- « Ce sont des œuvres qui naissent et dépendent des interactions propres à une pluralité d’agents et d’éléments (humains et non humains, organiques, matériels, immatériels) ;
- « C’est un art, enfin, qui pose de manière particulièrement aiguë la question du milieu dans lequel les œuvres émergent puis se déploient (relation aux spectateurs, aux lieux de représentations, au présent de la société. » (p.46)
Les bonnes intentions ne suffisent pas
Après avoir structuré son approche et expliqué sa démarche, le troisième chapitre se concentre de façon pointue – théorique autant que pratique – sur les spécificités de cette thématique dans le monde des arts vivants, en examinant les articulations entre écologie et théâtre selon trois points de tension et de nouage : les thématiques, ce que l’on raconte, ce que l’on met en scène ; le pragmatisme, l’impact des questions environnementales sur les processus de création, de représentation, de production des spectacles ; la dramaturgie et l’esthétique qui visent « les formes et relations que nouent les corps, les matérialités, les espaces et les temps de la représentation ». Pour chacune de ces approches, l’autrice expose les possibles, ce que les arts vivants peuvent mettre en place et comment, soulignant les faiblesses et les forces, pointant les biais inhérents à toute démarche artistique se dotant d’un tel « programme » : par exemple, le risque d’en rester à quelque chose de trop didactique, voire de contribuer, avec les meilleurs sentiments du monde, au greenwashing général. Les bons sentiments ne suffisent pas à faire du bon théâtre et, donc, ne parviendront pas non plus à nous faire avancer vers un nouvel imaginaire. La vraie difficulté est pointée (et elle vaut pour tous les arts) : « mais disons que tant que les artistes s’en tiennent à un discours sur l’écologie – au lieu d’en faire un point de départ pour l’invention d’histoires, de gestes, de situations dramaturgiques et scéniques –, le risque est grand de tomber dans le piège de la pièce à thèse, et/ou de la naïveté lénifiante ». Ce qui génère ennui, auprès des convaincus comme des néophytes.
Le moralisme est un écueil auquel les artistes soucieux·ses d’écologie risquent souvent de se heurter. Si louables soient les intentions, si sincère soit le désir d’alerter les consciences, prêcher la bonne parole écoresponsable a pour effet de passablement ennuyer les spectateur·trices (on leur fait la leçon de façon plus ou moins infantilisante, et souvent en leur rappelant des choses qu’ils·elles savent déjà fort bien), ou bien de les culpabiliser (mode d’adresse dont les effets sont bien plus inhibiteurs que proprement mobilisateurs. — Julie Sermon
C’est en s’attaquant à ce « saut » dans la création, au-delà de la démarche « à thèse », en décrivant ce que signifie cette « invention » en termes d’écosystème que Julie Sermon fait avancer le schmilblick. Le texte est illustré de très nombreux exemples de créations qui donnent des pistes. Voilà, on avance. Si le texte intéressera surtout le secteur des arts vivants, il concerne tout autant les spectateur·trices potentiel·les que nous sommes : aux artistes d’inventer les bonnes articulations entre écologie et théâtre, à nous d'en préparer la bonne réception et les interprétations individuelles et collectives. Dans une telle « bataille culturelle », tout le monde au front !
Pierre Hemptinne
Références : Julie Sermon, Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants », Éditions B42, 2021