Numérique : choisir nos rêves, fabriquer nos épopées.

Sommaire
La place du fragile.
Comment raconter L’Épopée des rêves contradictoires, spectacle cristallisé au fil d’ateliers de narration fréquentés par des personnes dites « fragiles » ? La difficulté à établir un constat clair et affirmatif de ce qui est vu sur scène tient à la richesse de sa proposition, qui part à rebours de toutes les évidences dont on nous entoure. On y renoue avec l’épaisseur, la profondeur déroutante des choses, là où elles nous touchent, rompant avec les interfaces dont la fonction est d’occulter la relation avec la matière, au comment ça fonctionne. Quelque chose comme l’origine brute du sensible revient à nous, en rêve. Et l’on se sent peu de chose mais avide.
Il faut prendre la mesure du positionnement culturel : il est inapproprié de parler d’ateliers avec personnes fragiles. La fragilité, ici, est le sujet, elle n’est pas répartie entre personnes saines et malades, c’est la fragilité du monde dont nous sommes tous et toutes des détenteurs à parts inégales et qui est le reflet de la souffrance qu’inflige la société actuelle, brutale, blessant les capacités à se raconter, individuellement et collectivement. En s’appuyant sur de nombreux récits mythologiques – notamment celui du roi fondateur de l’Empire mandingue, roi pacifiste, roi handicapé, qui unifia des gens de cultures différentes grâce à une charte de paix –, la fragilité est posée comme une chance. La fragilité comme source d’une narration collaborative, inspiration d’un nouveau « faire monde ». Il n’y a pas, ici, d’individus sains qui cherchent, par telle ou telle pratique, à guérir d’autres individus atteints de divers handicaps. L’objectif est plutôt de tirer parti, ensemble, de nos fragilités, d’en faire des biens communs, des puissances politiques. Et c’est là qu’il faut souligner les liens structurels entre le travail de Julien Stiegler et l’institution culturelle qui l’héberge, La Fabrique de Théâtre. Pour Valérie Cordy, en effet,
[il faut placer] la richesse de la pauvreté au centre d’une proposition culturelle. C’est un axe qui devient une mission de La Fabrique, le lien entre culture, institutions culturelles et le soin au sens large. Au sens large parce que, ces personnes fragiles, elles prennent soin de nous, aussi. — Valérie Cordy, La Fabrique de théâtre
Le travail de ces ateliers s’organise autour de la personnalité de Julien Stiegler. Il vient avec ses bouts de rêves, des fragments de narration, des poèmes, des chansons, des bricolages. Tout cela, au contact des participant·e·s aux ateliers, se mue en objets transitionnels. Ce sont les matériaux de base à partir desquels chaque participant·e aux ateliers va libérer et embrayer avec ses propres gestes, mots, sons, images, souvenirs, rêves, associations d’idées. Les uns et les autres viennent avec des objets, des matières, des textures, des sons. En s’associant aux outils et traces mnésiques de Julien Stiegler, ce sont autant de démarrages narratifs. En se connectant, chemin faisant, aux sources anthropologiques de la diversité culturelle : d’où viennent les pulsions à (se) raconter, comment se croisent-elles ?
Immersion et vue d’ensemble, de l’archaïsme au sophistiqué.
Si je disposais d’un plan séquence panoptique du spectacle, je pourrais, minute après minute, décrire tout ce qui se passe et je prendrais conscience des multiples strates superposées, imbriquées, chevauchées. Ça démarre, et tout est là, les hommes, les femmes, les éveillés, les dormeurs, les machines, les câbles, la technologie, les écrans, les dispositifs, les instruments de musique. Ça ne donne pas l’impression d’une restitution de choses apprises, mais d’un happening, d’une performance. L’accroche est même linéaire. Comme dans ces expériences où tous les « dessous » sont montrés, tous les « trucs » sont rendus apparents, il règne là une étrange transparence. Une transparence qui, au fur et à mesure qu’elle avance, engendre de l’opacité, une sorte d’opacité qui ouvre les yeux. Pulsation d’apparitions et disparitions. Et très vite je ne sais plus par où commencer le récit de ce que j’ai vu et entendu. Je peux au minimum décrire et raconter une matière, un emboîtement de phénomènes, les apparences d’un dispositif. C’est comme de scruter un moniteur où des lumières clignotantes, en imagerie médicale, signalent quelles zones du cerveau entrent en activité sans pour autant être à même de comprendre ce que cela produit, en quoi cela se traduit, et selon quelle élaboration cela intègre un ensemble, selon quelles liaisons. On sait juste dans quelle zone ça se fabrique. Une femme s’adresse à une caméra et, peu après, son image et ses paroles vivent sur un écran, ou plus exactement, on la voit vivre ailleurs, ici et là-bas, maintenant et dans une autre temporalité. Le rêve d’une « péniche à l’entrée belle et rafistolée comme le cosmos habité » s’énonce, et la péniche traverse la salle. Puis, les personnes physiquement là, devant nous, se retrouvent sur le bateau, au fil de l’eau. Au fil de nos pensées. La lumière illumine une terre et des résidus végétaux dans un aquarium, bouts de bois et carton, graminées, écorces, pierres. Cela devient le paysage d’une immense forêt enchantée sur grand écran et le personnage s’y avance, portant des lanternes de mineur. C’est l’ubiquité révélée, une dimension essentielle du rêve. Un acteur enchaîne des poses sur un monochrome bleu et son image est propulsée dans d’autres vies, d’autres décors, se multiplie, rencontre d’autres êtres, faufilés ou en surimpression envahissante, furtifs ou affirmés, figés ou hyper actifs. La multiplicité de toute forme vivante en ses différents plans de réel. Les trames abstraites et symboliques, projetées comme des cosmos en action, sont générées par des manipulations d’objets naturels trouvés et de dessins. La parole peut être très directe, comme lors d’une interpellation intrusive, un personnage qui vient rompre le cours ordinaire, un bateleur charmeur. Elle peut être chantée, explicite, accompagnée à la guitare, offerte pour faire son chemin et finir reprise en chœur. L’ensemble est pris dans une coulée méga-textuelle dense qu’il devient impossible de suivre, de démêler. Un enchaînement de bouts de récits prosaïques, détourés, d’extraits de poèmes, de citations de textes sacrés. Et, inopinément, le tout est brisé par une intervention « parasite », l’allée et venue de plusieurs destins fragiles, tout entiers concentrés sur leurs idées fixes. Qui du coup rebondissent, étoilées. Perturbations qui entretiennent la dynamique onirique de l’ensemble. Le tout scandé par des coups de sonnettes cristallines qui signalent chaque fois le début d’un nouveau rêve. Mais quand finissent-ils, sont-ils tous distincts les uns des autres, ne sont-ils pas emboîtés en abîme ?
Je suis la banlieue d’une ville qui n’existe pas. Le commentaire prolixe d’un livre qui n’a jamais été écrit. Je ne suis personne, personne, je ne sais pas sentir, je ne sais pas penser. Je ne sais pas vouloir, je suis une personne de roman encore à écrire et qui passe, aérien. Et défait, sans avoir été les rêves de qui n’a pas su me formuler. — Fernando Pessoa, "Le Livre de l’Intranquillité", cité dans le spectacle
On pourrait dire que c’est la meilleure description de l’étrange énergie, galvanisée, accomplie et inaccomplie, qui baigne tout le spectacle.

La machine à déconditionner, à inventer d’autres couplages homme-machine
Le cadre supérieur de la scène ressemble à un écran d’ordinateur. Le titre du rêve en train de se dérouler s’y inscrit, ainsi que quelques lignes de texte code. À tout ce qui semble se dérouler sous nos yeux de façon quasi spontanée s’ajoute ainsi une dimension machinique. On pense plutôt à une machine « hackée », libérée.
Il faut savoir que dans la représentation qui se déroule sous nos yeux, aucune image et aucun son ne sont préenregistrés. Tout est en direct. Les acteurs semblent jouer avec le dispositif technologique, prolongation de leurs organismes : caméras, tables lumineuses, tables de mixage, ordinateur… Mais, à ce niveau, rien n’est improvisé, tout est scrupuleusement détaillé dans un storyboard. La narration n’est pas simplement constituée des mots, des images mentales racontées, du mouvement des corps, des images projetées sur écran et des sons produits, mais aussi des logiciels qui rendent possible l’orchestration de tous ces éléments en un tout, et fait surgir fantômes, déplacements, superpositions, incrustations, mutations, fantasmes. Les logiciels sont développés par Julien Stiegler et conçus comme outils narratifs, à partir des besoins rencontrés lors des ateliers, au contact des imaginaires mis en commun. Ce ne sont pas des interfaces numériques toutes faites, hermétiques, auxquelles il convient de se conformer. Ce support n’a rien d’hermétique.
Quand Julien Stiegler fait visiter les arcanes des logiciels, ça peut paraître complexe, certes, on ne maîtrise pas tout, mais on comprend les logiques, on reconnaît des expériences personnelles de relations à l’outil. Si le spectacle dure deux heures, ce qui s’engendre est au final un organisme de
deux heures de couches séparées en incrustation avec des transparents qui sont en demi-résolution par rapport à la HD, mieux que le format télé. On enregistre avec du matériel qui permet de faire une vraie post-production cinématographique, un vrai étalonnage. On a toute cette matière, tous les sons et images, disponibles en séparé, et petit à petit, outre les gens qui vont et viennent sur scène, il y a tous les liens possibles entre ces contenus enregistrés, un peu à la manière des rêves aborigènes, un potentiel énorme de liens pour se frayer des chemins narratifs, tout en bifurcations. — Julien Stiegler
Matière vivante qui stimule les correspondances, les associations d’images et d’idées, les collages surréalistes de sensibilités plurielles. C’est dire que la confrontation au numérique, dans le processus de création de ces ateliers, est perçue comme une matière à modeler, une prothèse intelligente avec laquelle dialoguer, avec le temps et l’espace nécessaires pour penser et sentir la relation au sensible via le dispositif technologique. Ce qui se met en place est une arène où peuvent se penser et s’expérimenter d’autres couplages hommes-machines, avec leurs alphabets et écritures spécifiques.
Un outil mobile et plastique pour engendrer de la diversité culturelle
L’Épopée des rêves contradictoires, comme dispositif, est mobile, se déplace facilement, n’a pas besoin d’un grand espace pour être présenté. C’est un contenu évolutif et plastique, il intègre de nouveaux éléments au fil des ateliers qui se poursuivent, il s’adapte aux contraintes des lieux. Il est surtout, pour les professionnels de la culture, l’occasion de se pencher sur un appareillage numérique réellement pensé en fonction des missions culturelles publiques.
Comme le souligne Yves Citton dans la citation ci-dessous, il est urgent d’encourager, de faire tourner et d’apprendre au contact de ceux qui font évoluer le numérique vers autre chose que l’entrepreneuriat technologique :
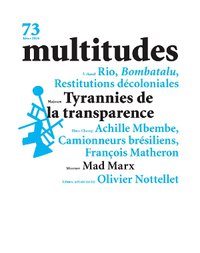
« Plus que dans les jugements tranchants, les lamentations désespérées ou les revendications nostalgiques, c’est donc peut-être du côté de ceux qui font quelque chose de créatif à partir des appareillages numériques qu’il convient de diriger désormais notre attention. (…) Contre ceux qui font de la transparence un outil d’un retour au réel univoque et sans l’ombre d’un doute, rien n’est plus urgent que d’insister sur les multiples « parences » que charrie transparence, ses effets de déplacement, ses métamorphoses, ses « trans »-positions. (…) C’est sans doute en faisant converger théoriciens et plasticiens, savants et bidouilleurs, experts et hackeurs, recherche et création, que nous parviendrons au mieux à nous réapproprier les médiations d’une transparence qui menace aujourd’hui de nous aliéner. Ce qui se dessine, dans ce recroisement des approches, c’est le constat qu’il n’y a de transparence que là où y a de la superposition, et donc du surnuméraire. À une époque qui est mue par un gigantesque désir de coïncidence, de retrouvailles fusionnelles avec le réel, ces pratiques de mises en transparence nous rappellent au contraire que là où ça se superpose, il y a de la pluralité en excès. »
(Yves Citton, in Multitudes, numéro 73, dossier « Tyrannies de la transparence », p.54)
Théoricien, plasticien, savant, bidouilleur, expert, hackeur, chercheur, créatif, toutes les facettes sont réunies dans ce qui donne naissance à ce fragment de poésie épique.

Pierre Hemptinne
article paru à l'origine dans le n°13 de la revue Lectures.Cultures, mai 2019
site : lafabrique.be/en-creation