Peinture habitée, peinture habitante

Sommaire
Créateur de l’Atelier d’Espaces urbains et ruraux à La Cambre (1975), Jean Glibert fonde une pratique sensible qui éclaire nos relations à l’espace, aux lieux de vie. La Fédération Wallonie Bruxelles et Bozar lui rendent hommage. Mais comment s’éprouve cette peinture en bâtiment ?
L’art de la lettre volée

Je ne pense pas qu’il soit aisé de reconnaître pleinement ce
qu’est le travail du peintre en bâtiment.
Je ne pense pas que, du fait que cette peinture s’applique directement sur des
lieux de vie, dans la rue, elle
s’appréhende et s’expérimente forcément sans barrière symbolique à franchir,
sans initiation. Au fur et à mesure que la peinture s’éloigne de la toile, ou
de ses autres supports académiques, ne complexifie-t-elle pas les règles du jeu
en rendant l’expérience esthétique beaucoup plus globale, enveloppante ? Celle-ci,
prise dans les jeux de surface et volumes ordinaires, imprégnant leurs textures
ou juste posée là à la manière d’un nimbe provisoire (on songe aux lumières
d’un arc-en-ciel, très vives puis s’estompant), comme toute peinture de
bâtiment, peut passer inaperçue, être vue sans forcément être identifiée,
fondue dans l’environnement, en harmonie immanente ou d’un hermétisme
transparent. Intercalée dans le trop plein de choses qui accaparent l’œil, là,
perdue, elle cultive, selon moi, l’art de la lettre volée. Elle est là dans une
évidence qui la cache. Même dans les réalisations les plus éclatantes, les
moins discrètes, je pense que beaucoup de personnes qui les voient ignorent que
cela s’inscrit dans un engagement artistique réfléchi, inscrit dans la durée
(il n’en va pas de même quand leurs présentations interviennent dans un cadre
artistique bien défini, genre « exposition de groupe »). Et pourtant,
une fois qu’on réalise sa présence, filtrant la saturation des formes, couleurs
et volumes, "désintricant" le fouillis, y distillant une distinction, un début de
lecture, une possibilité de résonner autrement avec ce qui nous entoure, de
capter des scansions, des lumières, des respirations, des récits, se fait jour.
Comme toute chose invisibilisée du fait d’être trop vue ou de se camoufler au
sein du trop vu, elle peut certes modifier la perception du milieu qu’elle
infiltre. Est-ce cela l’impact de ce que l’historien de l’art appelle mettre
l’architecture « sous tension » ?
Collections de choses et prise du monde en main
« Rassembler des formes qui se ressemblent et pourtant ne cessent de différer, c’est débusquer des rythmes, la musique sous l’organisation des objets, leur reproduction et emboîtement à travers tout ce qui fabrique du monde, des mondes. — »


Par où commencer ? Par où se faire accrocher ? Par
ce qui raconte l’aventure humaine. Se faire happer par le regard et l’appareil
méthodiques de l’artiste. Ce qu’il regarde, ce que sa mémoire emmagasine et grave,
engramme, transforme en matériau grammatical. Là où il va puiser les matériaux
de ce qui lui importe d’exprimer. Les collections de choses, mises sous vitrine, à la manière d’objets et d’outils issus
de traditions à déchiffrer, liées à des techniques artisanales traduisent tout
un imaginaire de prise du monde en main.
Des séries, des accumulations obsessionnelles du même. Des provisions aussi,
pour éviter de manquer, renouveler sans cesse la surprise, face aux vitrines,
de découvrir ces choses, d’en inventer les usages. Des multitudes de crayons,
rassemblés par numéros, pointes nues ou couvertes de capuchons métalliques. Des
accumulations qui attestent du besoin de toucher la matière dans toute son
ampleur, non pas massive, mais friable, multiple, constituée de strates. La
répétition laisse des traces, balise des déplacements. Pouvoir empoigner des
bottes de crayons, les attacher, les ranger les unes à côté des autres, c’est
toucher de manière plus évidente, plus organique, la fibre de l’objet. Rassembler
des formes qui se ressemblent et pourtant ne cessent de différer, c’est débusquer
des rythmes, la musique sous l’organisation des objets, leur reproduction et
emboîtement à travers tout ce qui fabrique du monde, des mondes. Des formes à
pâtisserie. Des flotteurs de canne à pêche, variations sur un même thème, les
galbes diffèrent, la taille, les couleurs, selon les poissons à attirer. Des
jouets de signalisation, poteaux, potences, barrières, signaleurs, rayures
vives, sortes d’antennes exacerbées, naïves, pluridirectionnelles. Plus
fascinantes, des choses rares, comme orphelines, dont il reste à deviner à quoi
elles pourraient servir. Une réserve de sources vierges, non explorées.
Excitation de chercher de quoi elles sont le manque à combler.
L’œil plane, erre : photographies
« On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course de repères, préparer un possible ancrage. — »
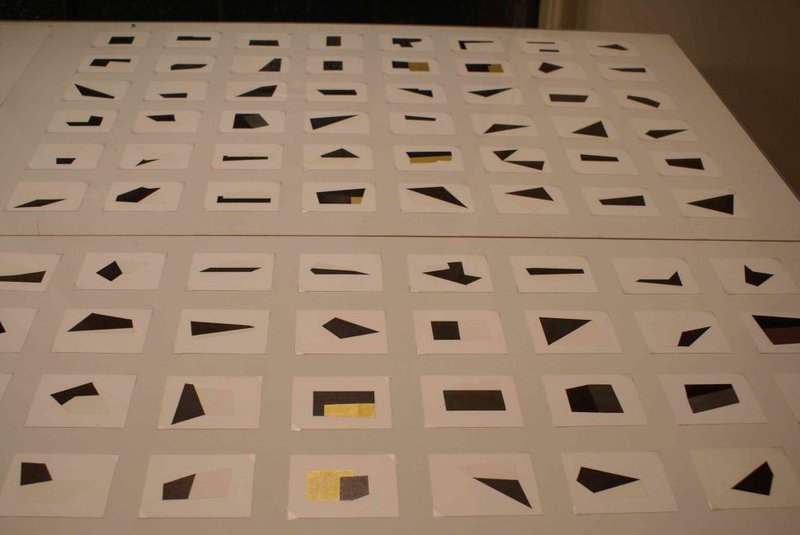 À compléter par le cahier qui, dans le catalogue, réunit un
large choix, et pourtant tellement fragmentaire, de photos prises par
l’artiste. Planche contact. Mais, ce ne sont pas tellement des prises de vue,
plongeant dans ce quadrillage fouillé d’images, on partage un instant la
manière dont l’artiste regarde le monde. Un réseau neuronal. Ce qui attise son
attention lors de ses déplacements, en ville, en voyage, à la campagne. Des
matières, du macadam morcelé, un immeuble en briques et Eternit rouges,
écaillé, bouchardé. Des formes moulées dans d’immenses bâches plastiques
souples, sur la benne d’un convoi extraordinaire, des stères de bois coupé,
rigoureuses… Des rythmes, des alignements de tombes militaires, minimalistes,
blanches, des accumulations de barrières, des panneaux de signalisation
routières agglutinés sur le trottoir ou dans la benne d’une camionnette, des
empilements de grosses conduites en terre cuite, des troncs d’arbres
badigeonnés de blanc irrégulier et granuleux, des colonnes de papiers, des
meules de foin ligotées à la ficelle rouge… Des formes étranges, des pignons en
brique où subsistent les fantômes géométriques d’anciennes maisons mitoyennes,
détruites ; d’autres, en travaux, matelassés de plastique, parfois
maintenus par des lattes de bois en pagaille ; des coffrets électriques,
dans la rue, recouverts de housse blanche. L’œil plane, erre, regroupe par
familles. Des couleurs, des formes géométriques peinturlurées sur des façades
de maison, des tissus, des phares maritimes aux anneaux gris et blancs, des
camionnettes utilitaires rayées rouge et blanc, une autre couverte de carrés et
rectangles multicolores, très Malevitch, des podiums ambulants avec leurs
auvents de toiles striés bleu et blanc, rouge et vert … Beaucoup de signes qui
indiquent des mouvements, des courants contrariés, des marques au sol comme
renseignant quelque chose à déterrer, des trajectoires peinturlurées sur le
macadam, des lignes et courbes comme fragments de labyrinthe, droites qui
s’épousent, courbes qui divorcent, des panneaux de circulation occultés, annulés,
les destinations masquées par du plastique gris collé, recherche de supports
surfaces. Des effets de lumières, la nuit, quand tous les feux d’un véhicule
qui roule projettent des traits multicolores qui dansent, des guirlandes
figuratives recouvrant des maisons, un trait blanc aérien dans un ciel couchant…
À l’infini. On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines
textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de
tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les
rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des
intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est
une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble
qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course
de repères, préparer un possible ancrage. Juste une ligne de fuite. Tandis
qu’avec Jean Glibert, cette pulsion est systématisée, la transe en est assumée,
transformée en matériau de connaissance du monde, devient encyclopédique. L’artiste
y cherche les éléments d’un langage sous-jacent à tous les décors du quotidien,
et particulièrement à ce qui, mine de rien, dans ce défilé ou stagnation de
palimpsestes qui s’ignorent, les perturbe, sème le trouble, jette des
ressemblances, convoquent des rémanences, avec quoi il souhaite interagir,
entrer en communication, intervenir « dans la distribution de la lumière,
de la couleur et de l’espace ». C’est une conjonction intrigante de
l’intime et de l’espace public, l’un reflétant l’autre, et vice versa, dans une
sorte de mise en abîme de la question existentielle, qu’est-ce qu’habiter, existentielle et vécue à fleur de peau.
À compléter par le cahier qui, dans le catalogue, réunit un
large choix, et pourtant tellement fragmentaire, de photos prises par
l’artiste. Planche contact. Mais, ce ne sont pas tellement des prises de vue,
plongeant dans ce quadrillage fouillé d’images, on partage un instant la
manière dont l’artiste regarde le monde. Un réseau neuronal. Ce qui attise son
attention lors de ses déplacements, en ville, en voyage, à la campagne. Des
matières, du macadam morcelé, un immeuble en briques et Eternit rouges,
écaillé, bouchardé. Des formes moulées dans d’immenses bâches plastiques
souples, sur la benne d’un convoi extraordinaire, des stères de bois coupé,
rigoureuses… Des rythmes, des alignements de tombes militaires, minimalistes,
blanches, des accumulations de barrières, des panneaux de signalisation
routières agglutinés sur le trottoir ou dans la benne d’une camionnette, des
empilements de grosses conduites en terre cuite, des troncs d’arbres
badigeonnés de blanc irrégulier et granuleux, des colonnes de papiers, des
meules de foin ligotées à la ficelle rouge… Des formes étranges, des pignons en
brique où subsistent les fantômes géométriques d’anciennes maisons mitoyennes,
détruites ; d’autres, en travaux, matelassés de plastique, parfois
maintenus par des lattes de bois en pagaille ; des coffrets électriques,
dans la rue, recouverts de housse blanche. L’œil plane, erre, regroupe par
familles. Des couleurs, des formes géométriques peinturlurées sur des façades
de maison, des tissus, des phares maritimes aux anneaux gris et blancs, des
camionnettes utilitaires rayées rouge et blanc, une autre couverte de carrés et
rectangles multicolores, très Malevitch, des podiums ambulants avec leurs
auvents de toiles striés bleu et blanc, rouge et vert … Beaucoup de signes qui
indiquent des mouvements, des courants contrariés, des marques au sol comme
renseignant quelque chose à déterrer, des trajectoires peinturlurées sur le
macadam, des lignes et courbes comme fragments de labyrinthe, droites qui
s’épousent, courbes qui divorcent, des panneaux de circulation occultés, annulés,
les destinations masquées par du plastique gris collé, recherche de supports
surfaces. Des effets de lumières, la nuit, quand tous les feux d’un véhicule
qui roule projettent des traits multicolores qui dansent, des guirlandes
figuratives recouvrant des maisons, un trait blanc aérien dans un ciel couchant…
À l’infini. On reconnaît, dans cette compulsion à enregistrer certaines
textures de l’environnement, une manie assez courante : dans la vie de
tous les jours, au fil des véhicules qui nous transportent, filant dans les
rues ou les champs, les zones industrielles ou portuaires, l’œil repère des
intervalles, des similitudes, essaie de les compter, abandonne, recommence. C’est
une manière de combler le vide, de se familiariser avec ce qui ne semble
qu’éphémère et inerte, n’offrant aucune prise, une façon de jalonner la course
de repères, préparer un possible ancrage. Juste une ligne de fuite. Tandis
qu’avec Jean Glibert, cette pulsion est systématisée, la transe en est assumée,
transformée en matériau de connaissance du monde, devient encyclopédique. L’artiste
y cherche les éléments d’un langage sous-jacent à tous les décors du quotidien,
et particulièrement à ce qui, mine de rien, dans ce défilé ou stagnation de
palimpsestes qui s’ignorent, les perturbe, sème le trouble, jette des
ressemblances, convoquent des rémanences, avec quoi il souhaite interagir,
entrer en communication, intervenir « dans la distribution de la lumière,
de la couleur et de l’espace ». C’est une conjonction intrigante de
l’intime et de l’espace public, l’un reflétant l’autre, et vice versa, dans une
sorte de mise en abîme de la question existentielle, qu’est-ce qu’habiter, existentielle et vécue à fleur de peau.
Un paysage partagé
« Quelqu’un de non averti va-t-il spontanément identifier ce qu’il y a à voir en tant que peinture d’artiste en bâtiment ? Mais oui, on y regarde à deux fois, on scrute, oui, bien sûr, il y a quelque chose de spécial. Ces photos semblent avoir débusqué quelque chose de présent depuis toujours et qui n’avait pas, forcément, atteint la pleine conscience. Grâce au défilé photographique, une présence noyée dans le décor, est révélée dans sa singularité. — »
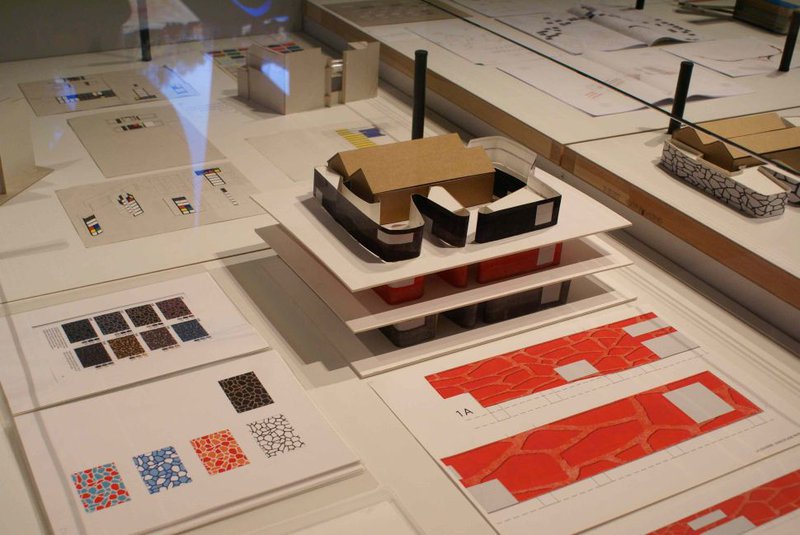 Cet « à fleur de peau » est aussi ce qui frappe
face au film dans lequel l’artiste parle de son travail. À la limite, au début,
on entend peu les paroles, juste une ligne mélodique de la voix, et les mains
qui discourent, racontent. Ce n’est pas pour opposer la main au cerveau, au
contraire, comme jamais, on se rend compte que le cerveau est partout dans
l’organisme, simplement, là, c’est la narration des mains qui prime. Les
paluches de l’artiste, éprouvées et délicates, maniant une brosse large. II
peint une forme. Va et vient de l’outil. C’est plus qu’un travail d’étendre
soigneusement la couleur. C’est comme plutôt arriver à la faire surgir et
prendre telle qu’en elle-même, chercher la forme en adéquation avec le support,
la couleur, la brosse, son manche, ses poils, la main, le bras et tout ce qui
vient avec de corporel, de spirituel. Travail contemplatif, rituel
d’invocation. Ces formes peintes exposées aussi sous vitrine – alignées à la
manière de collection abstraite ou de planche contact mentale - évoquent des
signes de ponctuation, des pièces orphelines que l’on imagine destinées à
combler des vides dans une trame imaginaire. Des séries de tracés géométriques,
précis, probablement déterminés par toutes sortes d’informations recueillies
lorsque le regard de l’artiste balaie l’environnement, scanne la trame des
choses qui forment décor et récit spatial quotidien, et probablement conçues
pour s’y insérer, infléchir certains caractères, modifier le rythme pour le
rendre plus enveloppant, mieux rythmé et aéré, modifier les chances d’y trouver
un fil harmonieux, un gimmick empathique. Interpréter à même le texte. Inscrire
d’autres sens de circulation, d’autres giratoires.
Cet « à fleur de peau » est aussi ce qui frappe
face au film dans lequel l’artiste parle de son travail. À la limite, au début,
on entend peu les paroles, juste une ligne mélodique de la voix, et les mains
qui discourent, racontent. Ce n’est pas pour opposer la main au cerveau, au
contraire, comme jamais, on se rend compte que le cerveau est partout dans
l’organisme, simplement, là, c’est la narration des mains qui prime. Les
paluches de l’artiste, éprouvées et délicates, maniant une brosse large. II
peint une forme. Va et vient de l’outil. C’est plus qu’un travail d’étendre
soigneusement la couleur. C’est comme plutôt arriver à la faire surgir et
prendre telle qu’en elle-même, chercher la forme en adéquation avec le support,
la couleur, la brosse, son manche, ses poils, la main, le bras et tout ce qui
vient avec de corporel, de spirituel. Travail contemplatif, rituel
d’invocation. Ces formes peintes exposées aussi sous vitrine – alignées à la
manière de collection abstraite ou de planche contact mentale - évoquent des
signes de ponctuation, des pièces orphelines que l’on imagine destinées à
combler des vides dans une trame imaginaire. Des séries de tracés géométriques,
précis, probablement déterminés par toutes sortes d’informations recueillies
lorsque le regard de l’artiste balaie l’environnement, scanne la trame des
choses qui forment décor et récit spatial quotidien, et probablement conçues
pour s’y insérer, infléchir certains caractères, modifier le rythme pour le
rendre plus enveloppant, mieux rythmé et aéré, modifier les chances d’y trouver
un fil harmonieux, un gimmick empathique. Interpréter à même le texte. Inscrire
d’autres sens de circulation, d’autres giratoires.
Sur le mur défilent de grandes photos lumineuses, des
paysages. Vues de parking souterrains, hall multifonctionnel, couloirs d’hôpitaux,
ring urbain, magnifique limnimètre en haute Meuse (appareil qui mesure et
enregistre la mesure de la hauteur de l’eau), ponts, autoroutes, maisons
privées, CPAS… Quelqu’un de non averti va-t-il spontanément identifier ce qu’il
y a à voir en tant que peinture d’artiste en bâtiment ? Mais
oui, on y regarde à deux fois, on scrute, oui, bien sûr, il y a quelque chose
de spécial. Ces photos semblent avoir
débusqué quelque chose de présent depuis toujours et qui n’avait pas,
forcément, atteint la pleine conscience. Grâce au défilé photographique, une
présence noyée dans le décor, est révélée dans sa singularité. Parce que l’on
reconnaît l’un ou l’autre de ces paysages, on y est déjà passé, ou ils
ressemblent à d’autres semblables qui, eux, sont dépourvus de ce supplément
d’âme, parties colorées, alors que ces autoroutes, ces travaux d’art de la
chaussée, c’est bien connu, se ressemblent tous. À l’instant où l’on reconnaît
l’intervention de l’artiste pour ce qu’elle est, telle que la documente la
photo, cela paraît évident et ça déclenche même autre chose. Cela fait écho à
nos propres manières d’être qui cherchent à rendre ces urbanisations, souvent
plutôt inertes, hospitalières à nos singularités. Que faudrait-il changer,
ajouter, déplacer, pour s’y retrouver, que l’on s’y retrouve ? Ces
interventions de l’artiste, par le processus qui conduit à les remarquer, à les
embrasser et les réfléchir, invoquent les propos du géographe Michel Lussault
selon lequel l’espace n’est pas une étendue délimitée qui contient ce qui s’y
passe, mais toujours avant tout une "relationnalité" des choses et des humains.
L’œil, alors, repasse sur les photos, y voyage autrement, ce sont des fenêtres,
de nouvelles perspectives. Il y cherchait des traces précises, circonscrites.
Il les a saisies en passant au crible tout le visible restitué par ces grandes
images lumineuses. L’intervention de l’artiste, finalement, ne se limite pas à
tel élément d’une architecture retouchée, à telle partie peinte d’une
infrastructure autoroutière, c’est la totalité du paysage qui se présente comme
tableau d’artiste, forcément en propriété partagée, sans aucune privatisation
de ce qui est montré et représenté, ce paysage demeurant celui de tout le monde
qui y passe et y vit une expérience spatiale singulière avec tous les éléments
qui s’y imbriquent. La démarche s’incarne évidemment avec plus d’évidence quand
l’intervention s’effectue au cœur même du projet architectural, d’emblée en
complicité avec l’architecte.
Ses mains parlent
« Il devient architecte, artisan, archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités travailleraient ensemble, à la même œuvre. — »
 Une fois qu’est bien assimilée cette dimension de ce
travail, cela devient très onirique, plus exactement, proche du sentiment de
voler dans un rêve. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour nos
« relations affectives avec l’espace », les espaces dans lesquels
nous vivons, que nous expérimentons et qui forment le matériau de nos récits
d’existence. Mais l’artiste lui-même s’envole peu, il tient les choses, les
mains dans le concret, dans le faire, ses magies empiriques. Il raconte,
pourquoi choisir telle peinture industrielle, en fonction de tel support,
question de réaction, et il raconte ce que cela exige comme savoir-faire, tour
de main à acquérir, sentir. Un examen
rigoureux, scientifique. Possibles
corporels racontés comme des paysages, des environnements dans lesquels poser
de nouveaux gestes, importance de la répétition de ces gestes, de leur
automatisme d’où s’échappe la nouveauté.
Quelles sont les interactions des produits, des surfaces, des outils
utilisés ? Le vocabulaire, les phrases et leurs tournures renvoient à une
alchimie contemporaine. Et l’impact sur les mouvements, le rapport au
corporel ? On écoute, on regarde encore une fois surtout les mains, les
doigts qui parlent, sans se lasser. C’est là qu’on mesure qu’il s’agit
d’innombrables récits de techniques, trouvées, apprises auprès d’autres
(compagnonnages), améliorées, transformées, d’innombrables récits de techniques
enroulées les uns sur les autres, pelures superposées. Avec, comme dans tout
travail basé sur les recommandations et une expertise ancienne, à un moment
donné, quelque chose qui dévie sensiblement, une invention, une façon de
singulariser, un style propre. Une bibliothèque orale et gestuelle de
narrations manuelles sur les technologies acquises au fil des projets, des
expériences, des défis dans l’espace. Le résultat d’une longue pratique de
terrain, de rencontres et de complicités avec les corps de métier et les
artisans. On ne s’élance pas seul avec son pot de couleur et son pinceau quand
il s’agit de colorer d’immenses surfaces de béton ou quand il convient
d’intervenir pour modifier la luminosité d’un bâtiment. Il faut collaborer,
expliquer, parler, confronter, apprendre. Et étudier, méticuleusement. Jean
Glibert ne laisse pas grand-chose au hasard. Il travaille comme un architecte,
avec des simulations miniatures, des maquettes. Il devient architecte, artisan,
archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités
multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités
travailleraient ensemble, à la même œuvre.
Une fois qu’est bien assimilée cette dimension de ce
travail, cela devient très onirique, plus exactement, proche du sentiment de
voler dans un rêve. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour nos
« relations affectives avec l’espace », les espaces dans lesquels
nous vivons, que nous expérimentons et qui forment le matériau de nos récits
d’existence. Mais l’artiste lui-même s’envole peu, il tient les choses, les
mains dans le concret, dans le faire, ses magies empiriques. Il raconte,
pourquoi choisir telle peinture industrielle, en fonction de tel support,
question de réaction, et il raconte ce que cela exige comme savoir-faire, tour
de main à acquérir, sentir. Un examen
rigoureux, scientifique. Possibles
corporels racontés comme des paysages, des environnements dans lesquels poser
de nouveaux gestes, importance de la répétition de ces gestes, de leur
automatisme d’où s’échappe la nouveauté.
Quelles sont les interactions des produits, des surfaces, des outils
utilisés ? Le vocabulaire, les phrases et leurs tournures renvoient à une
alchimie contemporaine. Et l’impact sur les mouvements, le rapport au
corporel ? On écoute, on regarde encore une fois surtout les mains, les
doigts qui parlent, sans se lasser. C’est là qu’on mesure qu’il s’agit
d’innombrables récits de techniques, trouvées, apprises auprès d’autres
(compagnonnages), améliorées, transformées, d’innombrables récits de techniques
enroulées les uns sur les autres, pelures superposées. Avec, comme dans tout
travail basé sur les recommandations et une expertise ancienne, à un moment
donné, quelque chose qui dévie sensiblement, une invention, une façon de
singulariser, un style propre. Une bibliothèque orale et gestuelle de
narrations manuelles sur les technologies acquises au fil des projets, des
expériences, des défis dans l’espace. Le résultat d’une longue pratique de
terrain, de rencontres et de complicités avec les corps de métier et les
artisans. On ne s’élance pas seul avec son pot de couleur et son pinceau quand
il s’agit de colorer d’immenses surfaces de béton ou quand il convient
d’intervenir pour modifier la luminosité d’un bâtiment. Il faut collaborer,
expliquer, parler, confronter, apprendre. Et étudier, méticuleusement. Jean
Glibert ne laisse pas grand-chose au hasard. Il travaille comme un architecte,
avec des simulations miniatures, des maquettes. Il devient architecte, artisan,
archiviste, collecteur de mémoire, urbaniste, artiste aux personnalités
multiples, à la manière d’un personnage de Pessoa dont toutes les identités
travailleraient ensemble, à la même œuvre.
Le catalogue
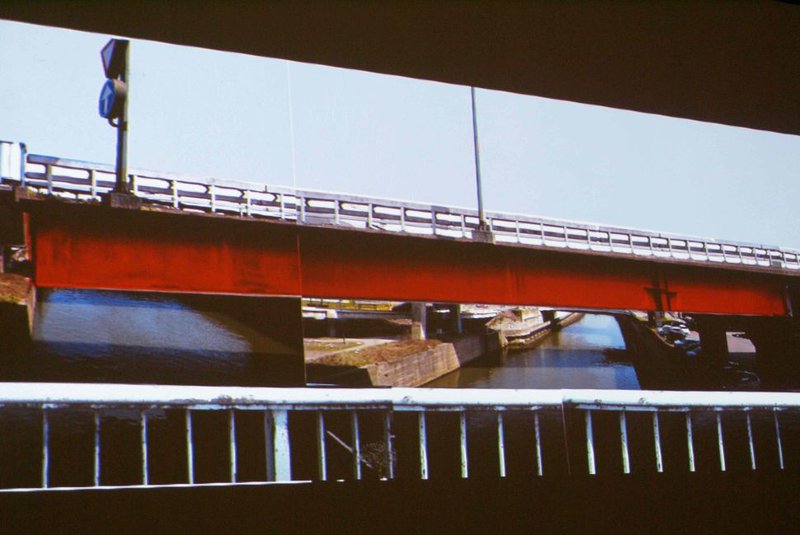 Les trois commissaires « Peintre en bâtiment » au
Bozar, travaillant en compagnonnage avec l’artiste, ont réussi à donner sens au
fait d’exposer ce type d’œuvre dans un musée. Ils en révèlent l’unité, la
cohérence interne, le fonctionnement imaginaire et là, au cœur de l’exposition,
l’imagination nous transporte dans différents lieux, où se trouvent les œuvres.
Et l’on sait que, dorénavant, en se déplaçant, en retournant en tel lieu, notre
relation "expérientielle", affective à cet espace précis ne sera plus la même.
Les trois commissaires « Peintre en bâtiment » au
Bozar, travaillant en compagnonnage avec l’artiste, ont réussi à donner sens au
fait d’exposer ce type d’œuvre dans un musée. Ils en révèlent l’unité, la
cohérence interne, le fonctionnement imaginaire et là, au cœur de l’exposition,
l’imagination nous transporte dans différents lieux, où se trouvent les œuvres.
Et l’on sait que, dorénavant, en se déplaçant, en retournant en tel lieu, notre
relation "expérientielle", affective à cet espace précis ne sera plus la même.
Le catalogue n’est pas un simple objet de merchandising
accompagnant l’exposition. C’est un véritable objet en tant que tel qui aide à
éprouver, avec les mains et le regard, la mise en espace de cette peinture.
Ce catalogue consiste en un assemblage de cahiers. L'un d'eux, se décomposant à son tour en divers éléments avec lesquels il faut jouer, aide à comprendre, physiquement, avec
les mains et les yeux, comment certains motifs naissent, se combinent mathématiquement
et musicalement et deviennent fresque géométrique. Un autre, fait de gros plans
d’ouvrages in situ, fait surgir le côté charnel de ce qui peut sembler
désincarné et brouille les catégories, car ce que l’on voit est montré comme
fragments de plusieurs grandes toiles pouvant se combiner. Certains se déplient
comme des plans de chantier et ressemblent à des grilles de lecture ou des
codes secrets, un autre rassemble des témoignages où éclate la dimension
ludique et festive de certaines interventions, un autre encore, déjà évoqué,
plonge dans ce que voit l’artiste, en amont de ces œuvres…
Pierre Hemptinne
Bozar
Jusqu'au Dimanche 7 janvier 2018
Exposition organisée à l’initiative d’Alda
Greoli, Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Production : Cellule architecture et Direction des Arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts (Bozar).
Commissaires de l’exposition : Michel De Visscher,
Emmanuel De Meulemeester, Laurent Jacob.
Catalogue : Jean Glibert et Mr & Mme
Le site de l’artiste : photos de tous ses travaux