Révolte : que fait la police ?

Notre modèle de société est à bout de souffle. L’économie productiviste, la croissance, le consumérisme, tous ces dogmes et prescriptions ont épuisé notre biosphère. Changer est plus qu’urgent. En regard de cette situation, les manifestations qui matérialisent dans l’espace public cette évidence de l’urgence sont de plus en plus encadrées, « tolérées », pour ne pas dire réprimées. Regardons les choses en place : un avis scientifique quasi unanime qui déclare la question climatique plus que préoccupante ; un immobilisme politique objectivé depuis des décennies ; des militant·e·s qui interviennent dans la rue pour, de façon non-violente et imaginative, renforcer le message scientifique. Le même schéma peut s’appliquer aux inégalités sociales, à l’augmentation de la pauvreté, à la disparition des services publics. Et que passe-t-il ?
Le citoyen lambda ne peut qu’être effaré, sidéré, par la disproportion du dispositif policier, par la violence des interventions pour disperser les manifestations et tenter de décourager les citoyens de revenir battre le pavé. L’arsenal exhibé, mis en scène, est proprement impressionnant.
Certaines photos des forces de l’ordre, comme celle illustrant l’article de Libération « Face aux mises en cause de la police, une loi pour « remporter la guerre des images », font peur. Comme si le pouvoir en place entendait envoyer aux citoyen·ne·s une fin de non-recevoir sans appel, à défaut de pouvoir endosser ses responsabilités face aux recommandations scientifiques. Cela ne s’appelle-t-il pas déplacer le problème : du débat raisonné et démocratique, faisons une question de « maintien de l’ordre » ? En psychanalyse on parlerait de transfert. Mais que fait la police, précisément ? Au-delà de donner l’impression d’un pouvoir acculé, enfermé dans ses derniers retranchements ?
Un petit livre percutant, publié par La Fabrique, répond plutôt bien à cette question. C’est un ouvrage collectif rassemblant des textes de personnes directement au contact des forces de l’ordre. Ce n’est donc pas une étude « scientifique ». C’est un travail d’observation, de ressentis, d’analyse de situations, de documentation, pour mieux comprendre la violence rencontrée et ceux qui la dispensent allègrement. C’est un corpus de savoirs vécus dans la chair, si je puis dire, de ces savoirs qui s’élaborent dans l’expérience, en soutien d’un engagement qui s’élabore d’action en action. En tant que militant·e, victime, réalisateur, philosophe, éditeur. Un ouvrage de partis pris ? Bien entendu, et heureusement. Cela vient compenser les rhétoriques lénifiantes des politiques couvrant leurs troupes. Cela équilibre ce que disent et montrent les médias mainstream en escamotant souvent une part du réel. Là, avec ces mots, ces témoignages, ces analyses, on entre dans la mêlée. Organiquement. Et l’on entend les mobiles, on entend travailler les logiques qui relient et articulent casques, visières, boucliers, matraques, flingues.
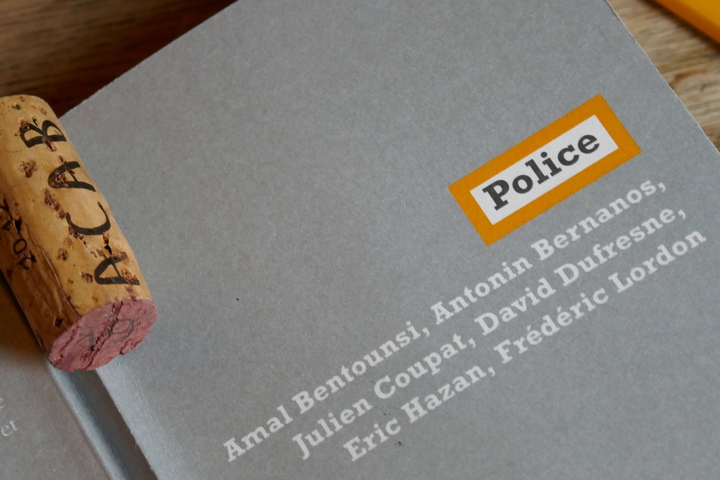
La guerre des images, les preuves que l’on ne veut pas voir
Comme jamais, les contacts frontaux avec la police fournissent des matériaux et des traces documentaires pour regarder, après coup, avec le recul, ce qui s’est réellement passé, revoir l’intentionnalité des mouvements, entendre les cris de haine et onomatopées guerrières que, sur le moment, on ne capte peut-être pas de façon détaillée.
Étudier, décrypter les accrochages. Tout un corpus de témoignages issu des affrontements se constitue grâce aux technologies mobiles qui permettent de filmer et enregistrer.
C’est ce que présente David Dufresne, réalisateur notamment de Un pays qui se tient bien sage. Rappelant quelques bavures effroyables récentes – dont le leitmotiv serait I can’t breathe –, bavures qu’il faut cesser de considérer comme accidentelles mais bien comme systémiques, il analyse le changement de rapport de force qui découle de cette capacité à montrer ce qui se passe réellement. La constitution de preuves. Mais la part effarante, que semble souligner une sorte de fuite en avant, est que la publicité inédite des comportements réels de la police ne conduit pas à un examen raisonné, démocratique du genre, « ah oui, quand même, faut sans doute qu’on comprenne mieux et qu’on cherche à modifier ces agissements ». Non, une entreprise puissante de déni et de destruction des documents « volés » se met en place (et qui atteint son comble avec l’actuel projet de loi du ministre français Darmanin). Face à ce qui est toujours mieux rendu visible, « ils voudraient pouvoir se soustraire officiellement à l’examen public et, au fond, entériner une anonymisation rampante, avec des agents qui opèrent de plus en plus encagoulés, dissimulent leur visage, camouflent leurs plaques minéralogiques, sans parler des numéros de matricule obligatoire (RIO) invisibles. Une volonté de renforcer leur impunité, qui signe rien d’autre que ça : un glissement autoritaire. » (p.30) Cela donne lieu à une nouvelle bataille : « elle est d’usure et de stigmatisation (arrestation de vidéastes, effacement de cartes mémoire, téléphones matraqués, campagne anti « journalistes militants », acharnement contre quelques sociologues, jugés ingrats et qui se verront perdre quelque poste dans quelque école de police, sans compter les trolls en escadrille, 24 heures sur 24, qui harcèlent, diffament, piègent). » (p.24)
Narrations policières, récits alternatifs.
Un glissement autoritaire. Souvenons-nous, c’était un tube de campagne électorale : il fallait restaurer l’autorité du pouvoir, tous les problèmes viendraient de la perte d’autorité de l’État. Et c’est ce qui se met en place avec la narration policière que l’information mainstream ne prend pas la peine de présenter en tant que telle, dans sa continuité de récit, au quotidien. Julien Coupat raconte comment se construit cette narration et comment elle se répand dans l’imaginaire populaire, à partir de la série « Engrenages », coscénarisée par le commissaire de police Éric de Barahir et le juge anti-terroriste Gilbert Thiel. Le fonds de commerce en est le fantasme de la « radicalisation de l’ultra gauche » comme force rongeant et déstabilisant la société. « Quelle différence y a-t-il, à vrai dire, entre la confection d’un dossier d’instruction antiterroriste et un scénario de série policière ? Ne s’agit-il pas toujours de raconter une histoire efficace ? ». (p.44) À relire calmement, à tête reposée, ce qu’écrit julien Coupat :
on se demande en effet si l’on n’est pas en train d’accepter comme tout à fait normal, au prétexte de produire de bonnes séries réalistes, des procédés plus que borderline démocratiquement, façonnant l’imaginaire d’innombrables personnes. «
On ne voit pas, dans ces conditions, quel scrupule devrait avoir Canal + à commanditer un scénario de fiction à un commissaire d’active, à offrir à la police de travailler directement sur l’imaginaire d’un million de spectateurs : l’état hypnotique produit par le flux de 24 images par seconde est tout ce qu’il y a de plus propice à l’édification des masses devenues incrédules. » (p.45) L’enjeu est, pour reprendre une expression de Pascal, rappelée par les auteurs du livre « Dominer » (Dardot et Laval), de contrôler les « cordes de l’imagination ».
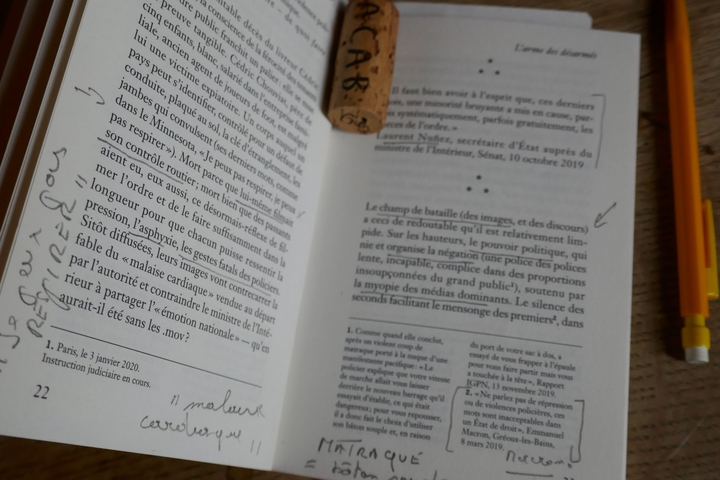
Contre les bavures policières, faire communauté avec les absents.
Amal Bentounsi souligne l’importance de construire des contre-récits. En s’appuyant certes sur les nouvelles technologies déjà évoquées par David Dufresne. Elle a mis au point avec son association une application qui permet d’envoyer directement les images filmées, les sons captés. Ainsi, même si le téléphone est confisqué, détruit, le témoignage est parti, instantanément, sauvegardé, en mémoire. Elle témoigne depuis un autre point de vue que les autres auteurs, mais qui converge. On voit d’ailleurs que ces différents engagements, déclenchés par des situations très diverses, se croisent, entretissent leurs actions sur le terrain. Elle parle depuis les cités. Son frère a été abattu en plein braquage. Elle a dû se battre pour faire reconnaître qu’il avait été tué « dans le dos », que la légitime défense n’était pas justifiée. Son combat, depuis, ne vise pas que les violences policières en tant que telles. Elle cherche à établir de façon raisonnée leur dimension de racisme structurel à l’égard des habitants surtout masculins des cités, en lien avec l’histoire coloniale.
Elle travaille surtout à restituer un lien de communauté, un réseau de liens de sens, là où les forces de l’ordre entendent discréditer et détruire, au nom d’un « communautarisme » stigmatisé comme un ennemi essentiel de l’État de droit.
Elle constate que c’est souvent au départ de la mort ou la mise en prison d’un proche que le sentiment de communauté réelle, humaine, renaît, pour assumer l’absence et la perte. « Salie par la notion malveillante de « communautarisme », la communauté n’existe que dans la mesure où la mort d’autrui nous scandalise, nous met hors de nous, c’est-à-dire nous pousse en dehors de notre petite personne. La communauté rend palpable « le service à autrui jusque dans la mort, pour qu’autrui ne se perde pas solitairement » (Blanchot). « Depuis là où nous sommes, filles et femmes de l’immigration, nous combattons l’injustice en tissant un lien, politique, social, culturel, autour de nos absents, pour ne pas les perdre une seconde fois ». (p.74)
Les antifascistes dans le collimateur des forces de l’ordre : trouble police
« Le militantisme antifasciste » a valu à Antonin Bernanos « d’être inculpé et condamné dans le cadre de deux affaires qui ont défrayé la chronique », (affaire du quai de Valmy et affrontement entre extrême droite et antifascistes en marge du mouvement des Gilets jaunes). Dans son article, il explore le récit policier du côté de ses racines coloniales, fascistes, racistes, démontant au passage « l’instrumentalisation de la présence des groupes et des thèses d’extrême droite » comme « deux des principaux leviers d’intervention des classes dominantes contre les Gilets jaunes ». « Lorsque l’on retrace l’histoire d’un service de police comme la BAC, qui s’est particulièrement illustrée dans le cadre de la répression des quartiers et des mouvements sociaux, sa genèse « endocoloniale » apparaît de façon éclatante. Ses ancêtres, les BAV – Brigades agression et violence –, sont elles-mêmes nées des Brigades de surveillance des Nord-Africains, créées pour réprimer les mouvements de lutte des Algériens lors de la contre-insurrection menée en France et en Algérie. (…) Formée et dirigée par les anciennes polices coloniales, elle a les mêmes objectifs : être furtive, mobile, active dans la prospection et l’anticipation des délits, et faire le plus d’abattage possible à travers un ciblage raciste ». (p.88) Cette « généalogie policière » est ensuite mise encore plus en perspective dans les méandres du « néofascisme français » comme « historie républicaine, coloniale et militaire ». (p.89)
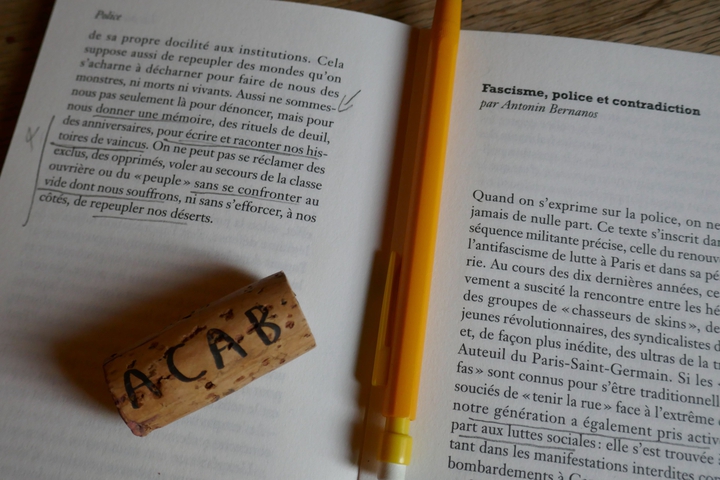
La violence légitime confisquée, vidée de sa substance ou la politique du vide
Ce sont ces généalogies troubles qui conduisent à l’actuel agir policier répressif, « décomplexifié », au service d’une classe politique soucieuse de restaurer, donc, son autorité. Et c’est là que, pour le citoyen soucieux de démocratie, cela devient interpellant ; pour le bien public, n’y aurait-il pas du sens à une jonction entre police et manifestant·e·s ? Or c’est tout le contraire qu’affirme la rhétorique dominante que Frédéric Lordon dézingue, en philosophe sniper intraitable. Il vise le concert d’inepties à propos de la « violence légitime ».
Une notion reprise abondamment par les pouvoirs en place, recyclant sans trop d’élégance les éléments d’une œuvre de Max Weber, désormais « pathétiquement mâchonnés par des hauts fonctionnaires ou des éditocrates sans esprit ».
C’est « la même idée obstinée, le même entêtement buté, dernier rempart justificateur à quoi il faut impérativement tout accrocher pour que tout ne sombre pas dans l’indignité pure ». « L’État détient le monopole de la violence légitime ». Il s’ensuit que 1) toute autre violence est illégitime et que 2) la violence d’État n’est jamais illégitime – puisqu’elle est légitime. On en est là de la « réflexion »… (p.114) Et donc, puisque la police c’est l’État, la violence policière est légitime. CQFD. Circulez, il n’y a rien à voir. Ça devient donc trop énorme, trop « dernière planche de salut » d’un pouvoir incapable d’entendre et de changer. C’est probablement en tablant sur cette énormité, qui ne peut que créer des malaises chez certains membres de la police, qu’Éric Hazan espère encore réactiver le « police avec nous »...
N'y a-t-il pas d’autres manières de penser la police ?
Est-ce sans espoir ? En général, quand on se met à critiquer la police, on s’entend assez souvent répliquer : « oui mais, pourtant, il faut bien une police ! Qu’est-ce qu’on ferait sans flics !? ». Il serait sans doute salutaire de répandre l’idée que d’autres manières de penser la police sont accessibles à l’intelligence humaine !
A titre d’exemple de piste de travail plausible, renvoyons à cette tribune dans le journal Le Monde, le 6 juillet 2020, de la magistrate Magali Lafourcade, spécialiste des droits de l’homme, « Il faut instaurer un droit à la police ».
Voici ce qu’elle présente : « À mesure que la crise sanitaire se mue en crise économique, se profile le retour des luttes sociales et écologiques. En regard, le mouvement de contestation qui gronde dans les rangs de la police semble venir de loin. En surplomb de l’impasse, nos institutions n’en mènent pas large. Il est temps d’ouvrir le débat sur la place de la police dans notre pacte républicain. Il me semble qu’il devrait s’articuler autour de la construction d’un droit : le droit à la police. Il s’agit de consacrer une police au service de l’exercice paisible des libertés, replacer le citoyen au centre, et les policiers et gendarmes à son service, penser la police comme un service public banalisé ». Et, plus loin : « Ce droit à la police renouerait avec la philosophie politique de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Ce réalignement demande de consacrer, d’organiser et de contrôler ce droit à la police autour de trois urgences structurelles ».
Voilà, une police en harmonie avec les droits humains n’est pas de l’ordre de l’impensable. Voilà peut-être la base pour fonder un nouveau « police avec nous ».
Pierre Hemptinne
Références du livre : « Police » La fabrique éditions, 2020
https://lafabrique.fr/police/
Liens :
Un pays qui se tient sage, présenté par David Dufresne
https://www.youtube.com/watch?v=RXqAVbLEyUc
Amal Bentounsi, collectif Urgence notre police assassine
https://www.youtube.com/watch?v=bMEcswLE5F0
Application mobile pour filmer les violences policières
https://reporterre.net/Une-application-mobile-pour-filmer-les-violences-policieres
Article de Philippe sur le film « Un pays qui se tient bien sage »
https://www.pointculture.be/magazine/articles/critique/un-pays-qui-se-tient-sage-david-dufresne/
En collection :
Éric Pittard, « Le bruit, l’odeur et quelques étoiles »
https://www.pointculture.be/mediatheque/documentaires/le-bruit-l-odeur-et-quelques-etoiles-tj1326