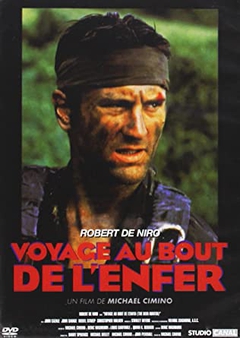Des révoltes qui font date #57
1978 // Au lendemain de la guerre du Vietnam, Michael Cimino compare la guerre à une partie de roulette russe.
Sommaire
L’entrée en guerre des États-Unis au Vietnam suscite des réactions immédiates. Dès 1965, ce sont des étudiants qui défilent dans les rues de Washington, San Francisco, New York et Boston, des jeunes gens majoritairement issus des classes moyennes. Pendant ce temps, les médias exaltent les vertus du patriotisme, nul doute que l’ennemi communiste sera vaincu. Il faut attendre quelques années pour que l’opinion publique bascule ; la presse, puisque tout semble partir d’elle, se décide enfin à faire la lumière sur les réalités du terrain. Le revirement se raconte en photos et en chiffres, on voit alors comment les deux camps se rejoignent dans les pertes et les souffrances. Majoritaire, la contestation se propage jusqu’en Europe où se monte, à l’initiative de Jean-Paul Sartre et Bertrand Russel, un Tribunal international des crimes de guerre. Création symbolique qui cependant en dit long sur la solitude de l’attaquant.
You're talking to me ?
Privés du soutien des leurs, les États-Unis signent les accords de paix de Paris en 1973 et se retirent du conflit. Trois ans plus tard, la chute de Saïgon conduit le Vietnam à une paix qui voit triompher le gouvernement des communistes. Dans les années qui suivent, avec le rapatriement de leurs troupes, les États-Unis doivent faire face à un imprévu, les vétérans. Que faire de cette population d’hommes jeunes, sous le choc, malade, enfermée dans un cauchemar qui ne veut pas finir ?

On ne s’étonnera guère que cette situation de malaise social soit le premier sujet dont le cinéma s’empare en se retournant sur les faits de guerre. C’est qu’en cette deuxième moitié des années 1970, il semble plus urgent, en termes de contestation, de dénoncer les séquelles du combat sur la santé mentale du pays que de creuser une culpabilité qui en est partie prenante. À bien des égards, Taxi Driver (Scorsese, 1976) et Coming Home (Hal Ashby, 1978) sont deux films emblématiques d’une déroute intérieure que les responsables préfèrent ignorer.

Car là aussi, il y a scandale. Abandonnés à leur sort, les vétérans ont toutes les peines du monde à se réinsérer dans la vie normale. À leur sujet, on commence à parler de syndrome du stress post-traumatique, mais la recherche n’en est qu’à ses débuts. En attendant, les hommes sont livrés à eux-mêmes. 150 000 / 58 220 : le nombre de vétérans de la guerre du Vietnam morts de suicide pourrait même dépasser le nombre de soldats morts sur le terrain (L’Humanité, 30/04/2015). Les addictions qui s’installent dans un contexte de troubles mentaux et de maladies organiques dues au déversement d’agent orange enferment une population d’indésirables dans le chômage et les problèmes de logement.
Serving God and country proudly
Dans ce climat hypersensible, Deer Hunter ouvre le bal de la fiction. C’est le premier film américain tourné en Asie du Sud-Est à parler du conflit sous l’angle du traumatisme. Au milieu d’une actualité brûlante, Michael Cimino ne craint pas de prendre de la hauteur. Il rejette ce qui pourrait passer pour une transposition littérale des événements, les images que tout le monde attend, et l’objectivité prétendument réparatrice. À l'écart des faits bruts, le film est un voyage mental dans l'expérience de la guerre.
Try not to look for symbolism in the movie, because there is none. There’s no political agenda in the movie, it’s not even about the Vietnam war. It’s about what happens when catastrophe attacks a group of friends who are like family, in a small town. This is a movie about people. It’s simply about people — Michael Cimino
Le sujet du film n’est pas la guerre du Vietnam. C’est ce qui arrive quand une catastrophe s’abat sur un groupe d’amis dans une petite ville, une communauté presque comme une famille. C’est un film qui parle des gens, tout simplement. Un brin provocateur quand il parle de se soustraire à l’immédiat, Cimino n’a aucunement l’intention de minorer son propos. Plus conséquent et, bien entendu, plus ambitieux, il aspire à dialoguer avec les grands mythes nationaux, et avec celui qui les a portés au cinéma avec la plus grande élégance : John Ford. Dans son analyse, le critique Jean-Baptiste Thoret note d’ailleurs que le troisième chapitre de Deer Hunter est la réplique exacte du final de La Prisonnière du désert, à ceci près que la quête n’a pas l’issue heureuse que Ford peut encore imaginer à ses héros. C’est dire que dans cet échange de points de vue a priori démesuré dont l’histoire du cinéma devient le lieu, des questions essentielles se posent. Que deviennent les héros d’hier ? Sur quoi va-t-on refonder la nation ? Quel avenir pour la communauté ? Que sont devenus les grands mythes fédérateurs ? Comment se définit une victime ?

Deer Hunter est un drame en trois actes au centre duquel la guerre occupe une place très relative, partiale, et ambiguë. Le début ressemble à un home movie. L’histoire s’ouvre à Clairton, toute petite ville industrielle de la Pennsylvanie, au cœur d’une communauté de descendants de l’immigration russe dont l’emploi se resserre autour de la sidérurgie. Il y a une bande de copains, l’un d’eux va se marier, l’ambiance est à la fête. Doté d’un casting prestigieux (Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, John Cazale et Meryl Streep), Cimino prend soin de mêler ses acteurs aux membres de la communauté qui l’intéresse. Dans un savant dosage de vrai et de faux, d’images documentaires et de fiction, c’est un petit bout de cette Amérique fordienne qui se montre, un melting pot de traditions, des gens contents d’être ensemble. En somme, le héros américain le voilà : jovial, sociable, modeste, travailleur, pilier de la famille et de la communauté. La séquence du mariage, qui dure une bonne vingtaine de minutes, est l’adieu céleste à cet homme-là, son chant du cygne.
How do you demonstrate the terror of waiting for random death ?(…) What better way to show the tension of random death than russian roulette ? — Michael Cimino
Random death
Sans transition on plonge dans l’Enfer dont le titre français paraphrasant Céline souligne lourdement la valeur contre-initiatique. On retrouve la bande d’amis du mariage. Dans la jungle, capturés par les combattants du camp opposé, ils sont retenus prisonniers sur une rivière boueuse, entre les pilotis cerclés de barbelés d'un baraquement en bois. À présent, sous l’œil délirant des militaires vietnamiens, ils jouent leur vie. Pas d’état-major, de conseil de guerre, de morceaux de bravoure, ce qu’on voit du front se limite à l’intérieur de la cabane posée sur l’eau où barbotent des corps mutilés livrés en pâture aux rats. Par couple, les prisonniers doivent s’affronter. Les Vietnamiens lèvent les paris, le hasard désigne un survivant. L’image réduit à néant les enjeux du conflit. Ce moment de folie qu’est la roulette russe rend très justement compte de l’inanité d’une guerre qui, sur le terrain, repose sur une loterie dont l’objet a été oublié depuis longtemps. Le joueurs sont tous perdants, ceux qui remportent la mise restent dans l'ombre.

L’objectivité n’est pas le but poursuivi par Cimino. L’important pour lui n’est pas de dépeindre le conflit de façon équitable ni d’essayer de démêler l’écheveau politique. Le cinéaste n’a dans le viseur que le destin de l’Amérique, et de surcroit pas de n’importe quelle Amérique, c’est la situation du peuple américain qui l’intéresse, l’Amérique telle qu’elle se perçoit elle-même. Il reviendra aux générations futures de sonder les liens entre la population vietnamienne et les combattants américains, en particulier sous l’angle du métissage, ces enfants nés d’unions furtives, le plus souvent contraintes ou tarifées, entre les GI et les Vietnamiennes.
God bless America
À ceux qui jugent obscène de représenter la guerre par un jeu de roulette russe, le troisième volet du drame ne fait pas autre chose que d’approfondir la pensée d’une expérience limite dont on ne se remet pas. Retour à Clairton. Entre la population féminine restée de longs mois sans la moindre nouvelle des combattants, ceux qui reviennent traumatisés et ceux qui ne reviendront pas, y a-t-il encore une possibilité d’être ensemble ? Ce que Cimino montre, c’est que même au sein de la bande d’amis, les liens sont rompus. Rompu aussi ce qui tient l’individu fermement sur ses jambes. Sans ses amis, sans le soutien de la communauté, le héros vacille, il révèle son insuffisance, sa fragilité, son irréductible solitude.

Si ténue qu’elle soit, et non dénuée d’ambiguïté, Cimino laisse cependant filtrer une petite lueur dans cette vision radicalement critique, du point de vue américain, de la guerre et de ses effets secondaires dévastateurs. C’est la fameuse scène de la chasse au daim à laquelle la version originale anglo-saxonne doit son titre presque saugrenu. Dans une mise en scène ultra-classique, « fordienne », l’épisode qui survient au début du film montre l’animal s’effondrer sous le tir précis du héros surnommé « One shot ». La séquence, qui fait l’objet d’une reprise au troisième tiers du film, prend une tournure quelque peu déconcertante lorsque le héros, toujours le même et par ailleurs excellent tireur, renonce à abattre la proie qu’il tient fermement en joue. L’acte de clémence, censé éclairé positivement le trajet intérieur effectué par le personnage, est un adieu au héros. Prenant conscience de son potentiel de destruction, il abandonne les attributs du pouvoir. Pour appuyer ce renversement, Cimino ne le filme plus en surplomb, au sommet des cimes, mais face à un lac, sur un plateau. Plus tard, et c’est tout le sujet de la dernière (s)cène, l’hymne God Bless America entamé d’une voix chevrotante autour de la table où l’on s’apprête à partager un repas vient confirmer le caractère problématique de l'hypothèse introduite par la métaphore de la chasse. Hors de l’ivresse, de la foi et de la violence qui soudent la communauté, que reste-t-il de l’Amérique ? Le propos glisse ainsi de la critique de la guerre à une mise en question de ce qui fonde une nation hors de laquelle les êtres redeviennent vulnérables et insignifiants. En allant à contre-courant de la doxa de son époque qui attend que justice soit faite pour que la nation puisse se reconstruire, Cimino argumente le fait qu'il ne croit pas en une telle renaissance, quitte à susciter polémique et malentendus. À l’endroit où l’on guette l’espoir, son état des lieux est des plus sombre. L'avenir ne lui donnera pas forcément tort.
Texte : Catherine De Poortere
Cet article fait partie du dossier Des révoltes qui font date.
Dans le même dossier :
- Grandir est un sport de combat « Olga » d'Elie Grappe
- Tragique dissonance : « Chers Camarades ! » d’Andreï Kontchalovski
- « The Revolution Will Not Be Televised » – Gil Scott-Heron
- Mouvement des gilets jaunes / Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
- Opposition à la 2ème centrale nucléaire à Chooz / Une ballade du GAM