F(s), dix ans après : l’effet papillon
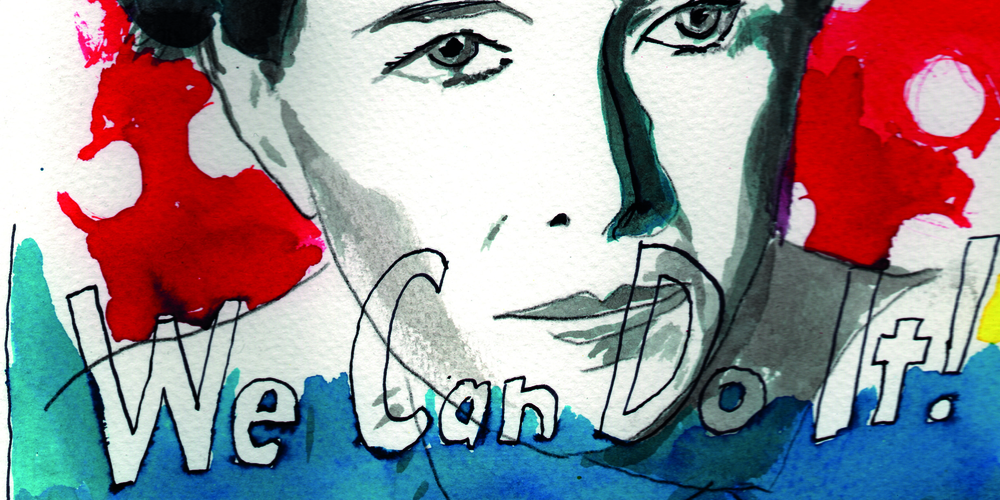
Il y a dix ans, un collectif a été nommé à la coordination du Théâtre National. Beaucoup voient aujourd’hui dans cet événement le début d’une nouvelle ère.
Colette : Rappelez-vous le contexte d’alors, des collectifs féministes militaient pour le changement structurel dans le monde culturel. En effet, la culture, qui se voulait à l’écoute de la marche du monde, de la moindre de ses vibrations, des revendications, des changements nécessaires à un monde meilleur, avait oublié de prendre conscience de son propre fonctionnement !
Chavela : La majorité des structures fonctionnaient sur un mode vertical et patriarcal avec, la plupart du temps, un sacro-saint directeur au sommet de la pyramide, souvent bien cramponné à son pouvoir. Dans une démocratie qui se demandait comment trouver d’autres modes de fonctionnement, le monde culturel semblait archaïque ! Mais l’heure était au changement, des petites structures avaient commencé à fonctionner sur un mode horizontal, à mettre en place une politique de quotas et de proportionnalité pour les femmes et la diversité.
Felipe : Je dirigeais un lieu culturel, et je dois vous dire que je ne croyais pas du tout à l’horizontalité que ce groupe de femmes revendiquait. Mais c’était intriguant, il y avait une contestation démocratique, à plein de niveaux, et un besoin de retrouver du commun. J’ai accepté les quotas et je pensais qu’on me foutrait la paix, mais il n’en fut rien (Rires). Mon CA a très vite instauré un comité de programmation de quinze personnes tirées au sort, en rotation, parmi les volontaires du public, du personnel et des artistes antérieurement programmé·e·s. Je me suis dit que ce serait un foutoir pas possible. Et en fait, ça marchait vraiment bien…
Chavela : Vu que les artistes devaient remplir un formulaire unique et se positionner par rapport à des critères bien précis, ça a donné lieu à des représentations du monde qu’on n’avait pas encore vues, à des formes différentes.

C’était il y a 10 ans et cela nous paraît un passé révolu ?
Awa : Ce monde « vertical » est difficile à imaginer aujourd’hui. Qui regrette encore cette époque où les programmations étaient monopolisées par les mises en scène blanches, bourgeoises, qu’elles soient classiques ou contemporaines d’ailleurs ? Cela ne collait pas vraiment avec l’image de la société. D’ailleurs souvent les spectateur·rice·s faisaient partie de ces milieux. Les places de théâtre étaient vendues à un tarif fixe, souvent assez élevé.
Nour : Moi, ce qui m’a choqué, c’est que, alors que le changement climatique se faisait de plus en plus sentir, le monde culturel continuait à produire sans questionner le mode de production lui-même ! Il y avait des sécheresses, des températures anormalement élevées, il était moins une et l’humanité vivait dans le déni, tout en sciant la propre branche sur laquelle elle était assise…
Je pense souvent à cet orchestre qui joue à tue-tête sur le pont du Titanic qui coule.
En quoi le projet F(s) pour le TN a-t-il été vecteur d’un changement plus global ?
Colette : Le changement était en route, les jeunes étaient très mobilisé·e·s sur les questions environnementales et sociales. C’était la génération qui savait qu’il fallait tout changer pour survivre. Et puis il y avait déjà eu pas mal d’expériences concrètes de tirage au sort citoyen comme en Islande en 2010. Il faut relire David Van Reybrouck.
Nour : … un homme ! (Rires)
Awa : Disons que le terreau était là : les jeunes pour l’urgence climatique avec Greta Thunberg, les collectifs d’hébergement des sans-papiers, les Gilets jaunes, et les mobilisations antérieures avec les altermondialistes dont Vandana Shiva et Naomi Klein.
Nour : Wow, j’étais même pas née…
Awa : Dans tous ces mouvements, les femmes étaient majoritaires et porteuses de solutions. D’ailleurs, c’est lorsque Christiane Taubira est devenue présidente de la France en 2022 qu’elle a pu initier la réforme du pouvoir présidentiel. Les théories d’Elsa Dorlin et de Françoise Vergès sont depuis étudiées dans les écoles.
Felipe : Vous êtes modestes, mais un des gros déclencheurs a tout de même été le choix de votre projet collectif pour le TN en 2021 ! N’oublions pas que c’est dans l’année qui a suivi que le budget de la culture a été géré de manière participative en Belgique et par la suite dans tous les pays d’Europe !
Colette : Bon nombre de villes commençaient les parlements citoyens, F(s) n’a rien inventé. On s’était même inspirées de la Fondation Marius Jacob pour notre comité de programmation rotatif et tiré au sort. Ce qui était super, c’est que ce modèle était transposable dans quasi tous les secteurs et, de fil en aiguille, ça s’est propagé, presque comme un virus.
Rémi : Est-ce que je peux prendre la parole ?
Nour : Oui, bien sûr Rémi.
Rémi : Voilà, c’est peut-être idiot ce que je vais dire, mais tout le paysage a changé. Plus de voitures, les comités et les potagers partout, la fin de la production de la viande industrielle, en dix ans seulement. On voulait nous faire croire…
Felipe : Ça y est, les théories du complot maintenant…
Rémi : … qu’il n’y avait pas d’alternative, mais c’est faux. C’était si simple en fait, et d’une rapidité… inimaginable.
Qu’est-ce qui selon vous a été décisif pour arriver à ce changement paradigmatique ?
Awa : Le début des années 2020 a été marqué par les premières grandes crises sanitaires qui ont révélé notre fragilité et notre interdépendance. Des penseuses féministes avaient depuis longtemps mis en évidence le « care » comme étant au cœur d’une vision de l’humanité. Souvenez-vous à quel point la production intellectuelle des femmes était invisibilisée à cette époque ! Cela nous semble inimaginable aujourd’hui. Isabelle Stengers qui proposait de « désensorceler le capitalisme », Donna Haraway « d’ensemencer des mondes » pour, comme le disait Vinciane Despret, « rejoindre une aventure collective, multiple et sans cesse réinventée ».
Ce « continent invisible » qu’étaient les femmes s’est révélé une terre de ressources pour penser où atterrir.
Colette : Oui en effet, et je dirais que le collectif qui s’est très vite mis en place dans la plupart des institutions de pouvoir a été le déclic. Cela peut sembler anecdotique, mais c’est véritablement ce qui a permis de repenser le système. Après le TN, la RTBF a suivi à la fin de cette même année. Et, ensuite, l’assemblée citoyenne mise en place pendant l’épidémie de l’influenza-aviaire-23 a pu bénéficier de la méthodologie acquise par les expériences de collectifs de femmes.
Felipe : Effectivement, voir enfin dans les médias des penseuses féministes qui parlaient autrement de l’économie, ça a été une révolution et…
Rémi : Ah oui, comme Christine Delphy ! Oh, pardon de vous avoir interrompu. L’une des grandes figures du féminisme matérialiste qui n’a cessé de rappeler l’importance des luttes féministes pour aboutir à un changement radical de société. Quel aveuglement de ne pas avoir intégré ces réflexions plus tôt dans les mouvements de gauche !
Nour : C’est incroyable d’imaginer qu’il a fallu autant de temps pour « découvrir » la bienveillance, l’empathie et le non-jugement ; pour questionner les diverses discriminations sans s’enfermer dans des pièges et des clichés identitaires. J’hallucine, comment était-il possible de vivre autrement ?
Chavela : Oui, c’est vertigineux. Les assemblées participatives sur la base de tirage au sort et de la rotativité ont été des outils révolutionnaires en ramenant la parole de chacun·e à sa juste proportion.
Awa : Nous n’avons fait que survoler cette période, il faudrait vraiment aller plus loin. Rappeler les travaux de toutes ces penseuses, créatrices qui ont véritablement ensemencé notre avenir. Sans elles, il n’y aurait pas eu cet effet papillon !
*F(s) est un collectif féministe de femmes du secteur culturel né en 2018, à la suite de la nomination d’un homme à la tête du Théâtre des Tanneurs, alors que, face à lui, trois femmes avaient été retenues. F(s) compte des centaines de membres, agit et se manifeste sur toutes les questions liées à la place des femmes dans la culture.
© Stéphane-Arcas_En voiture de Beauvoir
© Groupe F(s)_Emilienne
Cet article fait partie du dossier 8 mars 2021.
Dans le même dossier :
- Femmes puissantes, une sélection de films docs
- « Keep Your Laws off My Body» | Médiagraphie avortement
- « Les Résistantes », film choral d'une journée recomposée
- Lutte pour la dépénalisation de l'IVG en Argentine / Un film de Juan Solanas
- Pilule contraceptive et révolution sexuelle / « The Pill » de Loretta Lynn